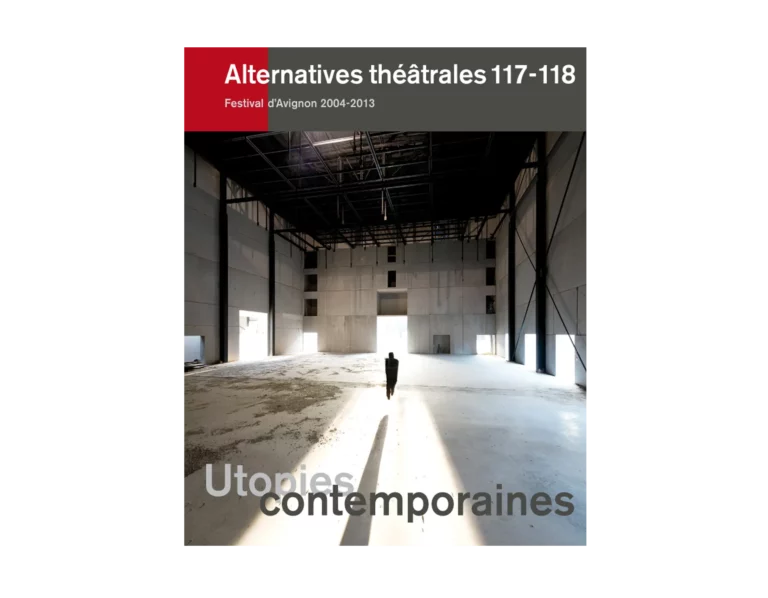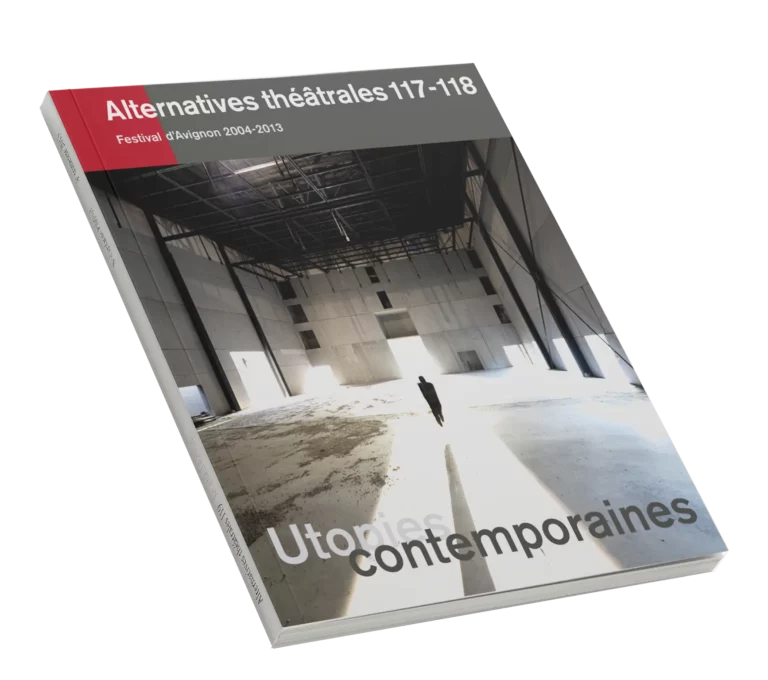JE VOIS en toi la « vieille neuve Europe », une Europe qui garde sa mémoire, la bonne et la mauvaise, la lumineuse et la sombre. La lumineuse, c’est au fond l’idée de la philosophie et de la démocratie […], les Lumières et même ce qu’on appelle, de manière assez douteuse, la « sécularisation ». Qu’elle garde aussi sa mémoire nocturne, la mémoire de tous les crimes qu’elle a commis dans l’Histoire et qui ont été commis en son nom, toutes ces formes d’hégémonie, de colonialisme et, au cours de ce siècle, toutes les monstruosités du totalitarisme européen : fascisme, nazisme, stalinisme. Mon espérance, c’est qu’à partir de tes deux mémoires, et notamment de la prise de conscience et du repentir qui ont suivi ce que j’appelle ta « mémoire nocturne », toi, ma nouvelle « vieille Europe », t’engages dans un chemin que tu es la seule à pouvoir frayer aujourd’hui.
Jacques Derrida, Double Mémoire, commande du Festival d’Avignon pour l’ouverture du Théâtre des Idées, 20041.
Il faudrait dire qu’il n’y a plus aucune évidence du lien d’un spectacle à ses spectateurs. Il faudrait dire qu’il n’y a plus aucun modèle simple pour justifier une institution théâtrale dans une ville ou son rôle dans la politique d’un pays. Il faudrait dire qu’il n’y a plus aucun système de représentation évident, autrement dit de rapport de la représentation théâtrale aux représentations de la vie courante comme symbolique et mythique. Il faudrait dire, enfin, que le théâtre ne vaut pas parce qu’il présente des comportements, des figures, des drames exemplaires, mais parce qu’il dramatise, c’est-à-dire qu’il participe à la formulation des questions et réinterroge les symbolisations courantes et pour cela travaille la façon dont il est lui-même reçu et écouté.
Mais l’absence d’évidence ne signifie pas la vanité.
Le théâtre n’est pas, comme on le résume souvent, une relation à deux termes, acteur et spectateur, mais à quatre : l’acteur, le spectateur, une situation dramatisée et un espace de représentation identifié comme tel. Ce lieu a un rôle essentiel dans la relation qui s’instaurera
entre artistes et spectateurs : par l’ensemble de ses caractéristiques traduites dans son bâtiment, ses éléments de communication, ses rituels d’accueil et de présentation par exemple, il réunit et inscrit les mémoires et histoires du temps, rendant lisible l’espace commun et public, normé et organisé par le calendrier, les alternances horaires, les continuités historiques, les rituels sociaux par exemple. Ainsi, il institue les places de chacun, confiant symboliquement un rôle autant à l’œuvre scénique qu’à son audience, installant leur relation. Un artiste est présenté pour une certaine raison, que l’institution a définie. Mais dans le même temps, le spectateur, par sa participation à la représentation, est le témoin et le garant de cet ordre commun, de ce réel fait de mythes, de mémoires et de symboles qui constitue l’institution et qu’il a reconnu comme tel – par exemple, lorsqu’on va en Avignon l’été, on se fait une idée de ce à quoi on participe, des idées ou velléités qui président à l’organisation de ce festival de théâtre ; on regardera les spectacles en tant que témoin et garant de ce cadre symbolique que l’on a reconnu en lui. On le sait ou on le devine, le contexte de création et de présentation d’un spectacle n’est jamais neutre pour un artiste. Il ne l’est pas non plus pour un spectateur. Or des quatre termes de la relation théâtrale, ce ne sont pas la situation dramatique ou l’acteur qui ont perdu leurs sens, leur inventivité, leurs valeurs et leurs prises sur l’actualité, mais bien davantage ce cadre de représentation2.
Chaque œuvre dramatique tente d’instituer un certain rapport avec ses spectateurs, qui vaut le temps de la représentation. Si l’espace de représentation n’est pas clairement établi et reconnu comme espace problématisant, ce rapport de l’un à l’autre reste binaire et incomplet, finalement banalisé. Un spectacle restera une forme d’animation agréable ; une œuvre deviendra un événement plus ou moins sympathique et justifié, inscrit dans les critères de plaisir ou d’instruction plus ou moins définis de l’époque. Mais de théâtre, point – au sens d’un drame, d’une symbolisation problématique révélant, au détour d’un récit, ce qui fait question, générant des reformulations possibles. Finalement, il y a théâtre lorsque l’œuvre fait sens, que ce sens soit explicitement formulé ou non. Or ce qui fait sens dans l’œuvre, ce n’est pas la situation présentée sur scène mais l’écho, la résonance que ce récit va trouver dans la salle.
C’est très différent : un spectacle n’est ni une leçon ni une démonstration, c’est bien le hiatus, l’aller-retour, entre le réel (qui est fait autant de mémoires que de symboles et de mythes), représenté par les spectateurs (c’est ce rôle de représentation du réel dans l’enceinte théâtrale que lui confie l’institution), et le monde inattendu de la scène3. Le sens d’une œuvre est donné à composer ou à entreprendre, et non imposé par l’œuvre – il va s’élaborer dans le temps long de l’esprit et de la remémoration, alors que chaque spectateur confronte son expérience vécue et les logiques à l’œuvre dans le spectacle. Car enfin, ce sont les spectateurs qui donnent sens
à une œuvre dramatique, pas l’œuvre qui donne sens à la salle – mais pour cela, le cadre de représentation doit être apparu comme tel, comme espace de résonance et de confrontation incertaine4.
Qu’est-ce que le Festival d’Avignon aujourd’hui ? Une grande fête du théâtre, en plein été, sous les douces nuits de Provence, dans des lieux chargés d’histoire ; un événement culturel célèbre, à la programmation très dense et singulièrement diversifiée ; une institution de renommée internationale où se retrouvent quelques uns des plus importants artistes de théâtre de l’époque ; un important rassemblement professionnel, attirant – fait rarissime – les professions et les compagnies les plus précaires autant que les plus importantes insti- tutions culturelles internationales ; un élément majeur du patrimoine culturel et artistique français ressorti de l’après-Seconde Guerre mondiale ; un pôle de développement économique pour toute une région ; un coproducteur théâtral parmi les plus importants d’Europe ; un des festivals de l’été attirant amateurs, professionnels, touristes séduits par l’histoire ou le patrimoine et curieux titillés par toute cette agitation. Le Festival d’Avignon est devenu aujourd’hui mille choses différentes selon les points de vue et les préoccupations, et c’est cette diversité même qui fait son intérêt, sa force et son attrait. Son passé, son histoire, ses mémoires, ses souvenirs – et même sa nostalgie – tout comme sa valeur économique ou son statut symbolique (l’un et l’autre étant apparus avec force lors de l’annulation de 2003, alors que ceux que l’on nomme depuis les « intermittents du spectacle » manifestaient pour la défense de leur statut professionnel spécifique) sont à la fois ce qui le porte et ce qui l’enferre, tant ils génèrent espoirs, attentes, comparaisons et invectives pleines de certitudes.
Si l’espace de représentation est déterminant dans la réception d’une œuvre de théâtre, comment peut se positionner un tel festival qui génère des attentes si différentes ? Comment peut-il éviter de sombrer dans l’animation estivale et touristique, satisfaisant chacun par un simple divertissement ou dépaysement ? Il y aurait certes la possibilité de tenter d’unifier l’hétérogène, en supposant que toutes ces attentes peuvent être intéressées par les mêmes valeurs et que les gens de théâtre parviennent à définir ex abrupto ce que l’ensemble de la société peine à retrouver, les possibles axes structurant de la vie collective mondialisée. Pourtant les artistes de théâtre ne sont pas des devins. Il est peu probable qu’ils sachent mieux que les autres comment vivre et quoi penser ; ils racontent des histoires, pas toujours très explicites mais souvent étonnantes, dans des langues pas toujours très évidentes mais souvent inventives. Leurs récits viennent d’ailleurs, de tout ailleurs – du fond d’un esprit, de la mémoire d’un pays, de l’imagination inattendue d’un groupe – même s’ils sont faits d’éléments communs que l’on connaît ou reconnaît. Et c’est dans l’écho inattendu et incertain entre cet ailleurs et la vie de chacun que les œuvres vont faire théâtre.