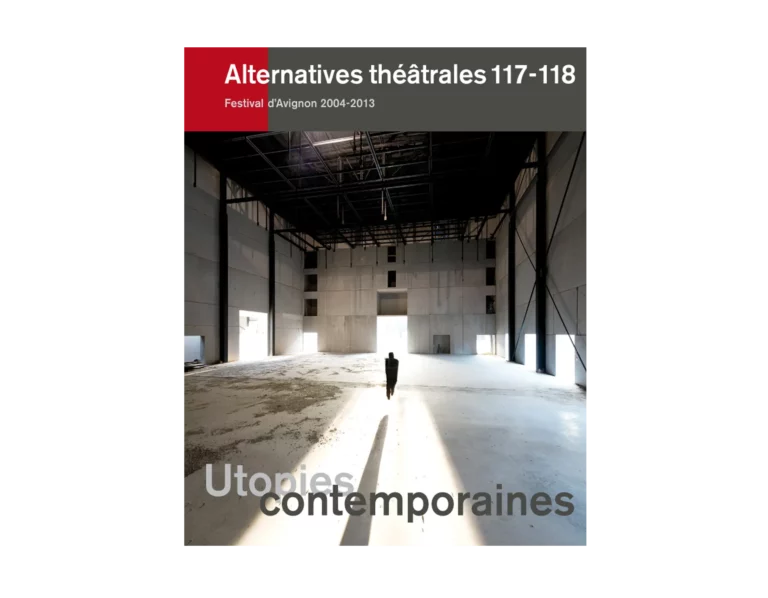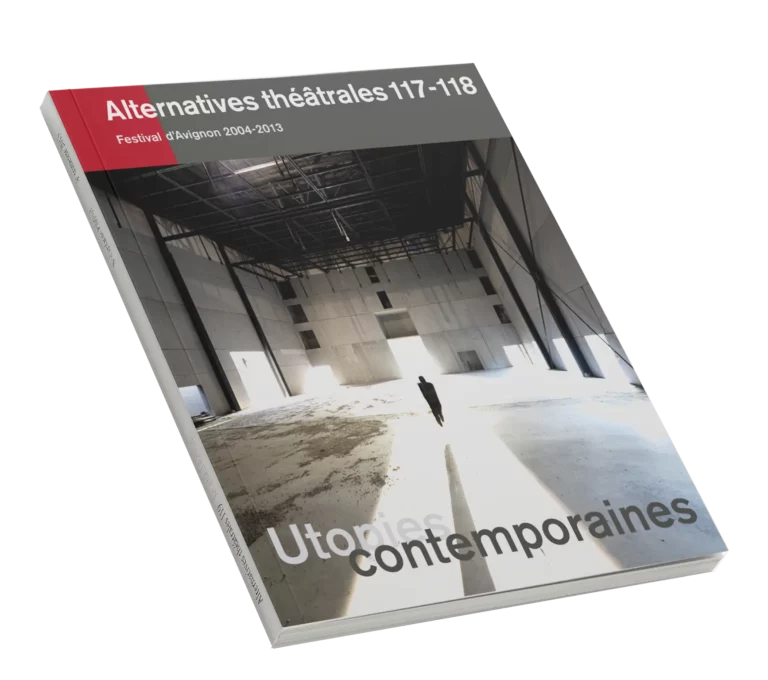JEAN-LOUIS PERRIER : Quand Hortense Archambault et Vincent Baudriller vous ont proposé d’être artiste associée en 2008, avez-vous pensé à ce qu’aurait pu en dire votre maître, Antoine Vitez ?
Valérie Dréville : Je n’y ai pas pensé. Je crois qu’il aurait été très content pour moi. Je me suis interrogée, seule avec moi-même : pourquoi moi ? Je ne me suis pas sentie légitime. Ce n’était pas ma place. J’étais honorée, flattée, mais ça me faisait peur.
J.-L. P. : Qu’est-ce qui vous a conduit à sauter le pas ?
V. D. : Le caractère étranger, le déplacement que ça supposait. Avignon est comme une cerisaie pour moi, un endroit où j’ai été petite, où j’ai grandi, un endroit d’amour. Je me suis dit que je pouvais d’autant moins refuser que j’étais attirée par ce qui m’était demandé. Si Hortense Archambault et Vincent Baudriller me faisaient cette demande, c’est qu’ils avaient de bonnes raisons et que j’allais les découvrir, parce qu’ils en savaient plus que moi là-dessus. Et aussi parce que Romeo Castellucci. Pour la rencontre avec lui.
J.-L. P. : Romeo et vous paraissiez pourtant repré- senter deux formes théâtrales radicalement différentes.
V. D. : Je suis convaincue que c’était pleinement réfléchi. L’étrange, c’est que lors de nos réunions à quatre avec Hortense Archambault et Vincent Baudriller, il y avait énormément de points sur lesquels nous nous rencontrions, énormément.
J.-L. P. : Vous présentez Avignon comme un lieu où vous avez grandi. Est-ce que le fait d’être artiste associée a contribué à vous faire grandir encore ?
V. D. : Être actrice-artiste-associée n’a rien à voir avec être actrice sur le plateau. Parce qu’on est en dehors de l’expérience de la scène, de son extrême dangerosité. À l’intérieur de l’espace scénique, on ne parle pas du théâtre, on fait autre chose, un travail de transformation. Être artiste associée, c’était faire un pas de côté, se mettre en marge de l’espace scénique et parler du théâtre. Le redéfinir pour soi-même dans les discussions avec les autres. Tous quatre, nous étions réunis pour dessiner une ligne de pensée, et cette ligne n’était en rien prédéterminée, nous la découvrions en cours.
J.-L. P. : Pourriez-vous décrire cette ligne de pensée ?
V. D. : Il y avait plusieurs axes, qu’on retrouve dans les chapitres du livre1 : la question du spectateur, la question de la transmission de l’expérience du plateau, la question du sens, la question du regard, la question du politique à travers le regard. On parlait beaucoup de cette forte pression sur le sens en France, donc sur le message, et sur la croyance qu’elle implique. Nous nous rencontrions dans le fait qu’une œuvre véritable ne délivre pas de sens de manière univoque mais plutôt à travers un certain mystère. Romeo travaillait sur LA DIVINE COMÉDIE et nous sur PARTAGE DE MIDI, et il était évident, dans ces deux œuvres, que le sens ne se délivrait pas de façon univoque.
J.-L. P. : Cette expérience vous a‑t-elle conduit à des évolutions dans votre travail ?
V. D. : Dans le même temps, nous faisions, avec mes quatre camarades de PARTAGE DE MIDI, une mise en scène collective. Elle était un peu du même ordre, dans la mise en partage de la question de la mise en scène. Les deux expériences se conjuguaient dans un même projet qui était celui d’élargir la responsabilité. Je pense que là où j’ai envie de grandir, c’est à cet endroit-là. Dans l’ouverture de la responsabilité face au théâtre. Finalement, le metteur en scène fait le même travail que l’acteur sauf qu’il embrasse plus largement. C’est ce que j’ai compris, et dans l’expérience collective de PARTAGE DE MIDI, et dans celle d’artiste associée.
J.-L. P. : Est-ce que cette position d’artiste associée vous a donné un sentiment de responsabilité sur l’ensemble du festival ?
V. D. : Nous n’avions pas fait la programmation avec Romeo, mais nous étions responsables du point de vue de la ligne, du point de vue d’un rêve commun dont nous étions en quelque sorte les gardiens. Je n’ai pas pu voir tous les spectacles, mais je m’en sentais la gardienne.
À Avignon, il y a, simultanément, une sorte de compétition entre les metteurs en scènes et une forme de solidarité. Il y a la course au premier prix, au spectacle qui va faire l’unanimité et en même temps il y a cet espace du partage avec les spectateurs, qui est vraiment unique. J’ai rencontré tant de spectateurs passionnés, radicaux, prêts à tout. Avignon est l’espace du dépassement. Le théâtre l’est de toutes façons. Mais alors là ! Les spectateurs nous aident à continuer, dans cette émulation unique en son genre. Avignon, c’est le théâtre-cité, le spectateur y est citoyen du théâtre.
J.-L. P. : Sur les treize artistes associés entre 2004 et 2013, vous aurez été la seule actrice et la seule femme. Quel commentaire cela vous inspire-t-il ?
V. D. : Je ne sais pas ce que je dois en conclure. La question des femmes est trop complexe pour être réglée en une phrase. Quoi qu’il en soit, je pense que c’était vraiment audacieux de demander à une actrice d’être artiste associée.
J.-L. P. : Une actrice qui amenait avec elle son histoire avec Vitez, Régy et Vassiliev.
V. D. : J’ai essayé de faire des choses essentielles. Je ne pouvais pas ne pas parler de Vitez, il ne pouvait pas ne pas être là. Je ne pouvais pas ne pas tout faire pour que Régy soit là, et il y est allé l’année d’après. Et Vassiliev était là. Et dans le même temps, je travaillais sans metteur en scène. Ce paradoxe me plaisait.
J.-L. P. : Quand on lit vos témoignages, on a l’impression de quelque chose de plus sensuel que d’intellectuel dans ce festival ?
V. D. : Il n’y a pas d’alternative pour un acteur : les idées ne peuvent que s’incarner, on ne peut pas séparer la pensée de l’émotion, sinon on ne fait rien sur un plateau. Une idée qui ne nous fait pas bouger physiquement ne passe pas.
J.-L. P. : Qu’avez-vous laissé là-bas, cette année 2008, et qu’avez-vous emporté ?
V. D. : Je pense à ce que j’ai emporté la première fois, au choc d’Avignon en 1987, à ce qui brûle en moi d’Avignon. C’était cette sensualité que vous évoquiez, c’était LE SOULIER DE SATIN, c’était la nuit, les étoiles, les odeurs, les martinets, les petits matins. De l’année 2008, j’emporte la mémoire de notre aventure à la carrière de Boulbon, de son sentier pierreux, des répétitions et des nuits, dans un temps de théâtre qui paraissait ne s’arrêter jamais. J’emporte les séances de travail avec Romeo, qui m’avait aidée avec Scott Gibbons à choisir les musiques pour la lecture de LA DIVINE COMÉDIE dans la cour d’honneur. J’emporte la lecture de LA DIVINE COMÉDIE, dans un vent d’enfer – c’est le cas de le dire –, les cheveux de Michael Lonsdale qui volaient en tous sens, si bien que j’avais dû lui mettre des épingles. À Avignon, on est comme des enfants. Avignon, c’est l’enfance. Pour moi, c’est vraiment ça. Je ne sais pas pourquoi. C’est pour ça que passée ma peur initiale d’être artiste associée, je me suis passionnée pour nos discussions collectives, et l’expérience s’est poursuivie sans subir de pression, dans un seul mouvement qui était du jeu.
J.-L. P. : Seriez-vous prête à recommencer chaque année ?
V. D. : Oui, ce parcours du combattant m’a incroyablement amusée. Ne pas arrêter de la journée, puis aller à Boulbon, être actrice. J’aime à Avignon ce mélange très nécessaire au théâtre entre la discipline et une sorte de nonchalance. Celle de l’été. On est en récréation, en vacances. Antoine [Vitez] travaillait beaucoup comme ça.

J.-L. P. : Vous sentez-vous associée à vie ?
V. D. : Je l’étais avant et plus que jamais, je continue de l’être. Qu’on soit artiste associée ou pas, c’est important de penser le théâtre. Il y a un moment où il faut essayer d’oublier complètement le plateau, essayer de ne pas tout voir à travers son expérience. Le fait d’être artiste associée m’a aidée à me placer ailleurs, à me déplacer. Je l’ai senti physiquement. Antoine faisait un peu la même chose parce qu’il était un homme de théâtre avant d’être un metteur en scène et un acteur.
J.-L. P. : Peut-on dire de vous que vous êtes une femme de théâtre ?
V. D. : C’est une aspiration, et, oui, l’expérience d’artiste associée fait entrer dans cette aspiration. Le théâtre est un conducteur, ce dont on s’occupe, c’est toujours la vie disait Romeo. Nous parlions beaucoup du regard. Il disait : c’est moins le regard que nous portons sur l’œuvre qui importe que l’inverse : comment l’œuvre nous regarde. J’ai souvent ressenti ça en répétition. On pose des questions, et à un moment donné, c’est la pièce qui nous pose des questions. À commencer par celle-ci, première, fondamentale : « Qui es-tu ? » Et bien sûr, dans cette petite cellule à quatre, c’était la question qu’on ne posait pas : « Qui es-tu ? » Mais c’est la question qui est posée aux spectateurs et c’est pour ça qu’on va au théâtre.
- CONVERSATION POUR LE FESTIVAL D’AVIGNON 2008, par Valérie Dréville, Romeo Castellucci, Hortense Archambault, Vincent Baudriller. P.O.L, Festival d’Avignon. ↩︎