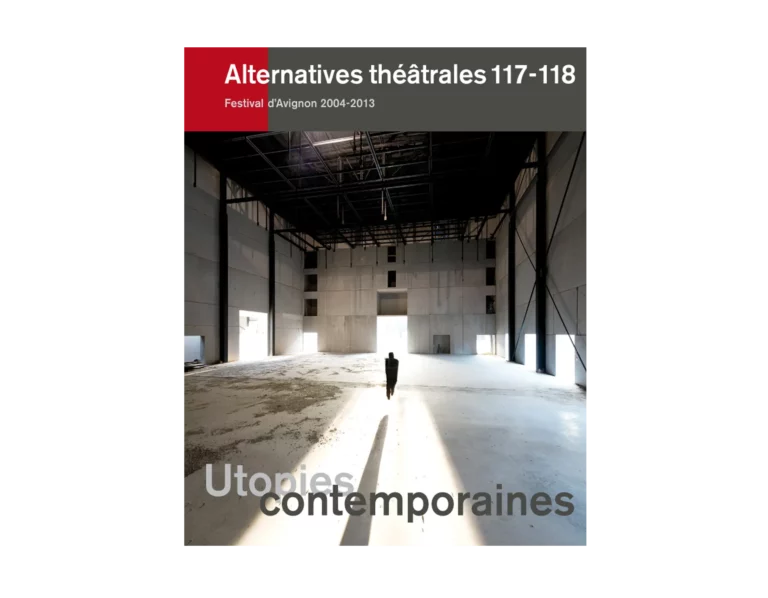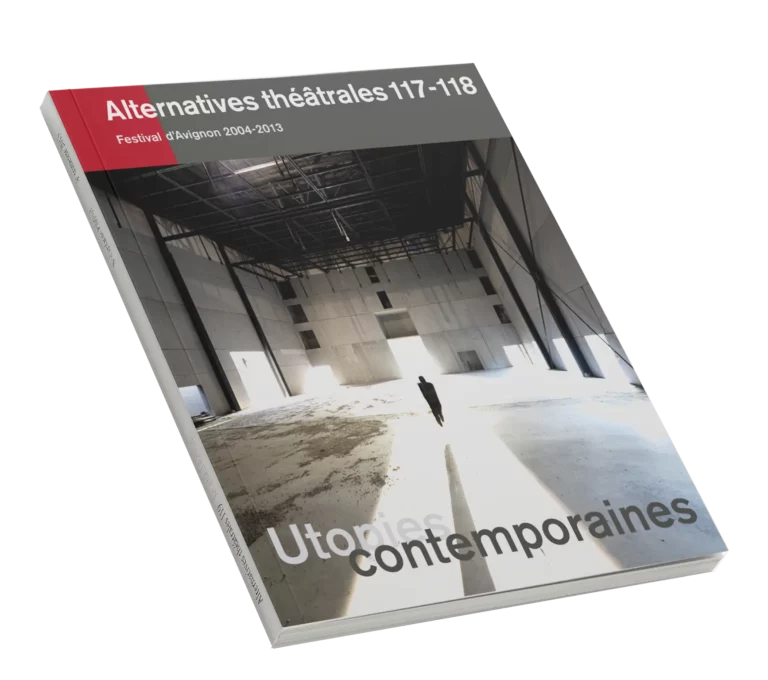CÉCILE SCHENCK : Comment avez-vous été pressenti par Hortense Archambault et Vincent Baudriller pour devenir l’artiste associé de la 65e édition du festival d’Avignon en 2011 ?
Boris Charmatz : À vrai dire, c’est une question qu’il faudrait leur adresser à eux, car je ne peux pas dire comment on est pressenti pour être artiste associé. Le fait que j’aie été nommé à Rennes au Centre chorégraphique national en 2008 pour créer un Musée de la danse, pour réinventer un nouveau type d’espace public pour la danse, pour modifier ce qu’est l’institution du CCN, a certainement pesé dans la décision de Hortense Archambault et Vincent Baudriller. Ils ont eu envie de suivre et d’accompagner cette aventure. L’histoire du théâtre les intéresse, tout comme le fonctionnement des institutions et le fait, qu’en danse, nous essayons d’inventer un musée, qui est a priori antinomique avec l’idée de l’art vivant. Avignon n’est-il pas du reste déjà une sorte de musée du théâtre et de la danse ? C’est également une école d’art parce qu’on vient aussi faire ses classes à Avignon : c’est l’occasion de découvrir plein de choses qu’on ne verrait pas ailleurs. Pour nous, tout cela était lié à l’enfance, à l’apprentissage. Or je fais justement partie d’une génération d’artistes qui a beaucoup travaillé la question de la transmission et de la prise de parole. Cette idée soulevait, aux yeux des directeurs du Festival, des questionnements qui rejoignaient leurs propres interrogations sur les arts de la scène.
C. S. : Quelles difficultés avez-vous éventuellement rencontrées au cours de cette expérience ?
B. C. : Je n’avais encore pour ainsi dire jamais créé de spectacles pour de très grandes salles et de grosses masses de public. Au Festival d’Avignon, en revanche, il y a tellement de monde que l’on peut difficilement se contenter de jouer pour deux cents personnes. Or je n’avais fait que très peu de spectacles pour une grande jauge public jusqu’à LA DANSEUSE MALADE (2008), qui était aussi une exception. Dans un premier temps, nous avions imaginé créer cette pièce à Avignon. Mais ce duo avec Jeanne Balibar, complexe techni- quement, aurait été difficile à mettre en scène en extérieur, notamment à la Cour d’honneur… Et je me souviens aussi, il y a encore plus longtemps, d’une série de projets imaginés avec Angèle Le Grand, que nous avons renoncé à faire ! On peut donc parler de quelques occasions manquées, mais celles-ci ont surtout permis de faire mûrir la réflexion. Et je ne regrette pas d’avoir attendu pour créer ENFANT à la Cour d’honneur.
C. S. : ENFANT a donc été conçu spécialement pour la Cour d’honneur ?
B. C. : Oui. C’est un spectacle qui n’aurait pas existé sans l’association d’Avignon, en raison tout d’abord des moyens considérables alloués aux spectacles joués à la Cour d’honneur : nulle part ailleurs je n’aurais pu remplir une salle de deux mille personnes cinq soirs de suite ! Seul Avignon permet de créer des projets à une si vaste échelle – possibilité que l’on ne m’aurait jamais offerte dans un autre lieu, et que je n’aurais même pas désirée. C’est en ce sens-là que Hortense Archambault et Vincent Baudriller ont pris de vrais risques avec moi, comme
ils en ont pris aussi avec bien d’autres artistes.
L’autre raison pour laquelle l’histoire d’ENFANT est indissociablement liée à l’aventure d’Avignon, c’est que l’idée m’en est venue précisément à la Cour, lors d’une visite. Tout en ayant conscience de sa difficulté, j’aimais beaucoup ce lieu, surtout après avoir assisté à un montage de nuit : une immense grue déplaçait des morceaux de la scène en les faisant voler. Ce temps de montage est presque le plus beau spectacle d’Avignon ! Nous en avons d’ailleurs fait un film, qui a été présenté à l’École d’Art1.