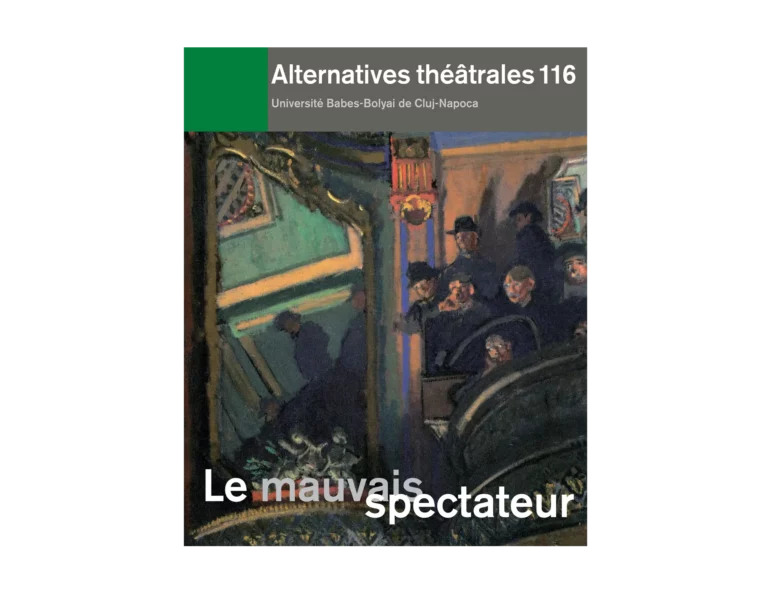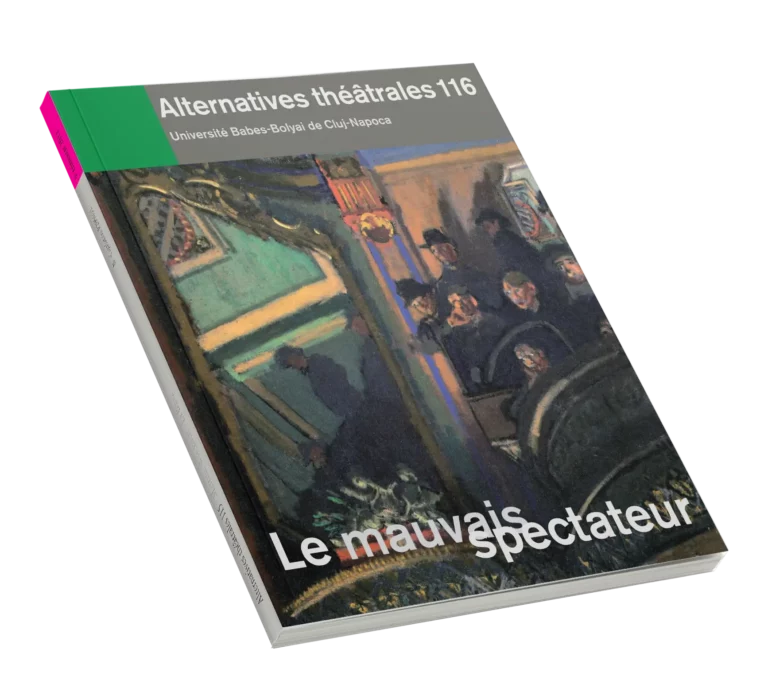LE PROTAGONISTE de cet essai critique pourrait être le spectateur en personne. Je cherche à élaborer un récit interprétatif des différentes façons tantôt contrastives, tantôt complémentaires – de comprendre le public du théâtre, en recourant à une étude de la critique de réception et de ses méthodes souvent controversées. Je cherche à identifier et analyser les distinctions les plus pertinentes entre, d’une part, les modes modernistes de réception du théâtre et, d’autre part, la réception esthétique et culturelle « millénariste » ou, pour ainsi dire, « temporaire-contemporaine » des textes de théâtre et des manifestations scéniques. En exposant d’un œil critique les principaux points polémiques entre ces différents modes de perception du public, on pourrait considérer le problème du statut de spectateur comme un « symptôme » de l’incompatibilité entre divers modèles culturels.
Une étude de la critique (dans le cas présent, la critique et la théorie de la réception) présente généralement le risque d’être une entreprise interprétative morose et austère. C’est pourquoi je recours à ce que j’appellerai des images théoriques, ou modèles figuratifs, qui me paraissent propres à rendre la théorie plus vivante et pertinente pour le lecteur.
Méta-images et métaphores conceptuelles
Il me paraît pertinent d’ouvrir mon propos par une provocation polémique, en fait une paraphrase – « Ceci n’est pas un spectateur » – du texte du célèbre tableau de Magritte, (LA TRAHISON DES IMAGES CECI N’EST PAS UNE PIPE), qui a par la suite bénéficié d’interprétations tout aussi célèbres (mentionnons notamment l’essai sur Magritte par Michel Foucault). Ce tableau de Magritte est une sorte de « métaphore conceptuelle » du processus de représentation en tant que tel, c’est-à-dire du déplacement de cette même représentation. La déclaration négative étrangement catégorique de Magritte – qui peut paraître délibérément absurde ou sérieuse – pourrait servir de figuration d’une notion (en quelque sorte l’opposé de l’ekphrasis), d’un concept fonctionnel, ou d’un modèle herméneutique de réception et d’interprétation de l’art. En effet, on peut y voir une représentation de la façon dont nous, spectateurs, lecteurs ou critiques, sommes appelés par une voix inhérente à l’art et par là-même, invités à ne pas prendre fortuitement l’art pour autre chose, en dépit de ce que pourraient suggérer les apparences. Cependant, bien sûr, on ne nous donne pas la réponse, la clé qui permettrait de déchiffrer son sens quelque peu occulte. Le philosophe de l’art W. J. T. Mitchell appelle méta-images ces images à niveaux multiples qui s’interrogent sur leur nature – et LA TRAHISON DES IMAGES est à cet égard emblématique. Elles pourraient devenir des instruments herméneutiques viables dans l’apparent foisonnement de méthodologies de réception contrastées concernant l’étude des publics du théâtre.
Le paradoxe d’une représentation qui s’attaque à son objet artistique – comme c’est le cas pour Magritte et pour de nombreuses autres œuvres d’avant-garde – a vivement interpellé le spectateur – en particulier ces dernières années, dans les tendances néo-modernistes, néo-avant-gardistes ou postmodernistes. J’élargirai mon propos en reformulant quelques interrogations de la théorie de l’art qui mettent en avant deux façons fondamentales de comprendre le « public » – l’une essentiellement passive, l’autre essentiellement émancipée, active, participative au sein du processus de représentation (que cela implique la représentation en tant que telle, ou la représentation interprétative face à un texte, en esprit et en imagination). Ces appréhensions du statut de spectateur pourraient être analysées distinctement, dans l’intérêt de la cohérence théorique peut-être, mais une interprétation beaucoup plus révélatrice impliquerait de s’intéresser à leur brassage et, parfois, à leur affrontement ou leur collision apparemment inévitables.
Qui est le spectateur (in)approprié d’une œuvre d’art moderne, considérée comme un univers esthétique a priori autonome – et souvent non-mimétique ? D’autre part, qui est le spectateur légitime des œuvres et des représentations « temporaires-contemporaines » transgressives, transesthétiques voire transartistiques ? J’ai décelé, dans de nombreuses théories majeures de réception de l’art et analyses culturelles basées sur la représentation, quelques points contradictoires de tension, quelques symptômes de fissure au niveau conceptuel. En réalité, la théorie de la réception révèle autant les avantages (l’application et l’organisation, pour des raisons heuristiques, de l’interprétation des réponses aux événements artistiques) que les failles et discontinuités de toute théorie liée au caractère varié et aléatoire des réponses empiriques du public.
Les théories modernistes de l’art et de sa réception
Les théoriciens modernistes de l’art, parmi lesquels Clement Greenberg et Michael Fried, défendent un point de vue essentialiste sur l’art, rejetant l’idée selon laquelle un produit artistique doit sa valeur à l’accueil que lui réserve son public. Fried développe une interprétation négative, célèbre aujourd’hui, de « théâtralité », qui a par la suite donné naissance à différentes acceptions de l’œuvre d’art (qu’elle soit une œuvre littéraire, un film, ou tout autre produit visuel), considérée comme une chose intentionnellement « exposée », « comme un spectacle devant des spectateurs »1. L’œuvre d’art doit trouver sa propre « essence » et, ainsi, rejeter la théâtralité, dans la vision qu’en a Michael Fried, afin de rester absorbée en elle-même, dans l’étroite fiction-réalité de la scène, c’est-à-dire dans l’illusion qu’il n’y a aucun observateur extérieur, personne qui regarde l’univers mis en scène de façon resserrée. Le spectateur dé-théâtralisé d’une représentation théâtrale égocentrique, dans le sens où l’entend Fried dans ABSORPTION AND THEATRICALITY. PAINTING AND BEHOLDER IN THE AGE OF DIDEROT (1980), semble être le modèle d’un public approprié. Celui-ci apparaîtrait, conformément au point de vue essentialiste sur l’art, dans une posture passivement contemplative, où le public pourrait apprécier le théâtre/l’art à distance, depuis un lieu apparemment occulte, situé au-delà de la tentation de toute participation au niveau social de la représentation.
Cela signifie que le spectateur d’une production égocentrée pourrait se voir offrir un rôle esthétique défini, équivalent à ce que l’on peut assimiler, au sein de l’acte théâtral, à une position ontologique totalement autre que celle occupée par l’acteur-personnage. Son rôle pourrait être de ne plus être ce qu’il est, un spectateur, mais d’être transporté, ou absorbé ; de plus, ajouterais-je, le spectateur doit subir une rupture, dans sa position et sa subjectivité, entre un égo qui accepte la convention et un autre égo délégué, qui soit transporté dans le « tableau » ou fiction.
J’affirmerai cependant que la puissante métaphore de Michael Fried d’une œuvre d’art autonome devant laquelle le public doit rester silencieux, invisible, sans aucune réaction visible ou perceptible, ne semble pas réellement se prêter à l’appréhension moderniste de l’art et à sa réception spécifique. En fait, c’est précisément l’œuvre d’art moderne qui se révèle le plus souvent autocritique, autoréférentielle, anti-mimétique – et surtout pas paisiblement absorbée dans sa réalité fictionnelle. L’œuvre artistique devient ainsi sciemment théâtralisée. Cependant, le spectateur conserve la distance traditionnelle face à l’œuvre, comme si celle-ci était l’autre esthétique de lui-même. Le protagoniste de l’art moderne demeure l’œuvre même, mais aussi, dans une vision postromantique, l’artiste-démiurge, avec son égo fier, révolté et, par conséquent, créatif. Tout compte fait, on peut y voir une perspective élitiste sur l’art et l’artiste, dérivant d’une mentalité moderne de ce que l’on appelle la culture classique et ses valeurs axiologiques et canoniques.