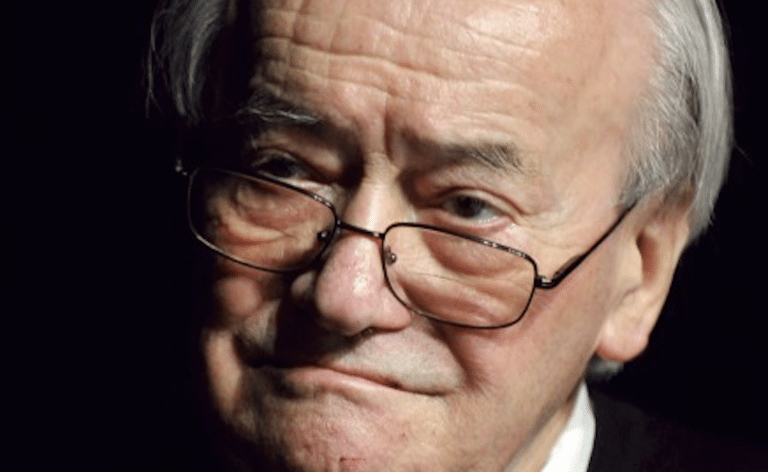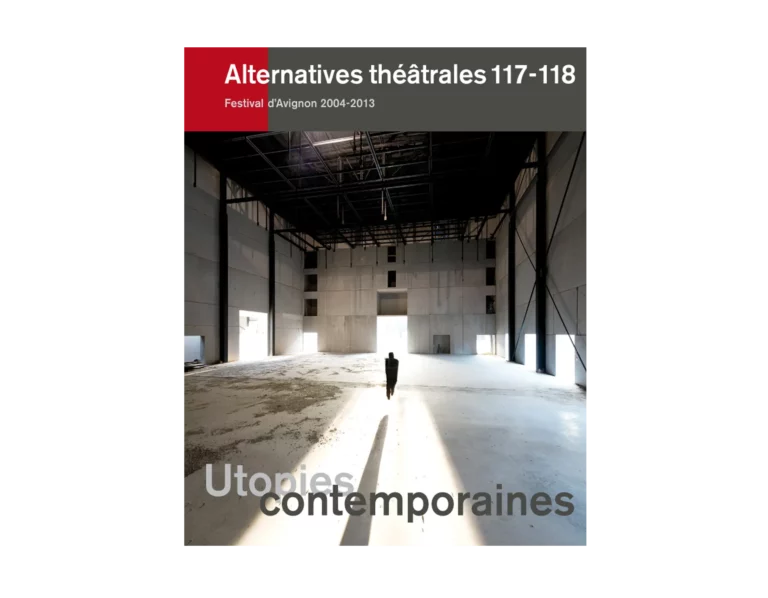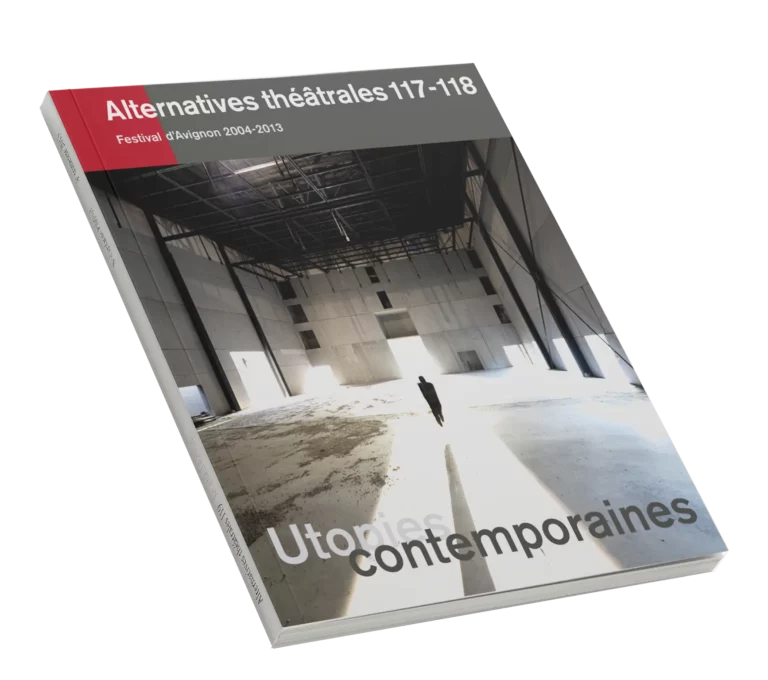À propos des années 1966 – 1967 du festival d’Avignon
par Jack Ralite
C’était le 3 août 1966, dans la Chambre des Notaires juste au-dessus de l’entrée de la Cour d’Honneur du Palais des Papes où Jean Vilar fonda en 1947 le Festival d’Avignon qui dure toujours.
Dans cette Chambre des Notaires, modeste de superficie, pendant cinq jours, de 10h à 13h, en présence de Vilar, une quinzaine de personnes concernées par le théâtre et ses créations se sont retrouvées derrière une table en fer à cheval. Pilotés par Michel de Beauvais, ils « disputèrent de culture » et de l’art du théâtre. Dans le U de la table, deux ou trois douzaines de passionnés de la scène prenaient des notes.
Ce 3 août, j’étais le conférencier, recommandé par Paul Puaux, invité par Jean Vilar, j’exposais la politique culturelle et artistique naissante se développant à Aubervilliers, commune de la banlieue nord de Paris, très majoritairement ouvrière, patrie du mal logement, que Prévert avait révélée à travers un film d’Eli Lotar, commandé par le maire de la Libération, Charles Tillon, commandant en chef des Francs Tireurs et Partisans.
J’ai parlé une heure. Pendant la suspension de séance, Vilar resta assis. « Ralite, c’est bien, peut-être auriez-vous dû ne pas excéder 45 minutes. Mais c’est bien » et – avec l’ironie qu’il avait quand il connaissait – « vous avez fait flotter le drapeau rouge sur le Palais des Papes ». Deux jours plus tard, il m’invitait à refaire cet exposé au Verger.
Les mots ont quelque impuissance à rendre l’atmosphère de ces moments de franchise, de courage et parfois d’insolence. C’était comme une construction qui se faisait et on la vivait, assurés de la mener à son terme, d’autant que le Festival s’interrogeait, et son fondateur le premier. Ce débat et tant d’autres, sur les spectacles, se faisaient la courte échelle et Avignon s’accordait quinze jours de plus, d’autres arts apparaissaient, d’autres lieux de spectacles ouvraient. Vilar entamait sa « perestroïka », sa restructuration.
Dans la séance d’ouverture de cette année 1966, la 3e année de ces premières Assises nationales de la culture, il avait déclaré : « Nous savons bien et n’oublierons pas à quel point les problèmes culturels passent sur le plan national après bien d’autres devoirs ou nécessités civiques et – pour être plus banal, sinon plus clairs– comme quoi la culture vient dans l’ordre des urgences après le fait de nourrir les hommes et de leur donner les moyens de se défendre.
Pacifique, d’esprit comme vous tous, du moins je le suppose, pacifique donc, et même pacifiste, j’admets, non sans de profonds regrets, amères et acides souvent que Colbert et Louvois disposent de cassettes infiniment plus remplies que celles du ministre – je le dis très respectueusement– des menus plaisirs.
Mais justement, depuis 1875, sinon depuis 1793, il ne s’agit plus de menus plaisirs en ce qui concerne « divertissements, loisirs et savoirs » mais de « plaisirs populaires, de loisirs collectifs, de « savoirs de masse ». En ne répondant pas à cette expansion démographique de la culture populaire, il semble que nos multiples Frances républicaines aient conservé quelque nostalgie, regret de nos rois.
« Quoiqu’il en soit – et je ne pense pas être ici irrévérencieux – ce qu’il est très difficile d’admettre désormais, c’est un certain axiome ancré dans bien des consciences de hauts responsables “qu’en France les artistes comme les 2e classes se débrouillent toujours” et donc : « Pourquoi changer ? ».
C’était en 1966 où parallèlement à la dispute vilarienne de la Chambre des Notaires se déroulait une dispute politique sur la liberté de création. Jusqu’ici, l’artiste n’avait pas cette liberté, même si, sous la Révolution, Robespierre l’avait énoncée dans un célèbre discours. Mais en 1966, ce problème de l’art était l’objet d’une dispute politique. Que Rivette ait dû attendre un an pour pouvoir programmer La Religieuse, que Lorenzi se soit vu supprimer La Caméra explore le temps, que Tréhard ait perdu une subvention à Caen parce qu’il ne voulait pas monter Les Cloches de Corneville, que la ville de Bourges ait tenté d’interdire V comme Vietnam à la Maison de la Culture, etc., indique qu’il y a un problème, celui de la démocratie qui doit faire l’expérience de la culture, celui de « passer d’un petit cercle de connaisseurs à un grand cercle de connaisseurs », celui que visait le physicien Henri Poincaré en déclarant : « On fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une maison ».
Dans un côte à côte productif, les artistes comme Vilar et un parti politique comme le Parti Communiste Français étaient sur le même front.
Vilar disait :
« Dès qu’un art se fige, il meurt. »