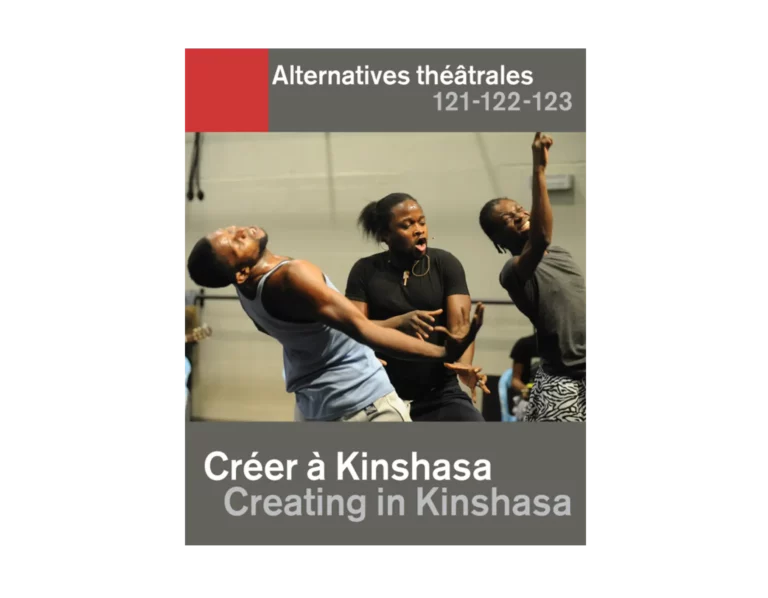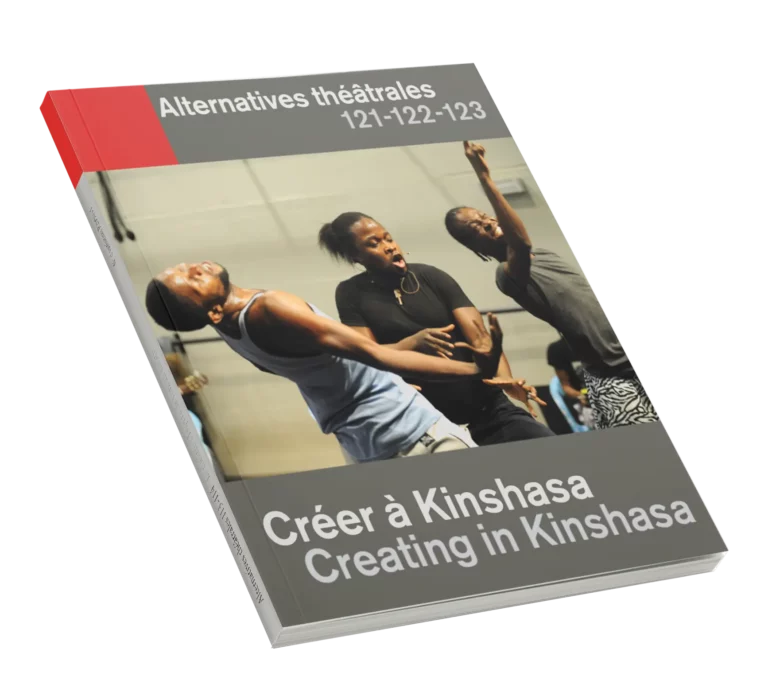Bernard Debroux : Qu’est-ce qui a amené le KVS, implanté dans le centre de Bruxelles, à orienter ses perspectives et son travail vers le Congo ?
Jan Goossens : Le point de départ était la situation dans laquelle le KVS se trouvait vers la fin des années 1990, lorsque la nouvelle équipe est arrivée et a commencé à travailler ici. À ce moment-là, ce théâtre était un ovni à Bruxelles. Un théâtre flamand, pour les Flamands, dans une ville où il y avait de moins en moins de Flamands. Nous venions de déménager à la Bottelarij1, à Molenbeek, et là, le problème de notre isolement est devenu très visible, très sensible : plus de public et plus aucun lien entre le projet artistique et sociétal de ce théâtre et la ville. La nouvelle équipe a proposé au Conseil d’administration de reconnecter le théâtre avec la ville dans sa dimension contemporaine et en même temps avec les arts de la scène contemporaine en Flandre et dans le monde. Pour reconnecter le KVS avec Bruxelles, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas nous limiter à la communauté flamande. Il fallait aussi prendre en compte la communauté francophone mais surtout d’autres communautés issues de l’immigration dont on dit trop facilement qu’elles ne s’intéressent pas à la culture. C’est faux évidemment, mais leur énergie et leur dynamique n’entrent pratiquement jamais dans la vie culturelle officielle. C’est ainsi que nous nous sommes attelés à ce projet de connexion avec les artistes de la communauté congolaise et des communautés africaines de Bruxelles.
À ceux qui nous demandent pourquoi nous avons mis ce projet sur pied, nous expliquons souvent que Bruxelles est en partie une ville congolaise. À cela s’ajoute le rapport à l’Histoire, ce passé que nous avons en commun, le Congo et nous.
À quoi servirait que notre génération se sente coupable ? – nous portons peu de responsabilité pour tout ce qui s’est passé avant 1960 ; il s’agit de saisir l’opportunité de développer d’autres relations plus équitables.
Une de nos premières productions pour ce projet fut La Vie et les œuvres de Léopold II de Hugo Claus, mis en scène par un de nos jeunes metteurs en scène, Raven Ruëll. Peter Sellars, le metteur en scène américain qui était et qui est une sorte de conseiller pour nous, et avec qui nous avions parlé de ce projet de mise en scène, nous répondit que c’était sans doute une bonne idée, mais qu’il s’agissait d’un texte écrit par un auteur blanc qui se sent coupable. Il lui semblait qu’il fallait aller au-delà de cette démarche et entrer en dialogue avec des artistes de la communauté congolaise et de la communauté africaine.
Nous nous sommes très vite rendu compte que nous ne les connaissions pas et avons donc décidé d’engager Paul Kerstens, pour développer les contacts avec plusieurs artistes bruxellois d’origine africaine. Ensuite, en 2005, grâce à l’obtention de nouveaux moyens financiers pour travailler sur le plan international, nous sommes allés à Kinshasa, pour voir s’il était possible, en tant que théâtre flamand, de développer des activités là-bas aussi.
B. D. : Quelle est la méthode que vous avez choisie pour réaliser cet ambitieux projet ?
Paul Kerstens : Au moment de la création de Léopold II nous nous sommes tout de suite dit qu’il ne serait pas très intéressant de demander aux artistes africains de faire une sorte de réponse au spectacle et au texte de Hugo
Claus, mais que l’on pourrait inviter des artistes à discuter ensemble. Il n’y avait pas de véritable « communauté artistique africaine ». De nombreuses questions sont alors apparues. Qu’est-ce qui est spécifiquement africain ? Est- ce une question de couleur de peau ? Cela a‑t-il un sens, un contenu artistique ? C’était la première fois que l’équipe du théâtre se confrontait à ces questions et à la variété des opinions qui se cachent derrière cette idée d’artiste africain.
Nous sommes allé à la rencontre des artistes de Bruxelles, et aussi de Liège, sans penser tout de suite à l’idée d’une création. Le projet, c’était de se rencontrer, de discuter, d’enrichir les échanges, sans idées préconçues, sans plan global en tête.
J. G. : Nous nous disions que s’il y avait des dynamiques à capter nous allions les capter et nous avons donné un nom à ce groupe de travail informel avec ces artistes d’origine africaine : Green Light. C’est le titre d’une chanson de Ray Lema, très simple et très belle, où l’artiste demande : « donne-nous le feu vert », « ouvre les portes ». L’univers et les mots de la chanson correspondaient vraiment à notre démarche.
Nous avons tout d’abord constaté qu’ils ne connaissaient pas le KVS, et au-delà du KVS, qu’ils connaissaient très peu la scène flamande, et même, que bien souvent, ils ne se connaissaient pas non plus entre eux. C’était pour nous une sensation étrange : ils étaient une quinzaine, et se parlaient pour la première fois.
P. K. : Ensuite, nous avons mis sur pied des ateliers. Si c’était intéressant et passionnant de discuter ensemble, nous avions face à nous des artistes qui avaient envie de pratiquer leur art et nous voulions travailler avec eux. Nous les avons donc mis en relation avec le metteur en scène Raven Ruëll. Il ne s’agissait pas de réaliser un spectacle au sens habituel du terme, mais de présenter par des « interventions » le groupe de travail Green Light, sa composition et sa diversité. Cela a débouché sur un petit festival.
Nous avons repris cette méthode de travail lorsque nous sommes allé à Kinshasa. Pas de projet définis au départ, mais développer des contacts, notamment avec deux artistes qui sont toujours des références pour nous aujourd’hui, Djo Munga et Faustin Linyekula, découvert dans Festival des mensonges, en janvier 2005.

J. G. : L’essentiel était que l’approche ne soit pas institutionnelle, ni étatique, ce n’était pas de la diplomatie culturelle. Ce qui nous intéressait c’était de rencontrer des artistes qui travaillent dans le contexte d’une ville, à la fois très éloignée du point de vue géographique et en même temps toute proche (Kinshasa comme partie intégrante de la ville dans laquelle nous travaillons, Bruxelles). Nous voulions associer ces artistes au projet global à partir duquel la programmation du KVS se construit.
D’abord avec les artistes qui vivaient à Bruxelles. Souvent, ils habitaient à cent mètres du KVS mais ne nous connaissaient pas et nous ne les connaissions pas. Ils n’avaient jamais eu de raisons de s’identifier au KVS. Il s’agissait de leur dire : vous faites partie du dialogue qu’on veut mener avec les artistes de cette ville. On écoute, on vous écoute.
- Durant les transfor- mations du KVS (Théâtre Royal flamand) l’équipe s’est installée dans une ancienne bouteillerie à Molenbeek, quartier populaire de Bruxelles. ↩︎
- Performing Arts Research and Training Studios, école de danse contemporaine fondée à Bruxelles en 1995 par Anne Teresa De Keersmaeker. ↩︎
- Organisation non gouvernementale belge née du Centre national de la coopération au développement qui mène un combat pacifique contre les situations d’exclusion et de pauvreté. ↩︎