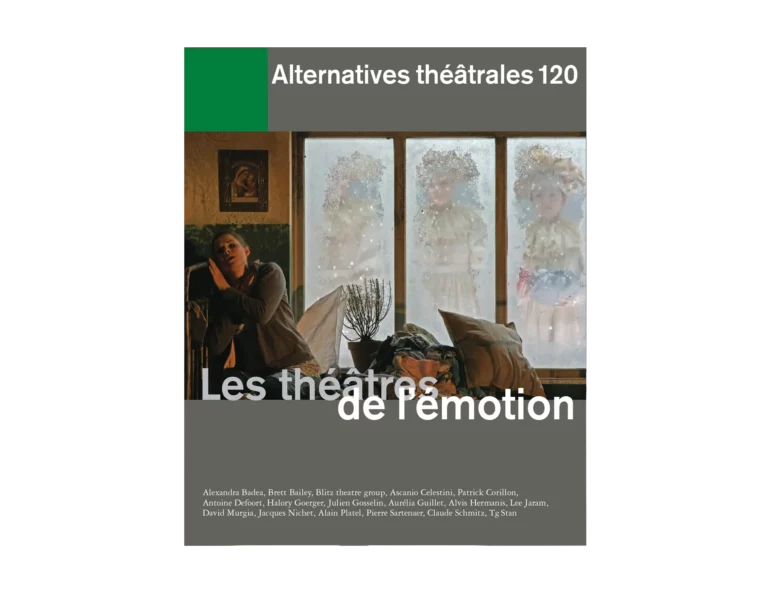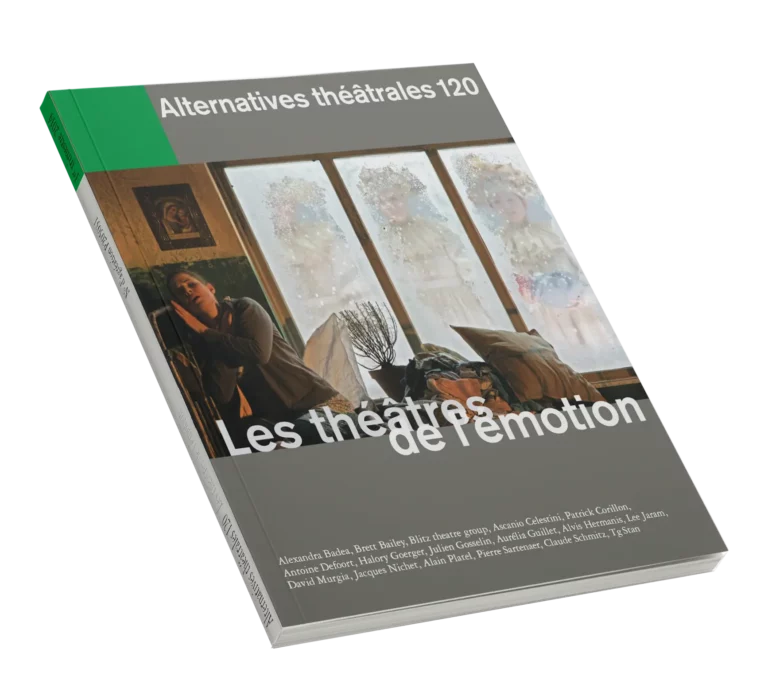Où sont « les alternatives » d’antan…, ainsi pouvons-nous paraphraser le vieil adage sur fond de mélancolie soutenue par un espoir qui semble être aujourd’hui abandonné. Kantor, il y a quelques années, l’avait repris également lors d’un de ses spectacles inclassables, spectacle fuyant comme le mercure entre les doigts. En le voyant à Beaubourg, avec Bernard Dort, je l’ai surpris en disant : « Kantor se fait vieux ! ». Aujourd’hui quand j’égrène les mêmes lamentations je me le rappelle et je me vois assigné à m’appliquer le même diagnostic. Une interrogation s’immisce pourtant : « les alternatives » manquent-elles vraiment, ou suis-je moi-même devenu inapte à les saisir ? Il n’y a pas d’accueil du nouveau sans regard nouveau. Il n’y a pas de nouveau que l’on saisit lorsque la mélancolie s’installe et « les neiges » ne fondent pas. Et pourtant l’Angelus novus de Klee, emblème de Walter Benjamin, avance en reculant, les yeux dirigés vers le passé qu’il considère non pas comme terre de nostalgie mais comme étendue à explorer encore pour des aventures à venir. Si je me trouve orphelin de l’ancien pouvoir d’émerveillement, il me reste encore le pouvoir de répondre à ce qui émerge d’inédit à partir du legs qui perdure. Angelus novus ne cherche pas les accomplissements « d’antan », mais envisage un usage fécond du passé non épuisé. Cette conviction s’empara de moi plusieurs fois dans la vie, lors des rencontres imprévues, étonnantes et déroutantes, entre l’Orient ancien et « la Vieille jeune Europe », comme l’appelait Derrida. N’ai-je pas écrit mon premier texte dans Alternatives après l’éblouissement devant Kazuo Ohno, le maître de Butô qui dansait pour préserver les souvenirs d’Argentina, la star espagnole qui l’avait fasciné dans sa jeunesse ? « Alternative » inoubliable… Des déceptions rencontrées sur la même voie s’en suivirent ensuite, surtout procurées par un travail d’hybridation précipitée entre la tradition scénique de l’Asie et l’héritage du répertoire occidental, Le Roi Lear, Macbeth… Il y eut aussi des éblouissements : Mnouchkine imagina ses Shakespeare déployés comme des paons polychromes sur la scène française placée sous le signe du gris « brechtien » dans les années quatre-vingt, récemment, je découvrais à Sibiu (Roumanie) le Japonais Yasuda qui signait un Titus Andronicus tout de blanc vêtu, couleur du deuil oriental, sans sang ni effusions cruelles, dansé, maîtrisé, cérémonie laïque où les corps préservaient entre eux une distance secrète, jamais franchie, où les paroles étaient de feu et les gestes de glace. Ou encore un Hamlet mis en scène par Yoshihiro Kurita où le Prince, comme dans un nô moderne, se trouvait érigé en waki, l’homme du coin, qui se rappelait son parcours, qui revivait, sur le mode mémoriel, sa destinée tragique.
Pourquoi ce prologue ? Pourquoi ne pas débuter d’emblée ? Pour se conforter dans l’idée que le miracle n’est que rarement unique dans la vie d’un spectateur et qu’une succession, plus ou moins espacée, d’événements, relance, régulièrement, la foi. Et pareil à l’ange benjaminien ils assurent l’avènement de l’ancien sur un plateau contemporain dont je suis le témoin séduit. Comme dans la soirée vécue au théâtre hongrois de Cluj-Napoca en Roumanie lors d’une Mère Courage unique, présentée dans le cadre du festival Interférences.
D’où provient l’étonnement ? D’abord du fait que le récit se trouve intégralement pris en charge par une seule interprète, formée à la dure école du genre traditionnel coréen, le pansori, que certains ont découvert dans sa splendeur sonore soit à la Maison des Cultures du Monde, soit dans un spectacle de théâtre équestre, Éclipse de Bartabas. Les chanteuses, pour élargir leur registre et parvenir à une profondeur introuvable ailleurs s’exercent dans des forêts près des chutes d’eau en engageant avec elles, sans transiger, une compétition sévère jusqu’à ensanglanter leurs cordes vocales. Le pansori exige un corps hors-normes, une voix qui bascule du murmure aux cris rugissants, des soupirs aux déplorations pathétiques, une voix de l’excès. En voyant la belle Lee Jaram, l’impression de la démesure vocale qui s’est emparée de moi dans les occasions évoquées se tempère, elle privilégie le voyage inlassable d’un registre à l’autre mais dépourvu de tout effet performatif flagrant. Sa voix renvoie au fameux parlarcantando recherché par Monteverdi, trahi ensuite par les volutes déployées du chant lyrique, et retrouvé aujourd’hui ici ou là, chez Marthaler en particulier, par le passage de la parole aux chants.
Brecht, en 1935, éprouvait le choc de l’acteur chinois Mei Lanfang, acteur qu’il assimila au modèle de l’acteur épique révélé dans les salles de démonstration moscovites. La théorie brechtienne se trouve confortée dans ses voeux restés jusqu’alors incertains. En suivant Lee Jaram je ne cessais pas de penser à Brecht et cela pas seulement parce qu’elle jouait une de ses pièces. La jeune coréenne se chargeait des pouvoirs de narration tant souhaités par Brecht : elle racontait tout en insérant, de manière parcimonieuse, de brefs instants d’identification. Elle racontait tout, à l’orientale, non seulement le parcours de Mère Courage mais aussi les paysages dévastés par la guerre, les corbeaux qui coassent et les chariots abandonnés, la destruction humaine et la vanité militaire. Le spectacle prenait une allure romanesque et renvoyait même au modèle initial dont Brecht s’est inspiré : La Vagabonde courage de Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. Jamais, au théâtre, la nature, grâce aux seules paroles, ne se constituait pas plus en cadre général permettant à la comédienne-danseuse de décliner les personnages tantôt évoqués, tantôt dessinés comme dans un conte qui ne restitue que des bribes de vie et des éclats de biographie.