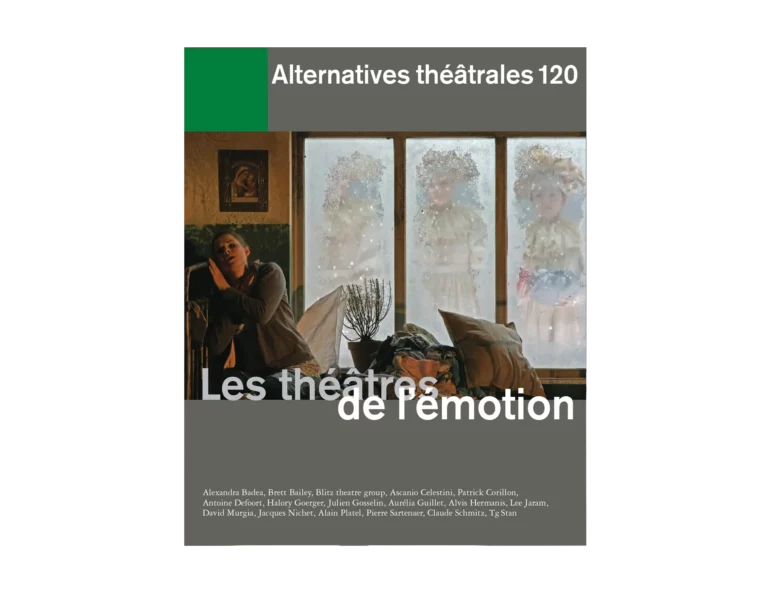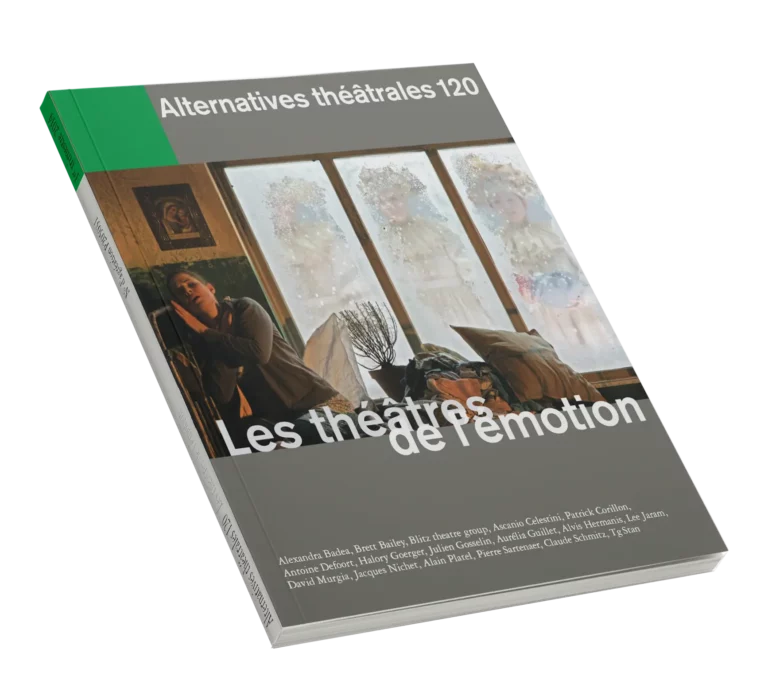ASSIS SUR DES CHAISES posées sur des gravats, ils regardent le public prendre place, semblent attendre, l’air passablement inquiet, le visage grave, vaguement abasourdis. Ils sont six, trois couples d’hommes et de femmes, d’une même génération, alignés en fond de plateau devant un espace vide déblayé des gravats amoncelés sur le pourtour. Ils ont des postures diverses, parfois, l’un ou l’autre rentre en lui-même, pose la main sur ses yeux ou traverse le plateau pour boire un verre d’eau posé sur une table. Le temps s’étire : ils nous regardent et nous les regardons comme si cette relation fondatrice du théâtre allait redevenir ici essentielle.
Et puis la musique commence, une valse plutôt lente, un couple se met à danser, les autres le regardent vaguement. Mais, irrépressiblement, les corps sont entraînés et tous se mettent à valser sur cet espace entouré de décombres, dans ce moment que l’on sent incertain, marqué par la guerre et la destruction. Un contexte suggéré par la scénographie, l’éclairage et les attitudes des corps venant renforcer l’impression de gravité, de lourdeur, celle d’un temps d’après la catastrophe.
Nous regardons ces corps danser, emportés comme malgré eux, sans joie mais animés par la musique, happés par son mouvement, par le rythme profondément nostalgique de la ritournelle. Ils tournent sur eux-mêmes avec virtuosité, repassent chaque fois au même endroit, enclosent l’espace, la piste de danse circonscrite aussi par les gravats, les chaises, une table, l’un ou l’autre accessoire et par le public du côté du quatrième mur. La valse est une danse de salon, elle appartient à un milieu, elle en réfracte les codes. La précision des pas, les trois temps du tempo, le couple, les corps, légers, qui semblent échapper aux lois de la gravitation mais sont tout entiers mobilisés afin de ne pas se heurter et sans cesse règlent la distance entre eux, disent les limites dans lesquelles se déployer. Il n’y a pas d’au-delà. La valse est un exutoire réglé, elle n’offre pas d’échappatoire à un monde barré de frontières, elle permet de l’exalter ou de le supporter. La valse magnifie et enchaîne tout à la fois, dans un mouvement contradictoire, entêtant et fascinant. Elle aliène plus sûrement par cette double nature, requérant le corps et l’esprit en vue de la circonvolution autour d’un centre imperceptible ou inconcevable. La valse est un plaisir pervers qui ne laisse pas le temps de pénétrer sa perversité, elle entraîne le corps et soustrait l’esprit. Rien ne s’oublie, rien ne s’efface, au contraire, mais tout se liquéfie à force d’être repris à l’identique, repassé, rappelé, tourné et retourné.
Devenue emblématique de la bourgeoisie avec les Strauss à Vienne au 19e siècle, la valse est la forme de l’enfermement dualiste d’un monde bourgeois qui se souvient des ballets de cour, mais glisse et ne saute plus. Et les valseurs glissent, offrant alternativement tous les angles de leur corps aux regards, avidement regardés, livrant en spectacle, avec eux-mêmes, leur milieu et leurs valeurs. Ils diffusent l’image de l’harmonie, celle du couple, et de la maîtrise qui ne laisse pas de place au hasard ni à l’improvisation. La valse est un signe de reconnaissance, on l’a apprise ou non, et maîtriser ses pas indiquera longtemps une « bonne éducation », voire une appartenance sociale. Ceux qui ne la savent pas la reconnaissent néanmoins et regardent, passifs et admiratifs, immobiles et à la fois transportés par ce mouvement circulaire qui ne va nulle part. Qui semble n’être que brillance et pur divertissement, pouvoir de détourner des préoccupations et de créer une parenthèse dans le cours de la vie.
Aussi, quand la culture populaire de masse s’approprie la valse, celle-ci se connote-t-elle puissamment de nostalgie, dimension exclusive d’un mouvement giratoire rapporté à l’amour et à la psychologie amoureuse, sources uniques d’un bonheur mythifié. Un bonheur sans cesse avorté, creuset sans fond de larmes, de regrets, de questions, et qui semble inéluctablement mettre en faillite la réalisation de soi. C’est qu’à l’époque bourgeoise, le dualisme de l’individu privé et du monde social formait une véritable dynamique, un système organisant une conception équilibrée de l’homme et du monde. Quand la valse se propage dans la culture de masse, les valeurs qu’elle impliquait, la relation entre l’homme et la société qui la sous-tendait, ne peuvent plus être dynamiques. Le monde apparaît dès lors lointain, comme extérieur à l’individu, il tend à se neutraliser, à l’image d’un décor, d’une toile de fond devant laquelle glissent les individus.
LATE NIGHT, le spectacle du Blitz Theatre Group, s’inscrit précisément au cœur de ce rapport problématique entre l’intime et l’Histoire. Ce collectif théâtral grec, fondé en 2004, par Giorgos Valaïs, Angeliki Papoulia et Christos Passalis semble s’être donné pour enjeu, dès son premier spectacle MOTHERLAND (2006), de dire le monde tel que le percevaient ces artistes issus d’une même génération (ils ont entre 35 et 40 ans) et inscrits dans un contexte de crise économique. Mais commencer à créer dans la deuxième moitié des années 2000 implique d’être rapidement confronté à une série de crises économiques (bancaire, financière…) dont les ficelles sont si grosses – comme on dit au spectacle – qu’on ne peut que se retrouver abasourdi d’en être affecté. Peut-être cette consternation est-elle à l’origine de la démarche du Blitz Theatre Group, une démarche qui s’attacherait d’abord à une mise à plat des façons éprouvées de concevoir notre société européenne (cf. leurs spectacles GUNS ! GUNS ! GUNS ! ou GALAXY).
Le regard ébahi génère le besoin de poser des questions, de chercher. Au théâtre, cela suppose de renouveler les façons d’appréhender le monde, ce qu’on appelle communément les formes. Le parallèle avec la méthode brechtienne s’impose mais à la différence de Brecht et de son théâtre, ici, nulle alternative ne se profile.