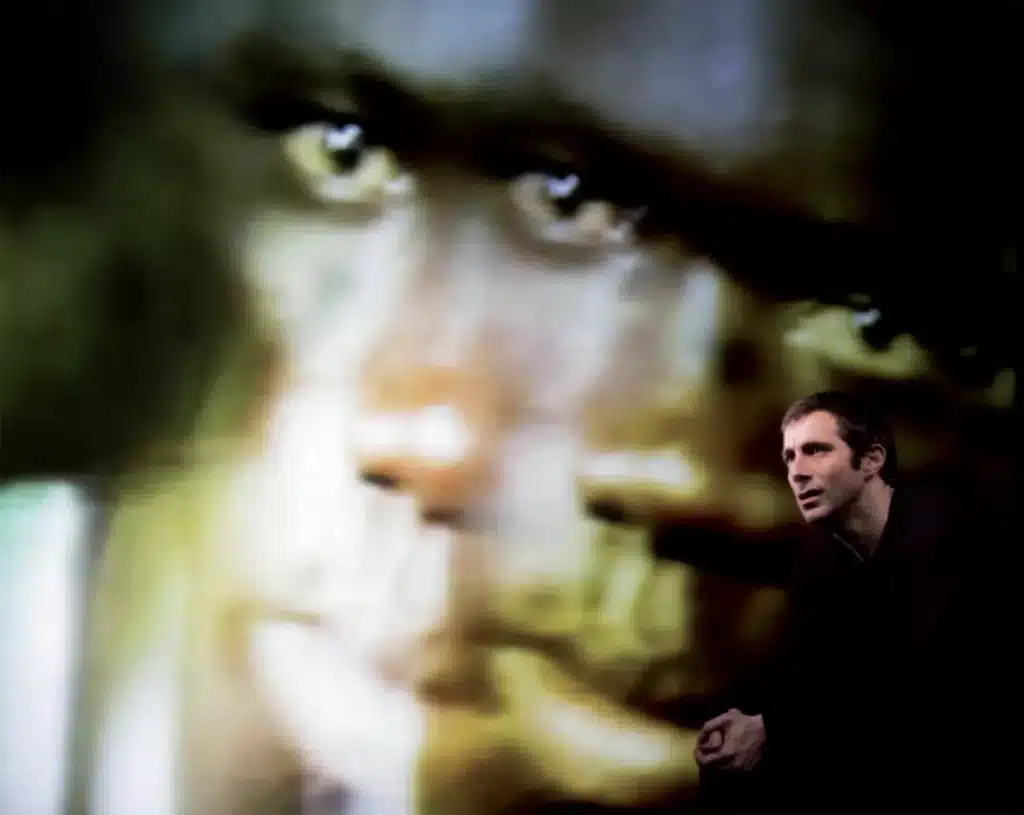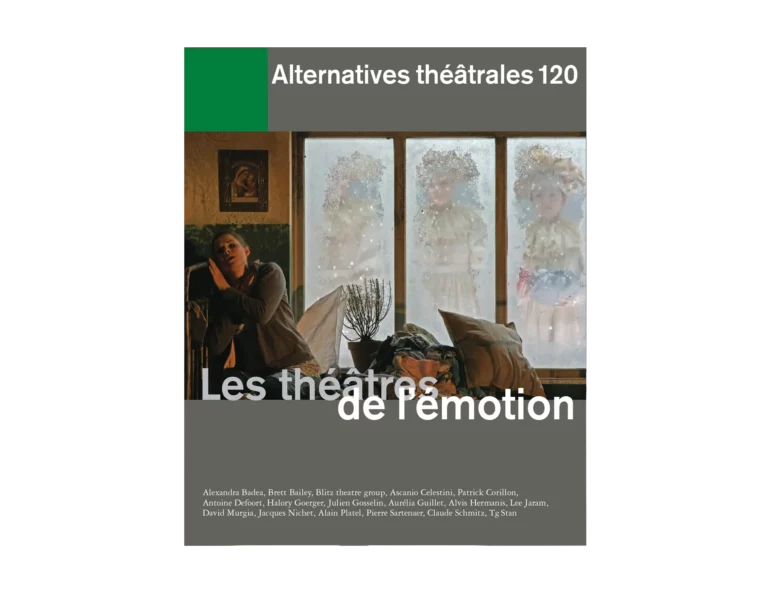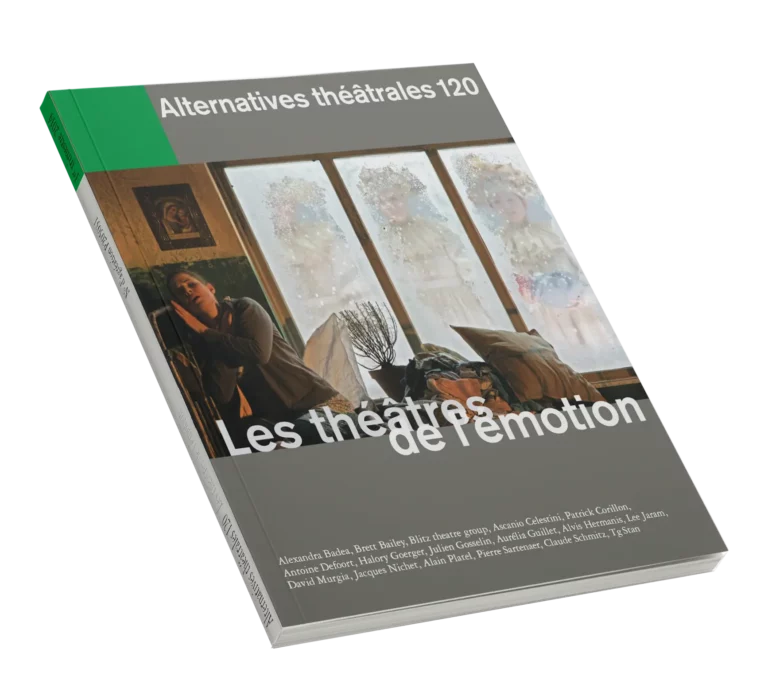« Tu te dis si c’est pas toi ça serait un autre
Et que 900 yuans par mois c’est mieux que rien
Et qu’un circuit sur quatre-vingt est hors normes
Et que c’est pas toi qui as fait le monde
Et que c’est pas toi qui établis les règles
Et que c’est pas toi qui es coupable
Et que c’est pas toi le responsable de tout ça »
« Tu bouges dans ton fauteuil sans arriver à t’endormir. Tu feuillettes un article au hasard et tu lis Ouvrière textile en Inde le pire job du monde.
Et tu vois une femme endormie sur sa machine à coudre, et une autre attachée à des perfusions.
Et tu lis (…)
Et tu lis encore (…)
Et tu balances ta revue et tu te dis : Jamais de sous traitants en Inde.
Et tu vas aux toilettes et tu te laves le visage et tu te brosses les dents car bientôt L’Étude technique de Bucarest va commencer. »
« Tu vois tout ce que tu as vu sans vouloir le voir, tu vois tout ce que tu as fait semblant de ne pas voir, tu vois tout ce qu’on t’a interdit de voir, tu vois tout ce que tu diras n’avoir pas vu. »
Deux acteurs — un homme, une femme (Stéphane Facco, Agathe Molière) ; quatre personnages — deux hommes, deux femmes —, quatre photos qui se forment et s’installent pour leur donner un visage sur les deux vastes écrans qui constituent la scénographie du spectacle : quatre personnages dont les deux acteurs se font alternativement les voix — voix elles-mêmes traversées par, ou dialoguant avec, d’autres voix, et sons. Voix intérieures et extérieures à la fois, corps et voix intimes même si déjà légèrement décollés, étrangéifiés par l’usage du micro HF, à la fois comme absorbés par l’ombre et s’en détachant dans un subtil travail de lumière où le contre-jour domine et qui fait de l’espace dans lequel se trouvent les corps parlant à la fois un espace de disparition et un espace mental, pris entre conscience et inconscience. Sous les regards vivaces des images fixes, suspendues en plein mouvement et en pleine vie, qui leur donnent identité et singularité — en regard de ces regards —, Stéphane Facco et Agathe Molière incarnent ce processus d’étrangeté à soi-même que l’on nomme aliénation. Et nous, spectateurs, nous y trouvons véritablement confrontés — dans le même va-et-vient entre distance et pénétration, non pas dans le confort d’un surplomb en fin de compte indifférent mais face au processus même de destruction du sujet que peut produire le travail et sa division mondialisée : dans l’interpellation active que constitue le fait d’être à la fois devant et dedans l’enjeu humain d’une telle aliénation à l’œuvre. Toute la réussite et la force du dispositif, de la mise en scène et de la direction d’acteurs de Pulvérisés par Aurélia Guillet et Jacques Nichet (avec Philippe Marioge pour la scénographie, Nihil Bordures pour la création musicale et sonore, Jean-Pascal Pracht pour les lumières, Mathilde Germi à la création vidéo) est dans cette capacité à rendre sensible une telle expérience, à faire entendre et résonner le texte d’Alexandra Badea dans ce qu’il a de plus fort en manifestant la densité humaine de ces paroles en cours de désingularisation ; et à faire ainsi que, ni constat dénonciateur qui ne mange pas de pain1 ni anecdotisation pittoresque, mais plongée au cœur même de ce qui se joue dans les êtres, cette manifestation de la déshumanisation libérale contemporaine ne nous glisse pas sur les plumes, comme une page de journal que l’on refermerait pour, après un bref soupir impuissant, passer à autre chose.

Photo Franck Beloncle.
Ce sont quatre monologues, qui se succèdent et alternent, que présente la pièce d’Alexandra Badea, saisissant au présent les pensées et sensations de quatre personnages aux prises avec le sentiment d’étrangeté à soi-même, le processus d’aliénation et de déshumanisation du travail de l’entreprise globalisée. Deux « H » (hommes) et deux « F » (femmes) déjà privés de dénominations autres que l’appellation technocratique de leurs fonctions : « Responsable Assurance Qualité Sous-traitance Lyon H », « Ingénieur d’Études et de développement Bucarest F », « Superviseur de plateau (Team-leader) Dakar H », « Opérateur de fabrication Shanghai F ». Ils participent sans se connaître, aux quatre coins de la planète, de la même chaîne de conception, de fabrication et de vente d’une grande entreprise de télécommunication, pris dans une grande machine où ils ne sont que des petits points et des fonctions objectivées et impersonnalisées. Derrière deux d’entre eux (les Occidentaux : la Roumaine et le Français, qui, à la différence des autres, voyage de pays en pays, d’escale internationale en escale internationale, au point d’être comme dans un jetlag perpétuel), une famille — modèle, conventionnelle — et des crédits à rembourser ; derrière les deux autres, des dortoirs, des employés qu’ils recrutent et exploitent (le Sénégalais), ou d’autres ouvrières à la chaîne avec lesquelles, après les longues heures de travail mécanique, on danse parfois pour oublier le vide et libérer les corps et les esprits épuisés (la Chinoise, seize ans). Et dans les paroles et le quotidien de tous, l’artificialité ravageuse des mots et du langage de l’entreprise et du management, les instruments techniques de communication à distance et de contrôle qui relient les êtres dans la séparation : webcams, caméras de surveillance… Et quelques rêves ou fantasmes, formatés ou non, comme échappatoires.
La singularité du texte d’Alexandra Badea est de faire parler ces personnages à la deuxième personne du singulier, et de saisir ainsi leur perception (des choses et des situations, de leurs réactions à celles-ci, d’eux-mêmes) dans un présent perçu comme extérieur mais pour autant sans distance : « Tu ouvres les yeux / Paupières lourdes / Ton corps glisse sur le drap / Contraction du grand adducteur / (…) Tu ouvres les yeux et tu les refermes / Agression de l’environnement / L’odeur du lit ne t’appartient pas / Rien ne t’appartient ici / (…) / Paumé dans un décalage horaire improbable tu allumes la télé », débute ainsi, par exemple, le Responsable Assurance Qualité sous-traitance, se réveillant dans une chambre d’hôtel internationale qu’il n’identifie d’abord pas. Une telle description ne serait que clinique, n’était justement ce « tu », les sensations, et le décalage que ces récits monologués expriment entre la survivance d’une conscience et d’une individualité et la déshumanisation produite par l’isolement et le fait d’être pris dans le cycle infernal de la division du travail moderne, ses critères froids et sa langue factice.