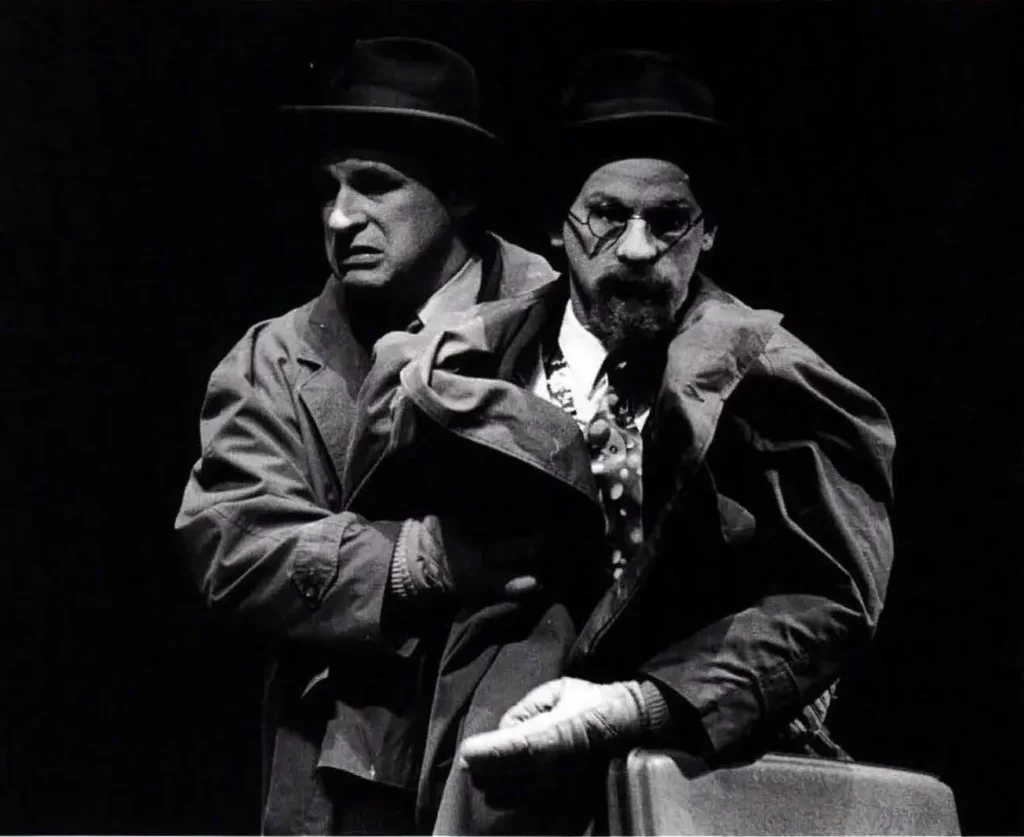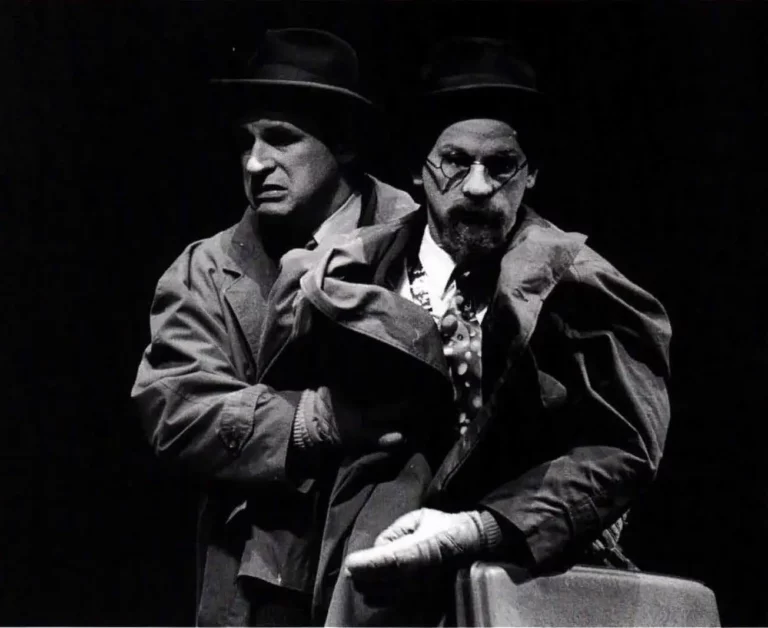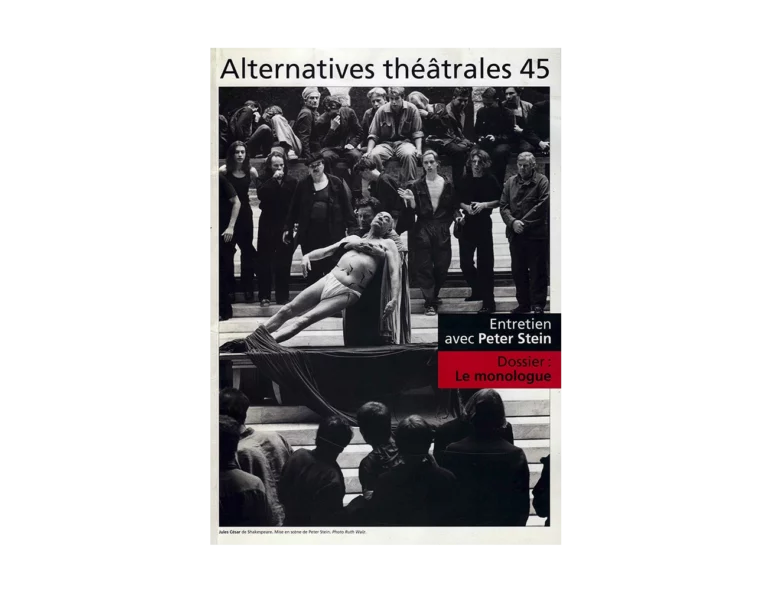DANS le théâtre français de la fin du vingtième siècle, le monologue est d’un usage courant. Bon nombre de dramaturges contemporains y ont recours. Qu’est-ce qui les pousse vers cette pratique ? L’écriture monologique se différencie-t-elle à leurs yeux de l’écriture dialogique ? Et de quelle façon ? Cinq dramaturges, cinq ciseleurs de monologues — Enzo Cormann, Eugène Durif, Jean-Marie Piemme, Serge Yalletti et Valère Novarina — tentent de baliser cet atypique territoire dramatique.
Cormann
Faiseur et adepte de monologues Enzo Cormann ? Gageons que le terme ne le satisfera pas ! De cette écriture-là, il parle comme d’une « forme de faiblesse à laquelle il faudrait savoir ne pas céder » et avoue avoir abandonné de nombreuses illusions à son égard. Il ne considère pas que le monologue soit du théâtre… au point qu’il n’envisage plus d’écrire pour une voix seule ! Pourtant, il est l’auteur — ancien, s’empresse-t-il de préciser — de CREDO et du RÔDEUR, régulièrement joués. D’où vient son actuelle défiance ? De ce que le monologue fonctionne en circuit fermé. Il est une machine célibataire, donc anti-théâtrale à son avis. Tout événement scénique fictionnalisé ne procède-t-il pas en effet de l’échange ? « Le théâtre commence à partir du moment où deux personnages se parlent et définissent ainsi un espace, produisant un événement auquel le spectateur assiste en temps réel.» Le monologue — on n’y échappe pas — pose le double problème du rapport à l’autre et du statut de la parole. Pourquoi quelqu’un, soudain, se met-il à énoncer à voix haute des mots ? « Le monologue n’est concevable qu’à partir du moment où on cesse de biaiser l’adresse directe au public. Et dès lorsqu’on écrit un discours prononcé par une personne publiquement, il n’y a aucune raison de conserver la convention du quatrième mur, parce que le statut même de la parole le fait dans ce cas voler en éclats. Le statut concret de la parole oblige l’acteur à une confrontation avec le public.» Enzo Cormann estime qu’il ne peut y avoir de fiction dans l’espace que si le public lui-même est pris dans cette fiction. Voilà pourquoi il a délaissé le monologue et lui a substitué ce qu’il nomme des dits. Ceux-ci interfèrent avec des musiques — l’auteur s’est associé à des musiciens de jazz — et sont conçus dans un souci de mise en bouche : ils sont travaillés par l’oralité.
« Entre deux constructions de phrases, c’est l’oreille qui tranche. Je suis obnubilé par le son qui sera produit. J’élabore une partition sonore.»
Ces dits sont faits pour être récités et proférés. lis interrogent par conséquent la pratique théâtrale.
« Quand je donne un « concert » avec un orchestre, je suis fasciné par la capacité d’attention et d’écoute des gens. On leur offre un récitatif, un oratorio. Il s’avère à mes yeux que ce rituel est le seul capable d’assumer une parole solitaire. Il se passe là quelque chose d’essentiel et je suis très attaché à ce côté archaïque. Des gens font le choix de venir entendre une parole dépouillée de tout artifice qui leur est simplement adressée, de venir entendre quelqu’un qui active leur subjectivité. Pourquoi se déplacent-ils ?Cela répond chez eux à un besoin profond de singularité.» Une singularité qui s’affirme en total porte à faux avec les pratiques hautement médiatiques de notre époque. Et qui s’oppose au soliloque de la machine célibataire. Les dits nous invitent au contraire à un effet de gros plan qui « induit, la confidence, le secret partagé, à condition que la communication se fasse en vérité, c’est-à-dire exempte de dispositifs boursouflés. »
L’état du dispositif ? Il est prioritairement entre les mains du metteur en scène dont Cormann attend, avant tout, qu’il accompagne l’acteur avec une totale humilité. Que lui demande-t-il ? D’une part, qu’il défasse le monologue, en d’autres terme que la scène crée un statut à la parole là où auparavant il n’y en avait pas et, d’autre part, qu’il trouve les solutions scéniques les plus simples et les plus directes possibles.« Qu’il aille vers le minimalisme - occasion de mettre le théâtre à plat — et non pas qu’il s’encombre de décors inouïs qui nient éperdûment la présence du public. Il devrait savoir retrouver le presque rien, l’événement dans toute sa fragilité.» Cette fragilité souhaitée ne sera-t-elle pas également partagée par l’acteur en situation de monologue ?
Pas tellement ! Le dramaturge pense que l’acteur seul en scène est moins en péril que l’acteur confronté à un autre être de chair et de sang qui lui donne la réplique. « Rien n’est plus déstabilisant pour l’acteur que de se trouver face à un autre qui a son rythme, sa façon de bouger dans l’espace. Cela le dévoile beaucoup plus que lorsqu’il met en forme son propre narcissisme dans une boîte où tout lui obéit, où il est maître du temps, de l’intensité,… où il est son propre démiurge. »
Durif
Eugène Durif n’est pas du même avis. Il considère que le comédien seul en scène est dans un état de grande fragilité, plus grande que s’il avait face à lui un autre auquel se raccrocher. Surtout si le comédien renonce à établir une connivence facile avec le public et s’expose vraiment. L’auteur le voit alors comme un « équilibriste », en situation périlleuse : « Dans ce cas il semble réinventer le texte tel un musicien de jazz en train d’improviser. » Auteur de monologues consciemment écrits pour le théâtre, LE PETIT BOIS, CONVERSATION SUR LA MONTAGNE, BMC,… mais aussi de pièces dialogiques trouées de longues parties monologuées. Duri n’établit pas de différence entre ces deux formes théâtrales. « le théâtre ne commence-t-il pas à partir du moment où il y a adresse ‚adresse à un autre présent ou absent, à Dieu, au public,… ? Peut-être, simplement, le monologue pose-t-il avec plus de violence et de radicalité la question de l’adresse.” À son avis, le monologue relève pleinement de l’art dramatique. Cela ne l’empêche pas de remarquer la défiance qui règne généralement dans le monde théâtrale à son égard tant qu’il n’a pas été joué.
Ce qui l’intéresse particulièrement ! L’insertion dans un texte dialogique d’un monologue qui, soudain, produit un brusque décrochage, part ailleurs, vers une parole lyrique, venant contrebalancer le caractère elliptique des dialogues. Le monologue lui permet dès lors de restituer « le rythme de la pensée, du
souffle avec ses aspérités et ses heurts. Le monologue est le lieu où l’on peut saisir la pensée à vif dans une parole, la pensée avec ce qu’elle a de contradictoire puisqu’à la fois elle avance, se donne, s’effondre, se retire, identique à des mouvements physiques. Quand j’écris un monologue » explique-t-il. « j’ai donc toujours à l’esprit la
façon dont il va être dit, dont il sera par moments murmuré, proféré, hurlé, chuchoté, marmonné. Je songe à des intensités physiques, vocales, musicales, de même que la pensée peut être musicale.»