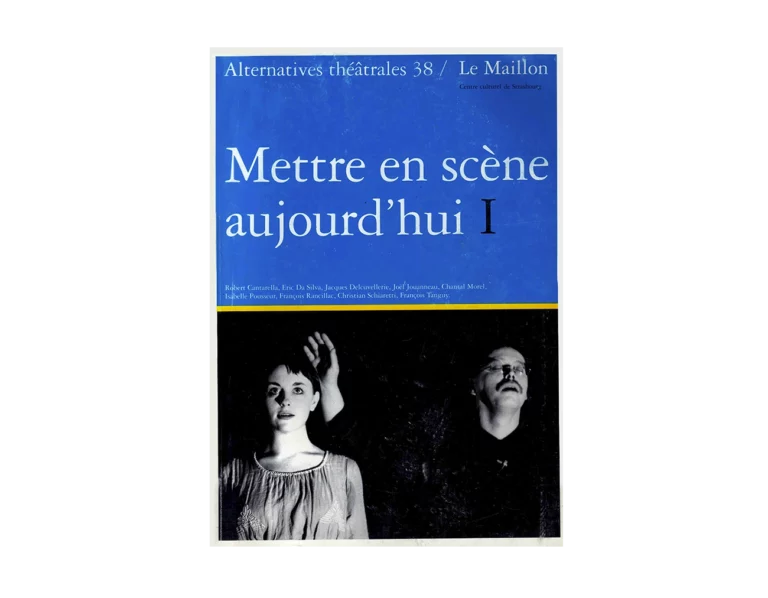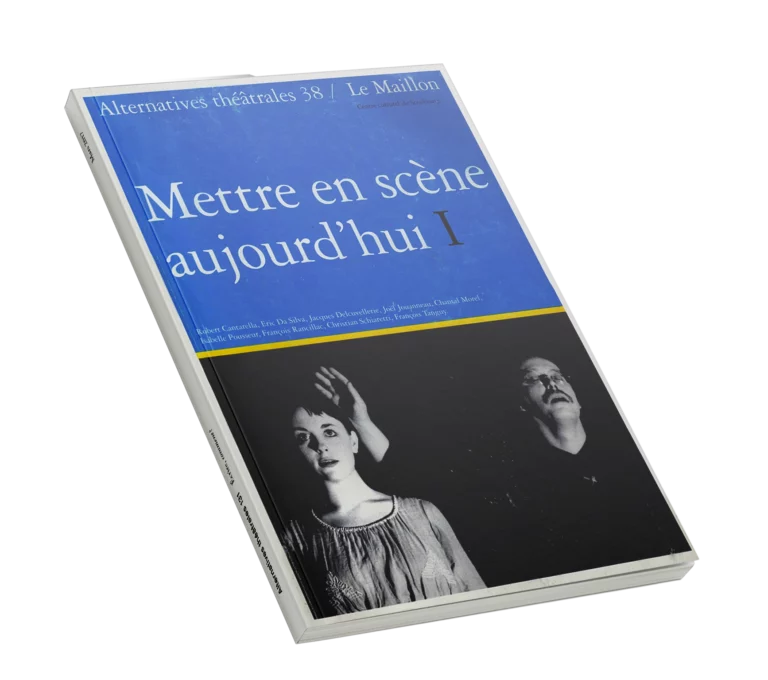Les trois pièces composant la trilogie de Jouanneau, si elles ont obtenu le même succès public, allant de la curiosité à l’enthousiasme, n’ont pas reçu le même accueil critique. Disons pour simplifier que L’HYPOTHÈSE, créée en juillet 1987 au festival d’Avignon, a suscité une approbation unanime ; que MINETTI de Thomas Bernhard donné en novembre 1988 à la Bastille a plu tôt déconcerté ; qu’EN ATTENDANT GODOT de Beckett joué aux Amandiers en février 1991 — véritable pièce-culte pour le public jeune qui y retrouvait son image — a été âprement discuté par les spécialistes de théâtre et de Beckett. A travers les trois pièces, Joël Jouanneau a voulu mener une réflexion personnelle d’ordre à la fois métaphysique, éthique et esthétique. Il a abordé les trois textes avec la même volonté de décaper, d’actualiser, de mettre à jour leurs correspondances, chacune des pièces constituant en quelque sorte l’étape d’une réflexion dialectique sur le théâtre et sur la vie. Indifférent au théâtre de répertoire, le metteur en scène ne se met au service d’une œuvre qu’à la condition que cette œuvre rejoigne ses propres préoccupations, qu’elle lui parle de sa relation au monde et à autrui. Si l’auteur parfois n’y retrouve pas son visage, le public, lui, reconnaît dans l’œuvre une même interrogation, une même sensibilité, une même poétique. Voici quelques notes pour expliquer et justifier les infidélités du metteur en scène dans les trois pièces et souligner les analogies à la lumière du projet global.
La presse a abondamment commenté les mérites de L’HYPOTHÈSE d’Avignon. Rappelons pour mémoire la magie du décor installé dans la chapelle des Pénitents blancs, entière ment réhabilitée par Jacques Gabel, et en même temps comme placée sous la menace d’un effondrement par de fausses poutres de soutènement épar pillées dans l’espace comme un jeu de mikado ! Ou les savants emboîtements sonores de Paul Bergel remplaçant par un système d’échos le jeu de reflet et de dédoublement cinématographique prévu dans les didascalies. Ou encore l’extraordinaire numéro de vocalises de Warrilow qui utilise le double registre de sa voix pour traduire la duplicité et les mystifications de Mortin.
La mise en scène de L’HYPOTHÈSE pétille d’inventions burlesques : le conférencier grimpe dans sa tribune (une chaire d’église parfaitement reconstituée) pour réciter son laïus, quitte à canarder son antagoniste qui cherche à lui dérober la parole (le double cinématographique dans la pièce ; la colombe du Saine-Esprit dans la version de Jouanneau !). Tantôt Mortin surgit comme un diable hors de sa trappe pour braver son créateur (l’auteur/Dieu), tantôt perché sur sa chaise à roulettes, il impose péremptoirement à l’auditoire la récitation de son incroyable roman-feuilleton. Mais la comédie fait place au tragique. On est témoin de la recherche désemparée des manuscrits éparpillés dans ses multiples cachettes (dans la pièce, le conférencier reste « vissé à sa table » comme son manuscrit) ; de sa vertigineuse descente aux enfers ; du renoncement final à sa quête. Le dé part vers le puits de l’insupportable Mortin — facteur Cheval de l’écriture — est un moment d’intense émotion, comme si le cabotin avait enfin jeté le masque, avouait sa solitude et regret tait l’absence de communication (la pièce est un monologue, la répétition d’une conférence supposée devant un public imaginaire).
Minetti se donne l’illusion de communiquer : il houspille le serveur d’hôtel, fait valser la buveuse qui fête solitairement la Saint-Sylvestre, don ne d’insidieux conseils à la jeune fille qui attend son fiancé. Mais il est sournoisement victime de la fatalité ou plutôt de son aveuglement. C’est la pièce où Jouanneau a pris le plus de libertés avec les didascalies : réduction drastique du nombre des figurants, ambiguïté du décor en dalles de marbre et de verre alternées qui représente successivement un dancing, la piste d’un cirque ou un îlot perdu dans une mer de ténèbres. Des gradins en ruine, construits en demi cercle sur le modèle du théâtre an tique imaginé par Palladio, donnent le sentiment d’être assis dans quelque théâtre intemporel et d’assister à la mise à mort de l’artiste. Le déroule ment de la pièce est alchimique, la lente dégradation de l’acteur s’accompagnant de la régénération de la pocharde (Marief Guittier) qui prend la gracieuse apparence d’un clown femelle sorti tout droit de LA STRADA.
Ce n’est plus !‘écrivain, c’est l’acteur qui donne l’exemple de l’aveuglement pour serre obstiné dans le ressentiment et n’avoir pas su renoncer à son art. Le duo de Warrilow et de Piéral transpose l’affronte ment métaphysique de L’hypothèse. L’adversaire de Minetti, son âme damnée, c’est son idée fixe, comme le suggère la superbe affiche de Gabel où le nain est juché sur le crâne de l’acteur. L’artiste règle ses comptes avec lui-même.
Une fois encore, Warrilow traite l’autojustification de Bernhard comme un motif purement musical avec de superbes variations sur les refrains de Minetti où se manifeste ce narcissisme invétéré qui le conduit à la destruction psychique : « Je me suis refusé à la littérature classique ». Mais Minetti ne meurt pas, il nous jouait la comédie comme Martin. Il reviendra pour les saluts tout prêt à rendosser son costume de parade. L’art dramatique est l’art du mensonge.
Il serait tentant de voir dans GODOT le dépassement de l’aporie. Le solitaire a enfin trouvé un partenaire et il apprend à sacrifier sa morgue et son indépendance. L’arbre électrique, le décor industriel qui transposent le paysage beckettien dans un univers inhabituel, ainsi que les costumes inspirés des photographies de Chris Ki lip sur l’Angleterre des mineurs sont en rupture manifeste avec la tradition. Je préfère insister sur la déshumanisation du conflit et sur le retournement de la pièce (la péripétie), non explicites chez Beckett.
Le décor sonore de Bergel, enregistré dans la cage aux singes du Jardin des Plantes, précède l’entrée des comédiens. Les protagonistes occupent chacun leur territoire qu’ils défendent bec et ongle contre les intrusions : la brillante démonstration de kung-fu de Philippe Demarle (Estragon) vise à intimider Claude Melki (Lucky) dont les jappements le tiennent à distance. En s’aventurant dans la zone interdite pendant le sommeil d’Estragon, Vladimir va hériter de toute l’angoisse du personnage, de son vertige ontologique et permettre à celui-ci de s’emparer en retour de sa sagesse et de son gîte. L’affrontement des deux amis, simulé dans la pièce (« c’est ça engueulons-nous »), devient un véritable duel suivi d’une mise à mort quand Estragon refuse de serrer la main de Vladimir. Le plus jeune donne la leçon au plus vieux. Ce qui choque la logique du spectateur réaliste qui s’en tient à l’âge du capitaine. Tout le texte dit en effet que les personnages ont une même histoire, une même biographie, cinquante ans de vie commune. Joël Jouanneau travaille les menues indications du texte pour faire surgir les différences. Estragon a une longueur d’avance sur Vladimir : il est moins optimiste, plus résigné, comme au-delà de l’espoir. Il coupe tous les élans lyriques de Vladimir, s’en tenant à l’évidence de l’ici et maintenant. L’évolution géologique condamne à terme l’espèce humaine, comme le souligne le discours de Lucky, pour une fois parfaitement intelligible.
Joël Jouanneau
(artiste associé au Théâtre de Sartrouville)
1970 – 80
Anime le Collectif du Grand Luxe, compagnie avec laquelle il met en scène Genet, Pinter, Fassbinder, Gombrowicz, Borges.
1980 – 83
Journaliste, il réalise plusieurs voyages au Moyen-Orient. Se consacre ensuite au théâtre et devient le principal collaborateur de Bruno Bayen et de la Compagnie Pénélope jusqu’en 1987.
1984
Adapte et met en scène LA DÉDICACE de Botho Strauss au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis.
1985
Ecrit et met en scène NUIT D’ORAGE SUR GAZA au Théâtre de Poche de Genève.
1987
Met en scène L’HYPOTHÈSE de Robert Pinget au Festival d’Avignon. Réalise le film pour la Sept et l’INA qui obtient le prix spécial du jury du Festival de Riccione (ltalie).
1988
Met en scène MINETTI de Thomas Bernhard à La Maison de la Culture de Bobigny dans le cadre du Festival d’Automne de Paris.
1989
Réalise le film d’après MINETTI pour la Sept et l’INA. Écrit et met en scène LE BOURRICHON, comédie rurale au Festival d’Avignon, puis reprise à Théâtre Ouvert, Théâtre de Sartrouville et au Nouveau Théâtre de Poche de Genève. Sa pièce KIKI L’INDIEN, COMÉDIE ALPINE est mise en scène par Michel Raskine au Théâtre de Sartrouville et à La Salamandre.
1990
KIKIL’INDIEN, COMÉDIE ALPINE est présentée au Théâtre 71 de Malakoff puis aux Bouffes du Nord. Ecrit et met en scène MAMIE OUATE EN PAPOASIE, COMÉDIE INSULAIRE (commande Heyoka Centre dramatique National de l’Enfance de Sartrouville). Met en scène LES ENFANTS TANNER de Robert Walser au Théâtre de la Bastille dans le cadre du.Festival d’Automne puis au Théâtre de Sartrouville.
1991
Met en scène EN ATTENDANT GODOT de Samuel Beckett au Théâtre de Nanterre-Amandiers. Ecrit GAUCHE UPPERCUT pour Stéphanie Loik pour le Théâtre d’Aubervilliers au printemps 91. Mettra en scène POKER A LA JAMAIQUE et L’ÉTÉ DES MÉRIDIENS d’Evelyne Pieiller pour le Festival d’Avignon 91.