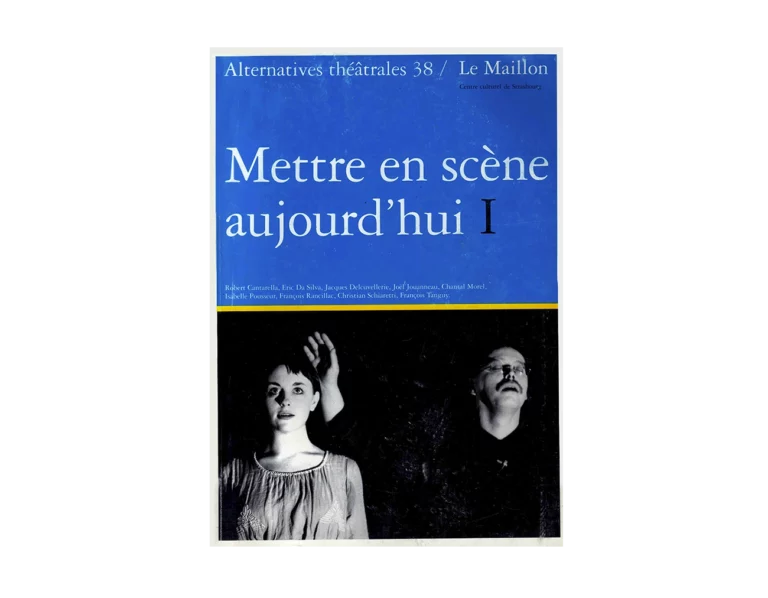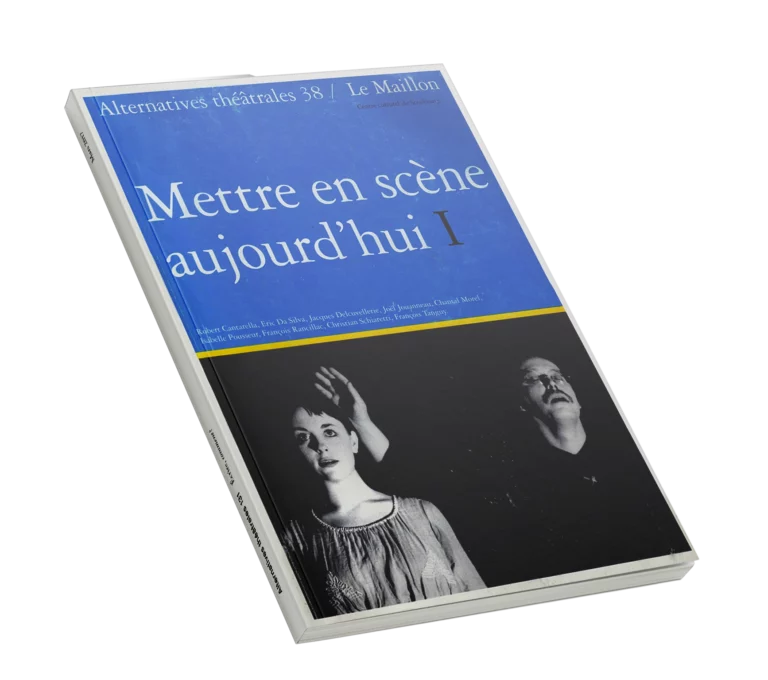I. 1980 – 1990. Sur les scènes d’Europe, de grands artistes produisent des chefs-d’œuvre somptueux : Stein monte L’ORESTIE, Chéreau LE RING, Brook LE MAHABHARATA, Vitez LE SOULIER DE SATIN, pour ne citer qu’eux. On s’habitue à ce que de grands spectacles soient luxueux. En France, les salaires des acteurs montent en flèche. 81 a fait rentrer de l’argent. Chéreau n’est plus le seul à travailler à coup de dépenses somptuaires. Tout le monde veut faire de l’opéra, presque tout le monde en fait. Jean-Pierre Thibaudat écrit dans Libération que lorsqu’une jeune compagnie dispose de cinquante mille francs, elle ferait mieux d’acheter une belle voiture et de faire une virée : pour cinquante mille francs aujourd’hui, vous n’avez plus rien, alors à quoi bon ? C’est une boutade, bien sûr, une boutade du début des années 80.1
Des esthétiques conçues dans la jubilation de la polémique, enfantées dans le désir d’une révolution des formes (et pas seulement des formes), arrivent à maturité. Elles s’épanouissent et s’institutionnalisent. Des voix se taisent qui attribuaient au théâtre un rôle politique, celle de Gilles Sandier par exemple. D’ailleurs, une relève au moins est manifeste : celle, dans la presse, de la critique dramatique. Elle a cessé d’être dominée par les connaisseurs en littérature. Faut-il s’en féliciter ? De toute façon, on ne s’intéresse guère aux auteurs contemporains dans cette période. Roger Blin, qui n’a jamais cessé de les découvrir et de les mettre en scène, crée ses derniers spectacles puis meurt dans une certaine indifférence. À la fin de la décennie, la disparition de Simenon bouleverse la presse littéraire, qui pleure unanimement la perte d’un génie ; malgré quelques « unes » mémorables (son côté photogénique n’échappe à personne), Beckett, en s’éteignant, n’a droit qu’à des hommages très convenus. L’époque est plus à Maigret qu’à Malone.
La danse, que chacun s’accorde à trouver « dynamique », tellement plus dynamique que le théâtre, est plus vertueuse que lui. Au prix, il est vrai, d’une certaine exploitation des danseurs, dont l’anonymat garantit les prétentions modestes. Le « retour des acteurs », quant à lui, prend parfois les allures d’une revanche économique. Alors on monte des monologues, beaucoup de monologues. Et les Centres dramatiques nationaux ne dédaignent pas non plus, en fin de saison, les pièces à deux ou trois personnages. Cela permet de se payer, le jour venu, une star de cinéma. L’ennui, c’est qu’elle n’a pas toujours le temps de répéter (voir Depardieu dans TARTUFFE). Dans les années 70, le rite de passage pour un metteur en scène, c’était la confrontation au texte classique. Dans les années 80, ce qui fait un « grand », c’est de diriger une star.
II. 1991.
Ils ont aujourd’hui autour de trente-cinq ans 2 ; ils ont tout juste connu Mai 68, mais certains d’entre eux se sont échinés à le refaire pendant toute leur adolescence ; ils ont eu vingt ans pendant la fin sinistre du septennat de Giscard ; ils ont vu la rupture de l’union de la Gauche, pendant que les anciens du gauchisme commençaient à se placer dans une société qu’on n’appelait pas encore civile, mais déjà plus bourgeoise ; ils sont entrés sur le marché du travail alors que le chômage se généralisait ; ils sont devenus metteurs en scène au moment où un âge d’or du théâtre jetait ses derniers feux.3
On s’est longtemps désintéressé d’eux, leurs aînés étant des contemporains capitaux dont il ne fallait négliger ni un fait ni un geste. Ce qui explique en partie qu’on ne les découvre que peu à peu. S’ils sont encore peu connus, c’est aussi, sans doute, qu’ils n’ont pas cherché à se situer dans le champ de l’arc majeur. Leur propos ne cherche pas à tout prix l’universalité. Ils s’en méfieraient plutôt, préférant même prendre le risque de l’anecdotique, du banal, du gratuit, de l’éphémère, de l’insignifiant. D’où des goûts plus éclectiques, une curiosité plus vive en matière de textes. L’auteur n’est plus pour eux une caution ni un prétexte. Jouanneau, Chantal Morel, Cantarella ont prouvé que la création d’une pièce contemporaine pouvait être l’occasion d’un travail véritable de mise en scène, autant qu’un classique.
Catherine Anne invente une chéchéraclicé raffinée, cocktail subtil de pudeur et d’impudeur pour des pièces qui semblent sorties d’un journal intime. D’un exercice de style brillant, mais limité, de Ludovic Janvier, MONSTRE VA. Robert Cantarella fait surgir un étonnant moment de théâtre, par une utilisation virtuose de l’espace minuscule de l’Atalante. Christian Schiarecci ne met pas moins de soin à faire entendre Harald Müller qu’Euripide ; c’est d’ailleurs la même actrice, Agache Alexis — elle aussi metteur en scène — qui joue Rosel et Médée : l’une n’est pas moins mythologique que l’autre, par la grâce d’un travail scénique qui fait de la pièce un peu univoque de Müller un fascinant kaléidoscope du social ; tandis que la tragédie grecque, dans une suite de séquences dissemblables et saisissantes, démultiplie l’énigmatique figure féminine de Médée. Après Pinget et Bernhard, Jouanneau, metteur en scène de LE BOURRICHE ET MAMIE OUSCAT, pièces qu’il a écrites, puis Gooot.
Que le texte soit majeur ou ne le soit pas n’est pas décisif dans la démarche de ces meneurs en scène. D’ailleurs, leur discours est plus volontiers autobiographique que culturel ou politique. Ce narcissisme peut agacer ; force est de reconnaître aussi à ces meneurs en scène une certaine forme d’humilité : ils ne se veulent plus des prophètes ni des héros, moins encore des chefs. La prise de pouvoir sur l’auteur, sur l’acteur, sur l’institution leur paraît incongrue, étrangère à la logique de leur travail.
L’intérêt pour les arcs plastiques manifeste chez beaucoup d’entre eux (Robert Cantarella a été scénographe, François Tanguy dessine ses spectacles, Christian Schiarecci élabore ses mises en scène avec un architecte devenu son décorateur) n’a rien à voir avec la constitution d’un théâtre d’images. Elle n’existe qu’étroitement associée à la plastique du jeu d’acteur : une recherche différemment orientée mais perceptible chez eux, de la gestuelle par moments mécanisée des acteurs de Stéphane Braunschweig jusqu’aux pieds crispés, baroques, superbes de Serge Maggiani sur le plan incliné du LABOUREUR ET LA BOHÈME. Les danseurs sont passés par là. Ils ont montré qu’un espace nu pouvait palpiter au simple frémissement d’un corps. Alors ces meneurs en scène accordent leur préférence au vide, privilégient les scènes abstraites, imaginent des machines à démultiplier l’émotion.