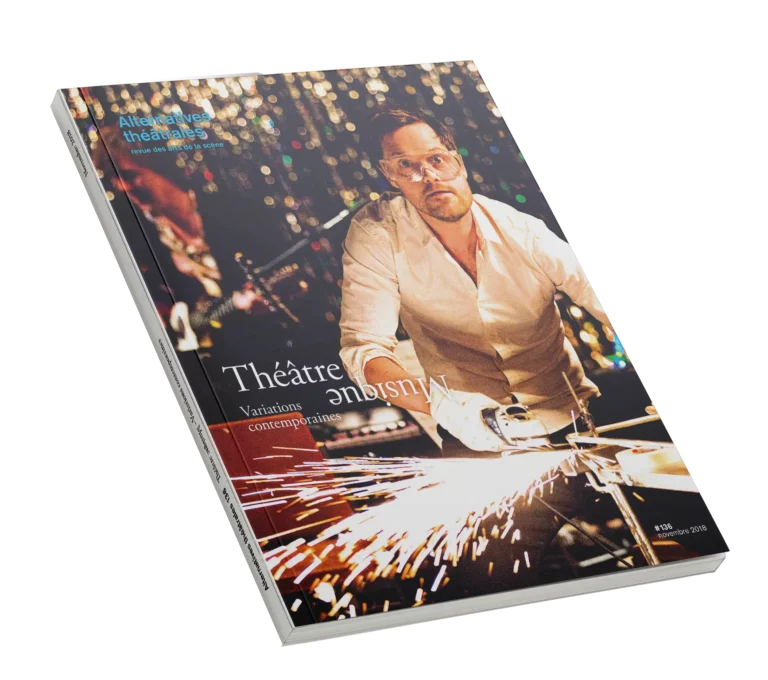CT
Vous êtes directeur de La Muse en circuit, centre national de création musicale. Les CNCM se retrouvent naturellement impliqués dans la question de la scène. Du point de vue d’une institution musicale, comment se pose l’enjeu du rapport musique-théâtre, ou musique-scène : est-ce qu’il s’agit de passer de la forme concert à de « vraies » formes théâtrales ? D’enjeux de composition ? D’un élargissement des dimensions de la création musicale ?…
WW Cette détermination est un discours esthétique qui est intéressant à définir, même chez le spectateur. La notion de « vrai théâtre » ou de ce qui doit être sur une scène est une question qu’interrogent systématiquement les arts expérimentaux – il y flotte un air de liberté artistique et d’émancipation.
Les CNCM ont été fondés dans les années 1980. Dans le sillage des Centres dramatiques nationaux (CDN) apparus dans l’après-guerre, ils traduisent une volonté du ministère de la Culture de créer des outils pour des compositeurs très attentifs à l’époque aux évolutions de l’électro-acoustique, des outils qui seraient partagés par différents artistes. Cela s’est étiolé avec le temps parce que notre culture politique est beaucoup moins mature que dans le domaine théâtral. Ayant vécu dans une famille de théâtre, et grandi entre le Chaillot de Vitez et les Amandiers de Chéreau, j’ai rapidement constaté que les visions politiques des secteurs du théâtre et de la musique étaient fort éloignées. La musique me paraît arriérée, incapable de se fédérer, marquée par un individualisme forcené. Dans ce paysage, les CNCM, qui sont portés par des préoccupations artistiques et politiques communes, me semblent intéressants. On en compte sept à ce jour sur l’ensemble du territoire1.
En ce qui concerne la composition, on hérite d’une situation où la pratique de l’écriture est traditionnellement isolée, avec une sacralisation de la question de l’auteur, une hiérarchisation entre l’auteur et l’interprète qui a des incidences sur l’appellation de « compositeur » aujourd’hui. La pratique ancestrale du musicien qui crée avec l’idée du partage me semble cependant revenir en force aujourd’hui, notamment avec le développement des collectifs. On comprend bien cette notion d’auteur propre à la musique en pensant à Wagner au XIXe siècle… Mais après lui, il a fallu attendre la fin du XXe siècle, avec des figures comme Aperghis ou Xenakis, pour retrouver une forme de préoccupation extra musicale et notamment scénique. La dimension visuelle, que Wilson ou Castellucci représentent fortement au théâtre, est en particulier portée dans le champ musical par Heiner Goebbels : pour toute ma génération de quadragénaires, cette figure essentielle a créé un véritable bouleversement stylistique, à la fois dans son travail avec le collectif et dans ses relations avec différentes origines musicales (rock, world, …), tout en s’attachant au texte.
CT
Que s’est-il passé entre les pères fondateurs, de Berio à Aperghis, et les années 1980 ? Quel mouvement ferait que la question du théâtre musical aujourd’hui hérite de ces pères fondateurs mais ne se pose plus dans les mêmes termes ?
WW Plusieurs courants sont à l’œuvre. Sur la question wagnérienne et de l’opéra, ce n’est pas tant la question esthétique qui pose problème que la question institutionnelle et politique. C’est-à-dire que la normalisation qui se fait autour d’une forme musicale a eu des effets très négatifs justement sur l’opéra, la question de l’orchestre et du chant lyrique a évolué, la façon d’écouter la musique elle-même a évolué, et elle s’est complètement figée aujourd’hui. C’est très bizarre, par exemple, de se dire que les instruments n’évoluent plus et qu’ils sont quasiment les mêmes depuis cent ans. Les grands courants vont de pair avec cette fixation de certains éléments au début du vingtième siècle. Avec le rock et surtout avec l’électricité est arrivé quelque chose qui a tout changé : la puissance sonore développée par les haut-parleurs. Le rapport à la vocalité est alors devenu tout autre. Le rock réinsère une chose importante et ancienne, qui est l’oralité à l’intérieur d’une pratique collective. Cela rejoint d’ailleurs une forme de pratique théâtrale. Cette question du groupe et de l’amplification électrique enrichit la dimension visuelle et libère complètement la voix de la pratique uniquement lyrique.
Mais étonnamment, aujourd’hui, on assiste à des manières de faire dans les opéras qui semblent s’être figées au XIXe siècle, alors que la dimension scénique est devenue fondamentale, d’une maturité et d’une plasticité absolument folles, intégrant complètement les technologies d’aujourd’hui.
CT
À la question du théâtre musical, envisagé comme le fait de mettre en scène la musique et l’interprète, comme une prolongation de l’écriture, s’ajoute la question plastique. Les technologies numériques constituent-elles pour cela un nouvel enjeu ?
WW Oui, mais encore une fois il y a une continuité – j’en reviens à Wagner : le simple fait de mettre le public dans le noir change tout par rapport à la perception de ce qu’est la scène. Et, de la même façon, quand on passe de la bougie au projecteur, on change d’univers également. Malgré tous les nouveaux outils numériques, on trouve une continuité de cette évolution-là aussi, confrontée immédiatement à la question de la scène. Ce rapport aux arts numériques et à la question plastique est dans la continuité du domaine du visuel. Les arts numériques aujourd’hui sont presque annexes, il s’agit plutôt de travailler une forme transdisciplinaire.