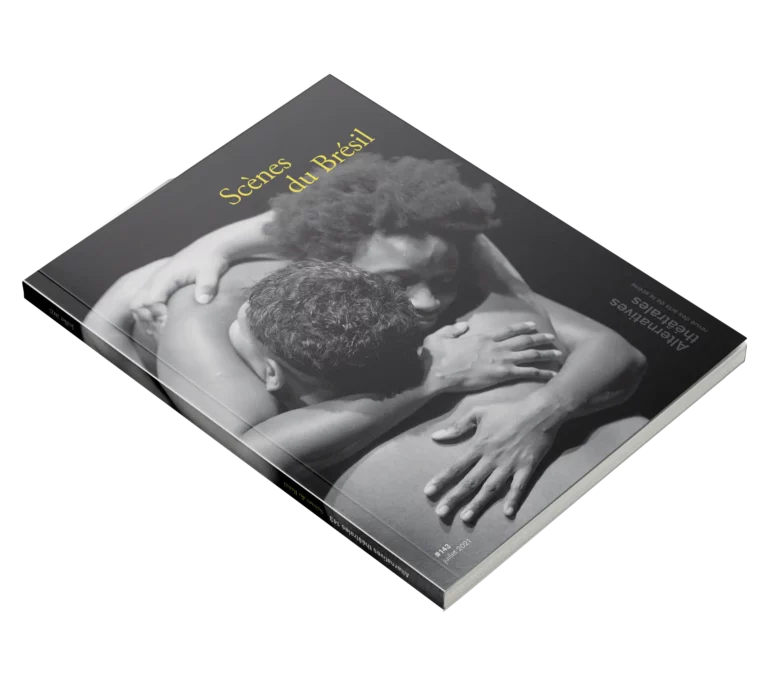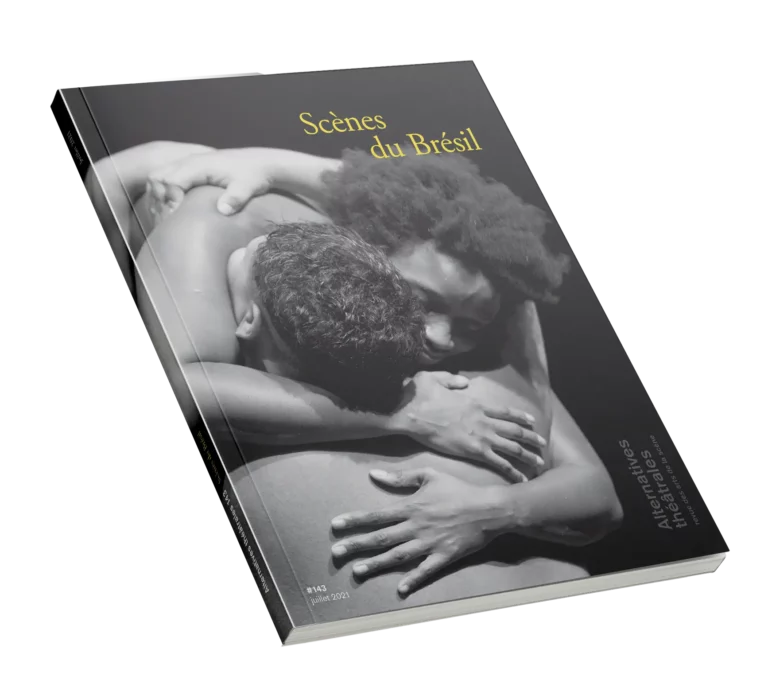Depuis quelques années maintenant, tu travailles entre le Brésil et l’Europe. Comment vis-tu cette position particulière – toi qui, de plus, travailles toujours sur les frontières ?
Comment cela a‑t-il pu te changer, ou pas ?
C’est une position privilégiée qui me permet à la fois de développer et d’approfondir ma recherche, de montrer mon travail et de dialoguer avec différents publics, ce qui est important pour ma démarche qui est centrée sur la relation – la frontière – entre la scène et les spectateurs. C’est aussi un mouvement très intéressant, comme celui que fait l’élastique d’un lance-pierre (c’est une image que j’utilise beaucoup pour la dramaturgie) : je suis projetée, comme une pierre, suivant une trajectoire d’ouverture, en-dehors de mon pays, et cet élan, qui me donne la possibilité de sortir, me renvoie avec la même force à mon point d’origine, mes racines, mon pays. C’est comme un jeu de forces : plus je sors, plus je reviens. Moi qui travaille beaucoup sur l’exil et les migrations, cela m’aide à penser la manière dont on expérimente le sentiment d’appartenir à un nouveau lieu, mais aussi de ne pas en être, et donc de vivre sur une telle ligne de crête, à la frontière de deux espaces ; et cela ouvre mon regard sur l’autre – les autres que vous, Européens, êtes pour moi, et l’autre que je suis en tant qu’artiste brésilienne en Europe.
À quelle « brésilianité » cela te ramène-t-il ? Quel rapport à ton pays d’origine apparaît dans un tel mouvement ?
Il est difficile d’en parler aujourd’hui sans évoquer la situation politique actuelle, bien différente de celle de l’époque où j’ai commencé à voyager avec mes spectacles, au début des années 2010. Aujourd’hui, je ressens de la peur, mais aussi une urgence et une responsabilité ; le sentiment qu’il est de plus en plus nécessaire de parler, à travers mon travail, de ce qui se passe ici au Brésil. Car j’ai l’impression que nous sommes en train de perdre le pays – ce n’est pas une métaphore, c’est très concret.
Nous, Brésiliens, dansons toujours au bord du volcan, nous sommes habitués à survivre dans l’instabilité et l’imprévisible, et les injustices, les problèmes sociaux endémiques, la violence. Nous en tirons courage et créativité. Notre histoire est celle d’un pays qui est toujours en train de se réinventer ; mais je n’aurais jamais cru qu’on puisse vivre une situation comme celle d’aujourd’hui. Nous sommes anesthésiés, désespérés, c’est une période de grand pessimisme qui a atteint un sommet avec la pandémie qui nous empêche même de sortir dans la rue pour manifester et se réunir. Ce n’est plus danser au bord du volcan, c’est comme si nous étions en train de tomber dedans. Si ça continue ainsi, sous un tel pouvoir d’extrême droite liée à la criminalité, on peut perdre une ou deux générations, perdre toutes les conquêtes, petites, que l’on a pu faire, qu’elles concernent la situation sociale, les libertés, le soutien aux arts… Pire encore : il y a un réel danger de génocides – c’est déjà le cas avec les indigènes, la destruction de la forêt qui avance à une vitesse terrible, la situation sociale des pauvres qui devient intenable ; et même la possibilité de la guerre civile. Et ça ne concerne pas que le Brésil : nous sommes comme un laboratoire où s’expérimentent des dangers qui risquent de se répandre ailleurs. Tout cela augmente ma responsabilité, parce que ma situation privilégiée fait que je peux, comme artiste, continuer à parler et à travailler. Il y a d’ailleurs quelque chose de très étrange : je parle de ce qui se passe ici, au Brésil, mais la situation théâtrale y est tellement difficile aujourd’hui que je ne peux y montrer mes spectacles : ils sont donc conçus pour être joués à l’étranger, avec cependant l’espoir de pouvoir un jour revenir les présenter ici, à ceux qui sont en train de vivre ce qu’ils racontent.
Dans Entre chien et loup, tu parles de cette situation brésilienne – quand tu présentais le projet, par exemple, tu faisais nommément référence à Bolsonaro.
Je ne le nomme pas dans le spectacle, parce que je veux que jamais son nom ne figure dans mon travail, mais bien sûr que je parle de lui et de ce qui se passe ici, comme je pouvais déjà le faire dans Le Présent qui déborde. Dans Entre chien et loup, je le fais de manière plus fictionnelle : c’est l’histoire d’une femme, issue de l’élite brésilienne, jouée par Julia Bernat, qui part parce qu’elle ne supporte plus que sa famille soutienne un tel gouvernement lié aux milices paramilitaires. Elle part en quête d’une autre société où on accepterait et pourrait vraiment rencontrer l’étranger, l’autre – pas seulement celui qui a quitté son pays, mais celui qui ne dit ou ne pense pas la même chose, qui a une autre identité. J’aime beaucoup la critique que fait le leader et penseur indigène Ailton Krenak1, d’une construction erronée de l’idée d’humanité qui consisterait à appréhender tout le monde de la même manière, et selon laquelle faire partie de l’humanité, ce serait donc être comme les autres – faute de quoi on est considéré comme en-dehors de l’idée même d’humanité, comme une sous-humanité. Il faut donc penser cet autre, même si on ne le reconnaît pas parce qu’il n’est pas le même que soi. La diversité est essentielle à l’idée d’humanité, alors que nous cherchons toujours la similitude plutôt que la différence. Cette femme, le personnage principal d’Entre chien et loup, part à la recherche de quelque chose qu’elle reconnaîtrait, mais au lieu de ça elle va vivre un processus de déshumanisation produit par le regard que le groupe qu’elle rejoint (une troupe de théâtre) porte sur elle. C’est ce qui arrive aussi à Grace dans le film de Lars Von Trier, Dogville, déshumanisée jusqu’à devenir un objet qu’on peut utiliser, exploiter. C’est ce qui se passe encore au Brésil avec les Noirs, les indigènes, depuis la période de la colonisation ; et c’est ce qui arrive à beaucoup d’étrangers dans les pays européens. Le spectacle est donc porté par cette interrogation : comment penser la question de l’exil au-delà de la seule question de l’immigration, mais en parlant de la diversité, de la différence – de pensées, d’histoires, de cultures ?
La possibilité de rencontrer l’autre est au cœur de ton travail – dans les sujets que tu traites, mais aussi, d’une certaine manière, dans le principe même de ce que peut susciter l’expérience théâtrale.
Parlant d’Entre chien et loup, tu présentes d’ailleurs le théâtre comme une possible « puissance de transformation » pour échapper à la « destinée tragique » représentée par le cinéma – distinguant ainsi les deux médias.
Je travaille beaucoup sur l’idée du cinéma comme enregistrement de quelque chose qui ne peut plus être changé parce que c’est au passé – même si c’est live, on ne peut jamais être sûr que ce qu’on voit se passe au même moment, c’est toujours comme s’il y avait un temps entre ce qui est capté et ce qu’on voit à l’écran. Dans Le Présent qui déborde ou What if They Went to Moscow ?, j’aborde cela, mais dans Entre chien et loup j’ai intégré cette idée au cœur même de la dramaturgie. Le groupe que rejoint l’héroïne réfléchit sur l’acceptation de l’autre et décide de travailler à partir du film Dogville pour essayer d’arriver à une autre fin, de ne pas tomber dans la même tragédie. L’objet de l’expérience, c’est donc le film – Dogville, et celui qu’ils vont faire avec elle et avec le public du théâtre. Mais bien sûr, le film est déjà écrit et il fait retour, un peu comme le passé des « personnages ». Il est important de préciser que ce spectacle ne repose pas sur le principe d’une distinction acteur/personnage, mais au contraire sur une performance « transparente » dans laquelle on ne sait pas bien s’il s’agit de l’un ou de l’autre ; comme si les deux étaient désormais tellement liés qu’il était impossible de les distinguer. Le principe est plutôt, en quelque sorte : « Je suis moi-même l’histoire que je vais essayer de changer. »