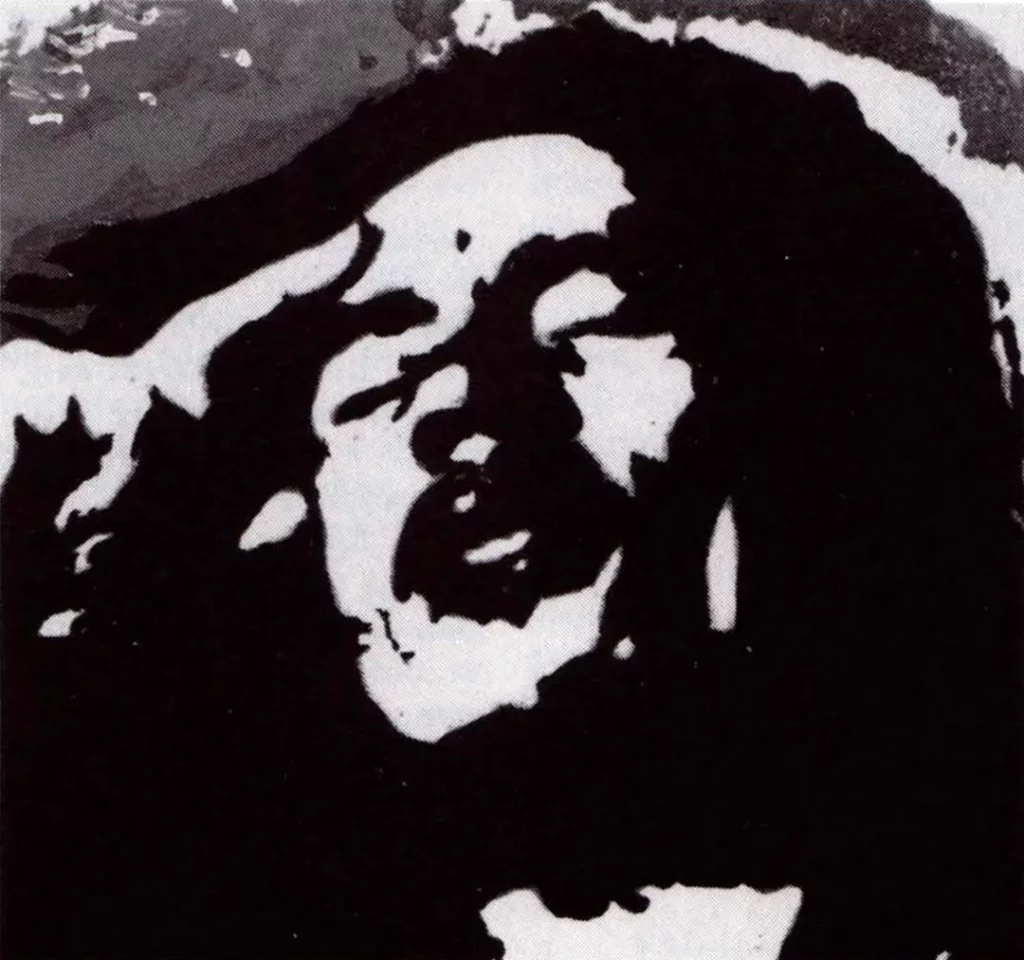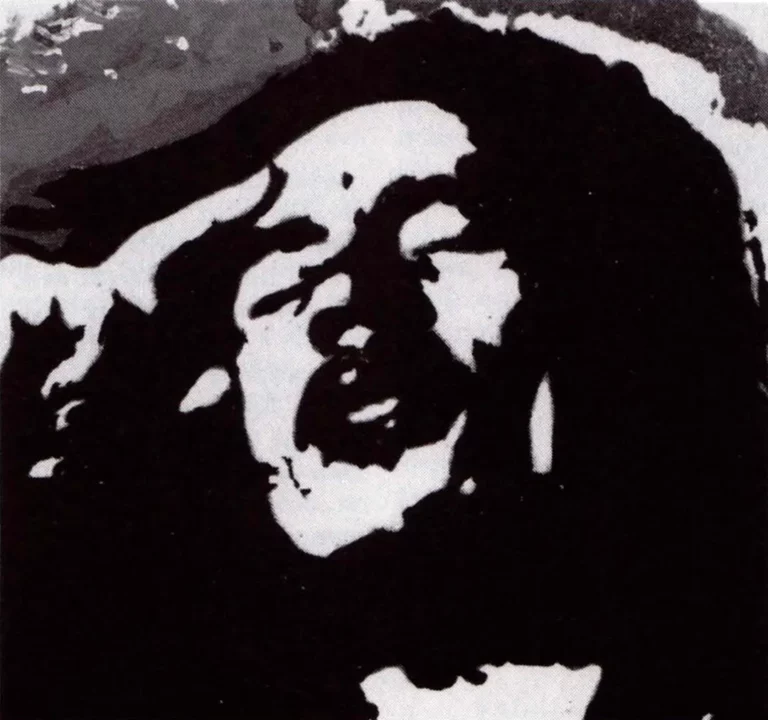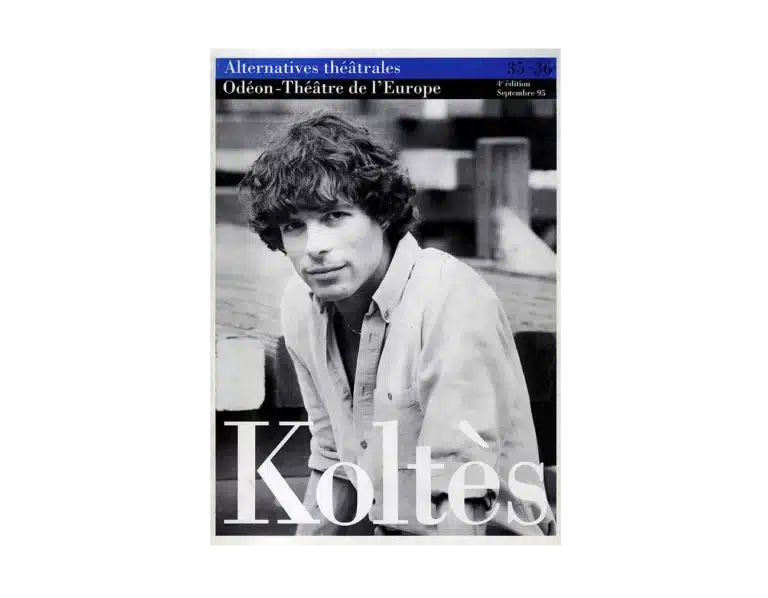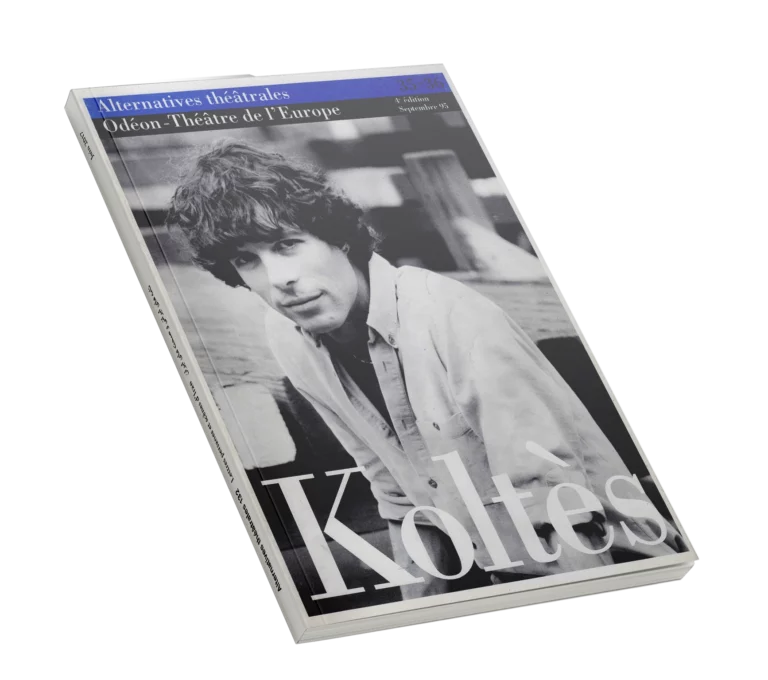En ces jours-là,
les hommes chercheront
la mort et ne la trouveront pas.
Il souhaiteront mourir et
la mort les fuira.
APOCALYPSE — 9
les héros de Koltès sont des monstres. Dans des lieux clos, menaçants, qui semblent résulter du chaos de la nature et de la société, les êtres humains sont en lutte permanente, sans qu’affrontements ethniques ou rivalités personnelles expliquent tout à fait la violence de leurs combats. L’homme verse dans l’animalité, ou voit au moins égratignée, suspendue, sa propre nature humaine. Cal est identifié à son propre chien, Cécile se dit « chienne », Adrien se dit « singe », Zucco dit qu’il est un « rhinocéros » et le Dealer met tout le monde d’accord en refusant de trancher : « homme ou animal » l’homme de Koltès ne saura jamais qui il est, même s’il parle un langage hiératique et superbe, car langage où il n’aboutit qu’à embrouiller sa conscience de soi et approfondir la rupture avec l’autre, et en amont ou en aval de ce langage règne toujours la violence.
Jusqu’à ROBERTO ZUCCO les héros de Koltès disposent d’un décor bien défini où éprouver leur nature problématique, ils savent toujours où ils sont, à quel moment ils en sont, même si le temps et l’espace ont perdu de leur présence concrète. Ils sont : « à cette heure et en ce lieu ». Les pièces de Koltès sont des îles posées sur l’océan. Au-dessus, au des-sous, tout autour se battent des titans invisibles. Il est conseillé de ne pas s’aventurer au-delà des bords sans ses chaussures, et surtout de surveiller son langage : un écart, un lapsus, un mot de trop, et l’on tombe dans la violence comme dans un trou noir. (La violence est peut-être moins, chez Koltès, une extension du psychisme qu’une grille souterraine du langage). Les héros de LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS, de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS, de QUAI OUEST, de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON, évoluent dans des univers coupés du réel, où les nouveaux occupants sont dangereusement aspirés — Léone, Monique et Koch, le Client — et dont les anciens occupants taisent la maîtrise qu’ils ont acquise des lois ambiantes. Unité de lieu, unité de temps, le théâtre de Koltès affirme par là son classicisme, à ceci près que l’action y est impossible, car l’action ne peut être que violence, violence feutrée du deal, violence manifeste du meurtre. L’action est le dernier acte d’un langage hors d’haleine et à bout de mots. Mais il semble que dans LE RETOUR AU DÉSERT où la cuisine des Serpenoise laisse voir par des trous le désert originel et terminal d’Algérie, où Mathilde et Adrien se battent sur scène, le théâtre de Koltès accueille la violence sur le champ de bataille du théâtre et laisse se fissurer le sol de l’île.
Dans ROBERTO ZUCCO, Koltès, qui n’a jamais cessé de remettre son écriture en question, a fait éclater son propre système dramaturgique. Le meurtre n’est plus la borne, la limite entre deux univers, entre le théâtre et le non-théâtre, et la violence devient le moteur de l’action. L’île, l’espace clos, étaient les lieux d’une interrogation et d’un retour sur soi de l’homme — jusqu’à une explosion de violence sans ces
se retardée. Dans ROBERTO ZUCCO, l’espace est démultiplié, éclaté, et le héros va droit devant lui, jusqu’à l’abîme. Le temps de l’île est le temps de l’attente, d’un langage qui approfondit cruellement la rupture entre les insulaires. Il n’y a pas d’attente dans ROBERTO ZUCCO mais une course sans repos autre que la mort. Zucco peut bien être fou ou ne l’être pas. Zucco est un météore dont on ne peut jamais savoir s’il est conscient ou aliéné, fou ou pas fou, méchant ou pacifique, réfléchi ou spontané, homme ou animal : le temps manque et Zucco ne fait que passer.
I — Meurtre(s)
Bilan de ROBERTO ZUCCO : quatre meurtres. Dont le héros éponyme est l’argent, mais peut-être pas l’auteur.
Le premier meurtre, celui du père, est le meurtre contre l’origine. Il ne donne lieu qu’à un nombre très restreint d’allusions. Roberto Zucco, dès la première scène, est reconnu par le Deuxième Gardien comme :
« Celui qui a été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père »
et le jugement du gardien suit : Roberto Zucco est :
« Une bête furieuse, une bête sauvage. »
Mais ce jugement n’est pas déduit explicitement des modalités mêmes du meurtre. Le meurtre du père a un caractère algébrique et a priori, le père de Zucco est comme ce père « mort-né » dont Heiner Müller évoque la figure au début du PÈRE. Zucco vit une moitié du destin d’Œdipe : Zucco tue son père. L’autre moitié est spécifique à Zucco : Zucco tue sa mère. Le meurtre des parents, c’est le complexe de Zucco. Cet acte de destruction portant sur l’origine est suprêmement ambigu. Car celui qui tue ses parents se donne le moi, se donne naissance à lui-même. (A l’interrogatoire final mené par les voix anonymes qui montent des profondeurs de la prison, Zucco répondra : « Il est normal de tuer ses parents », entendant par là que le meurtre des géniteurs est l’acte normal de qui rompt ses liens avec le réel). Mais en même temps, ce double meurtre participe d’une logique d’auto-destruction, puisque tuer ses parents, c’est détruire une partie de soi, c’est détruire la structure originelle qui vous a donné naissance. Le meurtre de l’Inspecteur est aussi un acte d’auto-destruction, mais sur le plan social. Car à la reconstitution visionnaire qu’«une pute » vient faire du meurtre de l’Inspecteur par Zucco, la Patronne répond simplement, cassant toute la célébration du meurtre :
« De toute façon, avec le meurtre d’un inspecteur, ce garçon, il est fichu ».
(C’est ce meurtre qui signe la perte de Zucco, puisque c’est un homme recherché pour le meurtre d’un inspecteur que la Gamine viendra dénoncer au commissariat). Les deux premiers meurtres sont idééls, le troisième est réel ; le dernier meurtre est le meurtre de soi-même. Après avoir tué sa mère, Zucco tuera le fils d’une autre mère. Zucco, dans un jardin publie, répond aux avances d’une femme auprès de qui il cherche à obtenir les clés de sa voiture. Mais après son refus, il la menace d’un revolver, elle et son fils. Des signes étranges nous avertissent d’une projection secrète, extrêmement retorse, de Zucco sur sa victime. L’Enfant est à la fois enfant — dans les yeux des spectateurs — et autre chose qu’enfant. « Votre fils ? Il est grand » dit Zucco à la Dame. Systématiquement. Zucco dénie à l’Enfant son apparence d’enfant. l’empêche de transformer son propre statut d’enfant en une tactique de défense. Et Zucco rapproche ainsi l’Enfant de lui-même. Si l’Enfant n’était qu’un enfant, Zucco n’aurait pas peur. Si l’Enfant occupe dans l’espace scénique un volume égal au sien, Zueco peut avoir peur. II est étrange que Zucco refuse à la fois de reconnaître sa peur, mais dénie concuremment à l’Enfant une infériorité physique, le rendant ainsi potentiellement redoutable, et il dit :
« Tu n’es pas si petit que cela, et je n’ai pas peur. »
Le désir de Zucco est ambivalent. Parallèlement, une fois qu’il a élevé cet enfant au dessus de sa nature, Zucco s’emploie à le mettre à distance, à le refouler absolument hors de sa vision, à l’isoler de toute communication avec lui et avec le dehors, et il lui ordonne, en menaçant la mère :
« Tais-toi. Ta gueule. Ferme ta bouche. Ferme les yeux. Fais le mort. »
Zucco fait de l’Enfant un schizophrène, une conscience emmurée sur scène, lors même que s’accroît la foule des témoins. La mort de l’Enfant restera un mystère isolé de toute l’action qui précède et suit. Zucco tire sur un double de lui qu’il a lentement façonné, par menaces et indications précises données à l’Enfant — Zucco apparaît alors comme le metteur en scène du meurtre — Zucco tire sur ce double sculpté par sa main, statufié, la balle qui signifie aussi sa propre mort, mais préalablement, il aura anéanti ce double dans sa vision, il aura éjecté de sa perception cet enfant qui ne parle plus, ne bouge plus, ne voit plus. (Il aura également empêché l’Enfant de le voir). Zucco a tout fait pour se tuer lui-même en l’autre, mais il a rejeté cette projection de lui-même hors de sa conscience et de sa vision. Le meurtre de l’Enfant est une figure du suicide de Zucco, suicide conscient parce que Zucco fabrique avec sa victime une image réfléchissante, inconscient parce qu’il anéantit tout t lien tangible entre lui et sa victime. Le meurtrier ne sait tellement pas qui il tue qu’il ne sait plus qu’il tue.
A la logique souterraine des meurtres répond celle des
armes. Les modalités du parricide ne nous sont décrites que par la bouche de la Mère qui lance à Zucco :
« Comment veux-tu que j’oublie que tu as tué ton père, que tu l’as jeté par la fenêtre, comme on jette une cigarete ? »
Elle décrira par la suite : «…ces grandes mains fortes qui n’ont jamais servi qu’à caresser le cou de ta mère, qu’à serrer celui de ton père, que tu as tué. » Les modalités de l’acte apparaissent disjointes de son résultat. Nous pouvons à bon droit imaginer que Zucco a tué son père en l’étranglant — comme il va étrangler sa mère, après l’avoir caressée — mais en même temps, la virgule qui sépare la relative de son antécédent dans la dernière citation nous suggère que le meurtre échappe aux instruments et au mode même de son exécution. Il serait presque concevable que Roberto ait tué son père en le jetant par la fenêtre, que la chute seule fût meurtrière, sans qu’une arme du crime ait matérialisé l’acte et relié le meurtrier à sa victime. (Car le meurtre du père est comme inhérent à la structure psychique de Zucco, il n’a pas besoin de s’y salir les mains). Les meurtres se succèdent, à la fois liés entre eux et disjoints, puisque chaque fois une nouvelle arme est utilisée, et tout de suite abandonnée. Zucco tue son père en le jetant par la fenêtre, sa mère en l’étranglant, l’Inspecteur avec un poignard et l’Enfant avec un pistolet. L’arme du crime gagne en matérialité à mesure que le meurtre se fait plus tangible, plus douloureux, et plus spectaculaire, puisque le meurtre de l’Enfant est longuement préparé scéniquement — sans qu’il soit nécessairement prévu — et abondamment commenté par la suite. Et la matérialité croissante de l’arme tranche sur le désaveu par le meurtrier de son propre acte, qui dira à la scène douze : « Je ne voulais pas le tuer. » L’acte échappe à Zucco comme l’arme, les armes du crime, échappent de plus en plus à son corps, à sa main, à sa volonté.
Le meurtrier est peut-être l’ordonnateur suprême de tous ses gestes, il en est peut-être le jouet… Nous ne pouvons élire chez Zucco la préméditation à l’exclusion du geste instantané. Soit Roberto Zucco qui arrive chez sa mère à la scène deux, juste après son évasion : il est dans un état de grande fureur, et parallèlement, il exprime un désir d’apparence anodine : il veut récupérer son treillis militaire. (Et rien n’indique dans la scène que cet état et ce désir soient liés, ils peuvent entretenir un lien de cause à effet, ils peuvent aussi bien procéder de deux séries séparées, absolument distinctes). Tout le dialogue entre la mère et le fils s’articule jusqu’au meurtre autour de cet objet-fétiche, au point de devenir comique. La Mère refuse obstinément de donner le treillis, dans cette prescience que, lorsqu’elle aura satisfait ce désir, Zucco la tuera. (C’est dans ses paroles que l’on déchiffre cette peur). Zucco peut avoir décidé, antérieurement au moment où il frappe chez elle, de tuer sa mère, une fois qu’il aura récupéré son treillis. Mais cet acte meurtrier peut aussi être distingué, disjoint de l’obtention même du vêtement, ce peut être un geste brusque qui n’a rien à y voir ; le doute est intact. La litanie du treillis est le leurre où Zucco prend sa mère, et celui où le dramaturge prend le spectateur, jetant sur les plans ou l’absence de plans de Zucco un voile opaque.