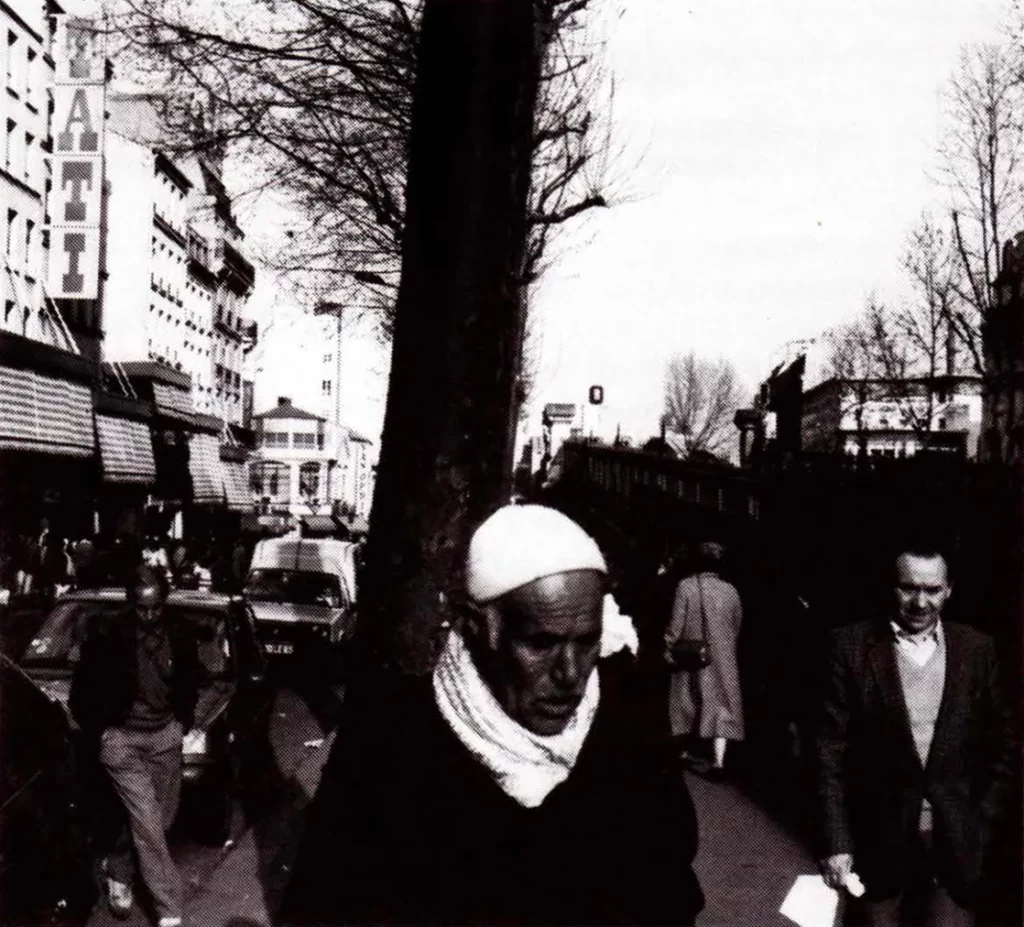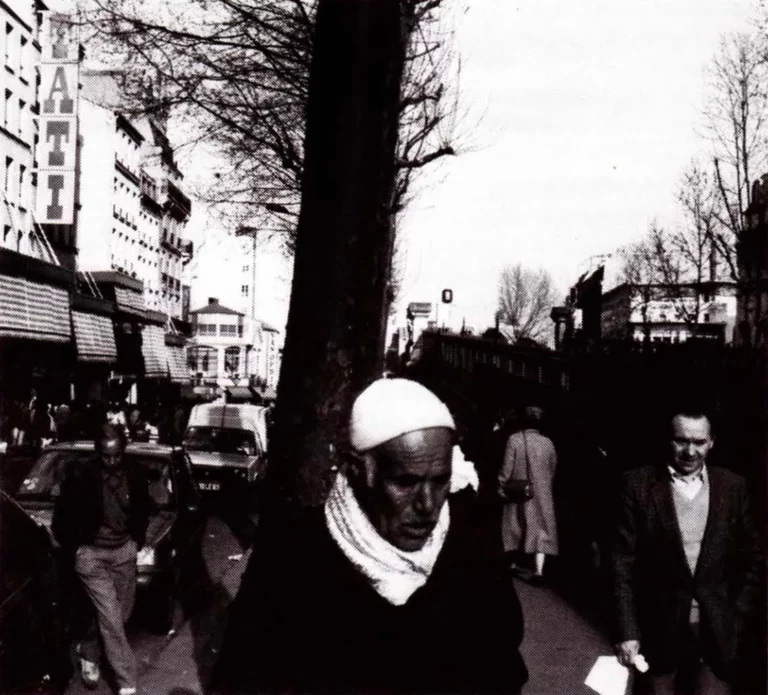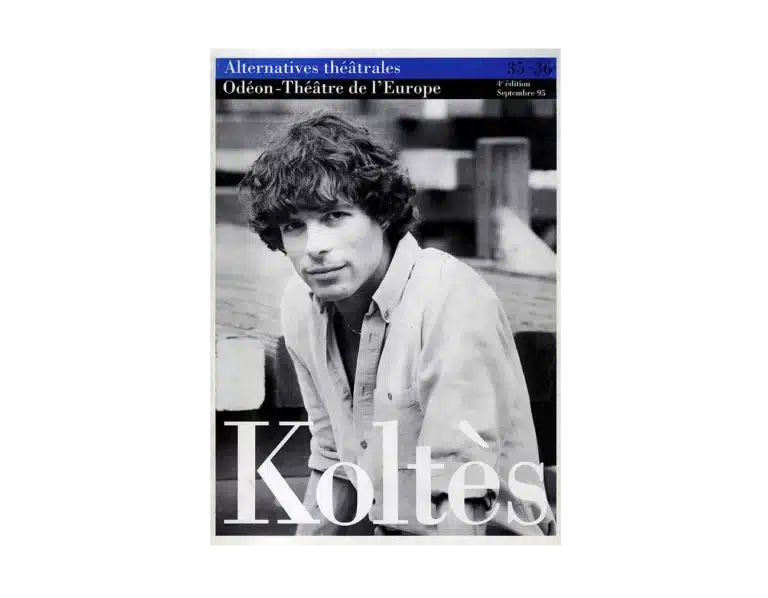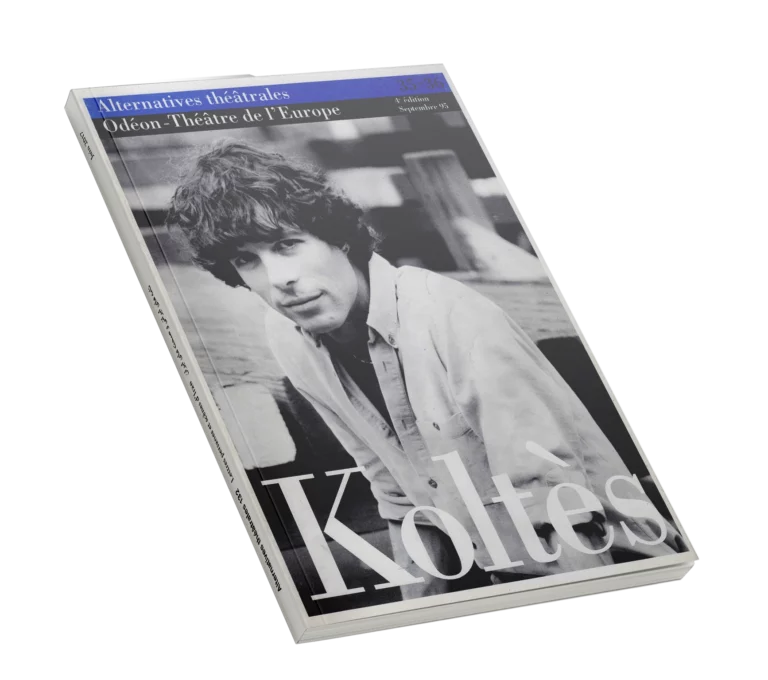J’aime bien les ballades, à condition que, sur une musique gaie, le sujet soit très triste, ou qu’il soit très joyeux sur une musique sinistre.
Shakespeare, LE CONTE D’HIVER, trad. B.-M. Koltès
Il faut d’abord porter le trouble, si l’on veut obtenir la sécurité.
LE RETOUR AU DÉSERT
« Si j’écrivais un roman, je pèsera;, autant mes mots et je mettrais dix ans à l’écrire », affirmait Koltès en 1983. Il n’a pas eu ces dix ans pour écrire. Avec un immense sentiment de frustration, nous restons devant une œuvre achevée par la nécessité, presque entièrement dévolue au théâtre. On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi Koltès a choisi cette forme-là, alors que le roman bute sans arrêt aux portes de son théâtre, alors que la poésie s’infiltre par tous les pores de la didascalie et se saisit souvent des monologues. Pour quelles raisons cette forme aux multiples contraintes pouvait-elle coller d’aussi près à son univers, à sa thématique et au mouvement sous-jacent qui la parcourt ? Pourquoi ces murailles de citations et de discours en langue étrangère, pourquoi ces fragments de récits préliminaires, qui enferment dans la certitude narrative ou l’épaisseur poétique l’immédiateté éphémère qui surgit de la scène ? Inversement pourquoi ces fins brutales, précipitées, pourquoi ces morts, ces naissances, ces fuites ? C’est un étrange et familier théâtre, tendu par l’absence, mû par le combat, mais résolu toujours, que ce soit par la guerre ou par le repos.
Le théâtre de Koltès est rythmé par la résurgence des mêmes thèmes d’une pièce à l’autre : l’aspiration à la mort, le viol et la perte de la virginité, le deal, l’argent, l’enfermement en soi, l’échappée … L’univers construit peu à peu par le dramaturge est celui d’un manque violemment arraché à la plénitude et retournant à la plénitude. Sans doute est-ce pourquoi son théâtre est tendu vers un sens, avec des pleins et des creux, où le néant n’est pas une apparence mais un idéal, où il n’est pas une réalité mais un aboutissement. Or cela suppose un début et une fin nettement distincts, un développement, une progression — ce qui est loin d’être une évidence, même au théâtre-. En un mot, le théâtre de Koltès renoue avec une certaine forme, née à la fois de la tension d’un désordre et du mouvement vers sa résolution. C’est là peut-être son originalité, dans l’assurance que du trouble doit naître quelque chose, même si l’ordre nouveau, le seul acceptable, a l’apparence de la souffrance, de la lutte ou de la mort. Autant dire que le théâtre de Koltès est un véritable théâtre tragique. Au sens où l’est celui des Grecs anciens, au sens où l’est celui de Shakespeare. Tragique, évidemment, ne se confond pas ici avec triste ou sinistre. Par sa tension la forme est tragique ; le « sens », lui, ne l’est pas, au moins parce que l’action est possible, parce qu’elle n’est plus imposée ou indifférente mais efficace, et que le geste est libre.
Toutes les pièces de Koltes, en apparence, ne se ressemblent pas sur ce terrain. La logique de COMBAT DE NEGRE ET DE CHIENS est sans aucun doute la plus pure. Un homme a été tué. L’enjeu est défini tout de suite : « Je suis Alboury, monsieur ; je viens chercher le corps ». Implacable nécessité, sans échappatoire, au point que n’importe quel corps pourrait faire l’affaire, celui de la victime ou celui d’un autre, celui du frère ou celui du meurtrier. Face à la requête, imperturbablement déclinée par le frère de la victime, Horn, le chef de chantier, contourne l’évidence. Il accentue à l’excès le mot « corps » (« Le.corps, oui oui oui ! »), ou le remplace par des expressions voisines (« affaire », « chute », « le mort », « triste histoire », « sacré cadavre ».…), évoquant plutôt sa femme, corps vivant pour un corps mort. Mariage pour deuil. Pourtant un deuxième homme doit mourir, rapide-ment, avant la fin de la nuit. Il faudra toute la durée d’une tragédie et la tension de volontés incompatibles, pour conduire peu à peu vers l’extrémité de qui est dicible, vers ce faisceau de questions qui émergent lentement, non formulées : comment fait-on pour tuer, comment fait-on pour mourir, et pour porter, vivant, le signe de la mort passée et à venir ? La force de cette pièce réside finalement dans sa puissance cathartique, qui permet d’envisager en toute lumière l’inacceptable, sans dérapage dans le sentimentalisme.
D’un point de vue tragique, COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS demeure la pièce la plus équilibrée. Sa fin est à épisodes, comme dans LE RETOUR AU DÉSERT ou QUAI OUEST, mais les rebondissements se suivent si rapidement et avec une telle logique, que la pièce semble résolue dans le mouvement de la nécessité. Après les deux scènes de faux monologue (il est adressé à un personnage caché et muet, Léone, qui a déjà accompli son destin), ces deux scènes formant ainsi le point le plus escarpé de l’impossible cohabitation entre les personnages, la pièce déroule à toute allure l’ultime résolution du processus tragique. Ce qui depuis toujours devait être accompli s’est enfin accompli. Cal ne parvient pas à tuer et succombe, Alboury offre à son frère mort l’hommage d’une autre mort, Léone rentre d’Afrique joyeuse et marquée à vie d’une malédiction originelle enfin assumée, Horn reste seul, arbitre impuissant. Les deux dernières « visions », pour reprendre l’expression de Koltès, (le départ de Léone et le regard de Horn sur le corps et les miradors déserts), parachèvent la conclusion tragique comme le ferait le dernier chant du chœur dans une pièce antique. Elles forment une sorte de commentaire indirect sur l’action passée, un rééquilibrage définitif des choses. Cadavre pour cadavre. Malédiction pour malédiction. Un ordre neuf, nécessaire, a fait place au déséquilibre initial : le dernier mot de la pièce n’est pas sans raison « zurück ».
Transparente dans cette pièce, la logique de la tragédie sous-tend le théâtre entier de Koltès, même si, parfois, elle est encombrée par les caprices d’une action proliférante (QUAI OUEST), même si elle paraît déviée par la dynamique saccadée du théâtre de boulevard (LE RETOUR AU DÉSERT), même si elle est sans cesse différée par le dialogue (DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE CETÓN) ou sublimée en une métaphysique (ROBERTO ZUCCO). En effet dans les autres pièces cette résolution n’est pas aussi précipitée. Elle éclate avant terme (comme dans QUAI OUEST ou LE RETOUR AU DÉSERT, qui multi‑r plient les morts au point que certaines passent presque inaperçues), ou bien elle n’est qu’effleurée (DANS LA SOLITUDE : DES CHAMPS DE COTON). Seule lui est comparable la résolution de ROBERTO ZUCCO, encore qu’elle se produise dans une chute que l’éclat solaire transforme étrangement en apothéose :
( Le soleil monte, brillant, extraordinairement lumineux. Un grand vent se lève).
Zucco : Regardez le soleil. (… )
Zucco : Regardez ce qui sort du soleil. C’est le sexe du soleil ; c’est là que vient le vent. (…)
Zucco : Tournez votre visage vers l’Orient et il s’y déplacera ; et si vous tournez votre visage vers l’Occident, il vous suivra.
(Un vent d’ouragan se lève. Zucco vacille. )
Une voix : Il est fou. Il va tomber.
Une voix : Arrête, Zucco ; tu vas te casser la gueule.
Une voix : Il est fou.
Une voix : Il va tomber.