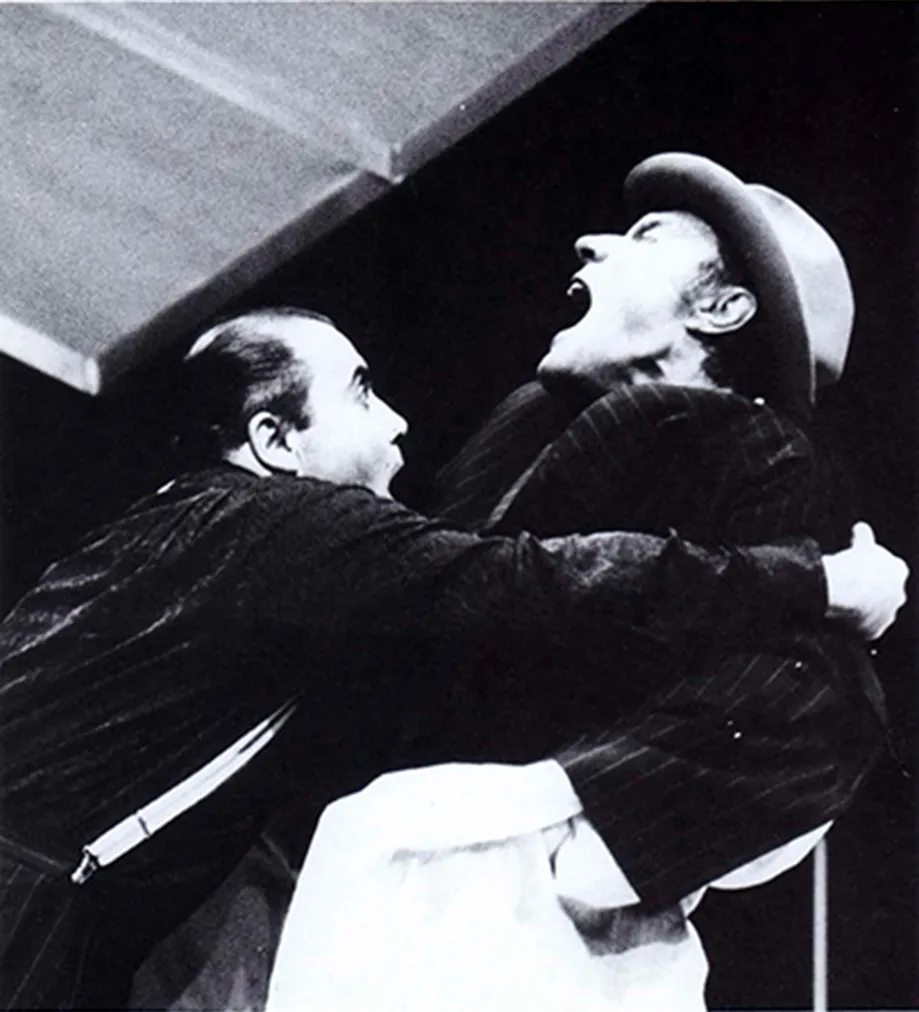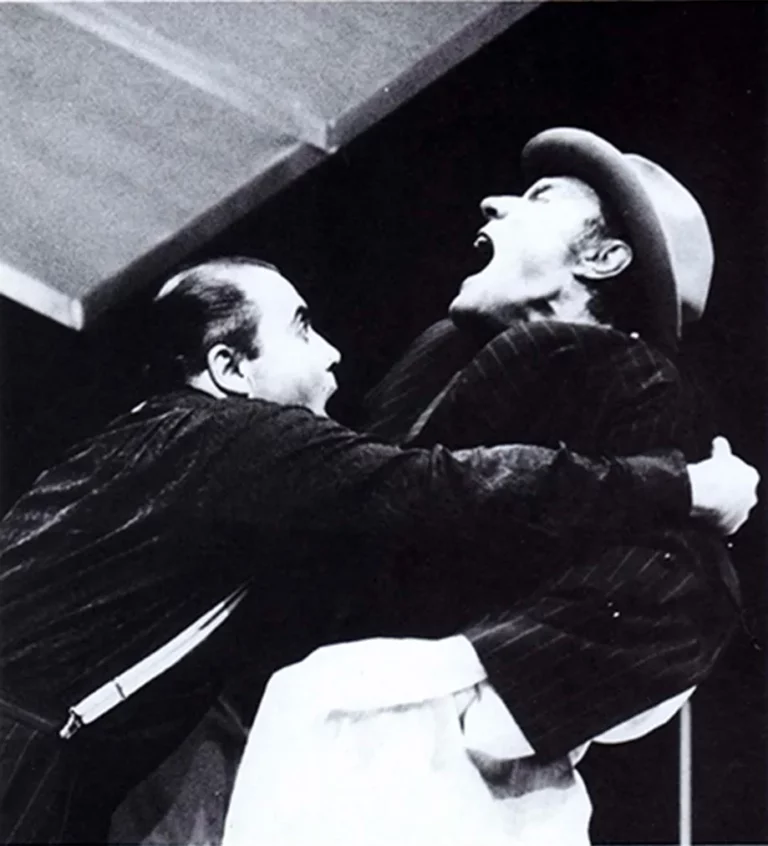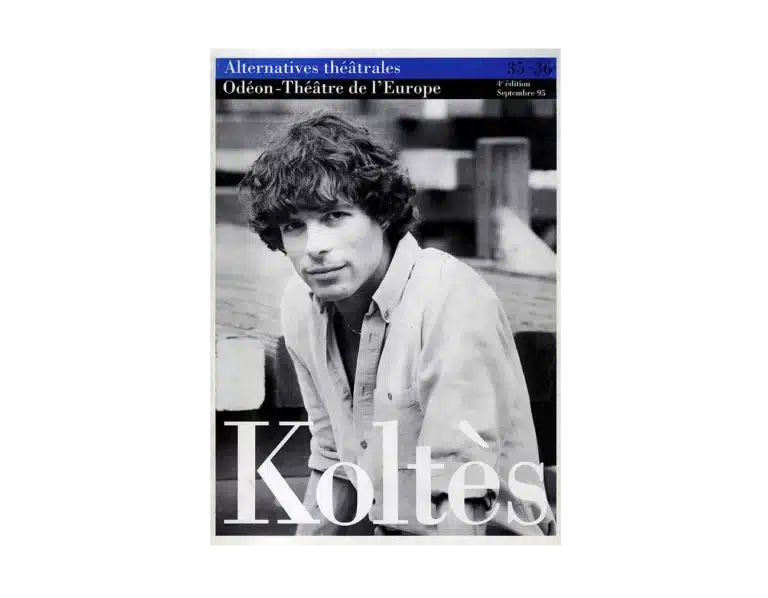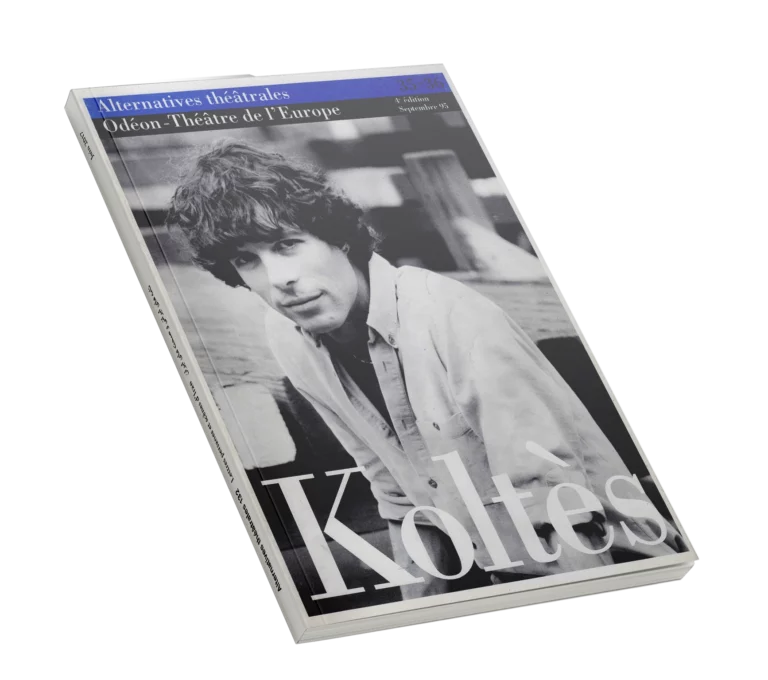Patrice Chéreau a donné cet entretien à Didier Méreuze en octobre 1987.
Didier Méreuze : Votre première mise en scène d’un texte de Bernard-Marie Koltès — COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS — coïncide avec votre arrivée à la direction du Théâtre des Amandiers de Nanterre. C’est même ce spectacle qui a marqué son inauguration. Ce n’est pas un hasard ?
Patrice Chéreau : C’est un hasard et pas. C’est grâce à Hubert Gignoux, qui a toujours énormément défendu Koltès, que j’ai découvert COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS. Koltès me l’avait envoyée par la poste et je n’y avais pas vraiment fait attention — dans la mesure où les pièces qui vous arrivent par la poste sont rarement bonnes et qu’on ne les lit presque jamais. Et puis j’ai rencontré Gignoux qui savait qu’il s’agissait d’un grand auteur, d’une écriture. Je l’ai lue. Et même si, au départ, je n’y suis pas entré tout de suite, parce que ça parlait d’histoires de l’Afrique, d’un chantier — tout un monde avec lequel je n’avais pas d’atomes crochus -, j’ai compris, à la première ligne, qu’il s’agissait effectivement d’un véritable auteur, mais un auteur comme il n’y en a pratiquement pas en France, et qui ne se compare absolument pas à ce que l’on appelle communément les « jeunes auteurs » du théâtre français, à l’écriture plus volontiers logomachique.
Après, il a fallu faire abstraction des gens qui se contentaient de dire « oui, c’est pas mal » avec une moue, par distraction, et trouver l’occasion de la monter. J’ai même failli le faire au TNP. Et puis il y a eu PEER GYNT. En fait, ce n’est qu’au moment de mon arrivée à Nanterre que le projet a pu se réaliser. C’était très bien : cela correspondait, pour moi, à une volonté de mettre en avant les auteurs contemporains — puisque, ensuite, j’ai monté LES PARAVENTS de Genet. Deux mises en scène d’auteurs contemporains — dont la première coïncidait avec l’inauguration de la saison -, ça me semblait un minimum.
Travailler sur une œuvre classique et travailler sur une pièce contemporaine, ça n’est pas la même chose. Monter un « classique » pose moins de problèmes qu’un texte contemporain. On y a des références. On peut se battre secrètement contre une mise en scène que l’on a vue, une interprétation que l’on juge contestable. Et même si on se lance dans des propositions aberrantes sur DOM JUAN, LE MISANTHROPE ou HAMLET, ça ne tire pas vraiment à conséquence. Parce que chacun peut toujours lire ou relire ces pièces et que les autres interprétations courent toujours.
Dès que l’on aborde les textes contemporains, on se place sur un terrain beaucoup plus délicat : il n’y a plus de mode d’emploi. On se retrouve en présence d’un objet non identifié, totalement neuf — qu’il ait déjà été joué ou non -, qui ne répond à aucune norme habituelle. Et le fait d’avoir travaillé sur Shakespeare ou Tchekhov n’est d’aucun secours. L’absence de références contraint à chercher ailleurs. Il faut parvenir à faire entendre le plus exactement et le plus simplement possible ce qui doit être entendu, tout en donnant à l’œuvre présentée toutes les chances de survie. C’est aussi une responsabilité très lourde…