Gerard Mortier, face aux menaces de grève persistantes, racontait un soir, entre amis : « J’ai décidé de ne plus enlever le plateau de la danse par crainte qu’ils ne veuillent plus le remonter et je me suis résigné à donner des opéras en version concert. Georges, venez‑y ! » J’ai honoré son invitation qui me touchait et j’y suis allé plusieurs fois. L’expérience m’a séduit et ne restait pas sans conséquences sur le spectateur que j’étais, familier du théâtre et dilettante de l’opéra. C’est ce dont brièvement j’entends parler ici.
L’opéra rangé parmi les spectacles ringards des temps modernes s’est sauvé par le théâtre. Et il doit l’essor qu’il a connu à Strehler, à Chéreau dont les spectacles inouïs ont séduit non sans susciter des remous… Pour preuve l’accueil tumultueux fait à la tétralogie de Chéreau à Bayreuth qui, avec le temps, s’est converti en triomphe final. Et le recours aux metteurs en scène de théâtre finit par s’ériger en option et stratégie privilégiées des grands directeurs issus de la mouvance de Mortier – l’histoire est connue. Et bienvenue.
Dans les soirées de versions de concert, je me reposais du théâtre, non pas celui proposé par ses figures exemplaires, mais le théâtre accrocheur des metteurs en scène qui réduisaient leur travail à des implants et des greffes précipités. Et cela à renfort de scénographies qui, surtout elles, engendraient des étonnements aussi bien que des rejets bruyants. Un exercice a contaminé la mise en scène de l’opéra et, pour le désigner, on peut emprunter le titre d’un livre célèbre, Les habits neufs du Président1. Ainsi l’on a procédé à ce que l’on peut diagnostiquer comme étant le temps compressé. Le temps sans histoire ni durée. Un temps réduit à des signes explicites du quotidien, variante affichée d’une volonté de moderniser et de banaliser. Rendre contemporaine une œuvre implique des efforts autrement plus décisifs que ce travestissement précipité qui engendre de la dérision : le Vieux est emballé comme un produit vendable, qui assure une « médiatisation » agressive. Les exemples abondent.
La version de concert, par son austérité implicite, écartait tout ce fatras de gadgets qui brouille ou parasite l’approche de l’opéra – car si le bon théâtre l’exalte, le mauvais le détériore. Je ne suis pas devenu pour autant un partisan de l’absence de représentation mais, de même que Jacques Copeau jadis ou Peter Brook plus récemment, de la scène nue, de l’espace vide. Austérité qui laisse se déployer les voix et entendre la musique grâce à des interprètes confrontés à eux-mêmes en toute liberté. L’austérité suppose d’abord ce refus de la décoration qui m’évoquait la phrase du célèbre architecte Adolf Loos : « L’ornement est un crime. »
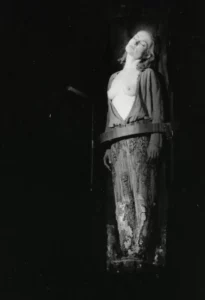
Mais pour que l’austérité nous satisfasse, elle doit comporter une dimension spirituelle qui appelle le vide. Le vide acquis au terme d’une recherche obstinée par des éliminations successives. Le vide comme conséquence d’un travail destiné à toucher le noyau de ces opéras voués si souvent à une spectacularisation à bas prix au nom de la quête d’épater et des déflagrations éphémères.
Il ne s’agit point de réfuter dans l’exercice courant de l’opéra la « contemporanéisation » qui se trouve à l’origine du renouveau du théâtre et que des grands metteurs, de Warlikowski à Marthaler, ont adoptée dans leurs travaux. Elle atteste un examen dramaturgique et des options surgies de la matière même des œuvres. Elle entraîne un changement de jeu et implique des solutions scénographiques d’un rare pouvoir expressif. Non, ce qui exaspère c’est la superficialité de « l’actualisation ». Elle se limite à enrober l’œuvre dans la pellicule des signes vestimentaires directement empruntés au présent, des comportements quotidiens au nom d’un refus d’« intimidation par les classiques » et d’un souci de promotion commerciale de ce genre qui doit intégrer le quotidien. C’est au « mauvais théâtre » qui, sous des prétextes fallacieux, s’insinue dans la pratique des mises en scène que je reste réfractaire. Par contre, il n’y a pas d’endroit où « le bon théâtre » s’accomplit davantage qu’à… l’opéra. Plénitude extrême dont les grandes réussites survivent comme des « souvenirs rayonnants ». Accomplissements de cette synthèse que l’opéra seul peut proposer.
Les versions de concert, je le savais, s’expliquaient par la prudence face aux imprévus des mouvements de grève, mais, au moins, elles écartaient la masse pondérale des scénographies en vidant la scène. Scène vidée et non pas la scène vide. Le vide n’étant pas l’opération ponctuelle de survie d’un directeur d’institution, mais l’horizon d’un artiste épris d’esprit… de la musique. Le vide s’acquiert, au vide on doit parvenir, le vide confirme une essentialisation. Ce vide-là illumine ? Et il surgit d’une austérité assumée et pleinement respectée.
Cette austérité, je l’ai trouvée dans les grands oratorios dont Romeo Castellucci ou Peter Sellars ont proposé la version scénique. Chaque fois, l’émotion qui s’emparait du spectateur que j’étais provenait de l’alliance essentielle du mot et du son sur le plateau sur fond de parcimonie extrême des moyens mis en œuvre. Cette austérité porte en elle le germe du sacré et permet d’ériger le spectacle en expérience de l’éternité. En « art comme véhicule » vers une dimension autre.
L’austérité lave et purifie. Mais, admettons-le, pour qu’elle conserve sa puissance elle exige la rareté. Pas la contagion… Mais, certains éprouvent le besoin assoiffé, pour paraphraser Nietzsche, d’aller « au-delà du théâtre et de l’opéra ».
- Simon Leys, Les habits neufs du Président Mao, 1973. Titre inspiré par le conte d’Andersen, « Les habits neufs de l’empereur » [NDLR]. ↩︎
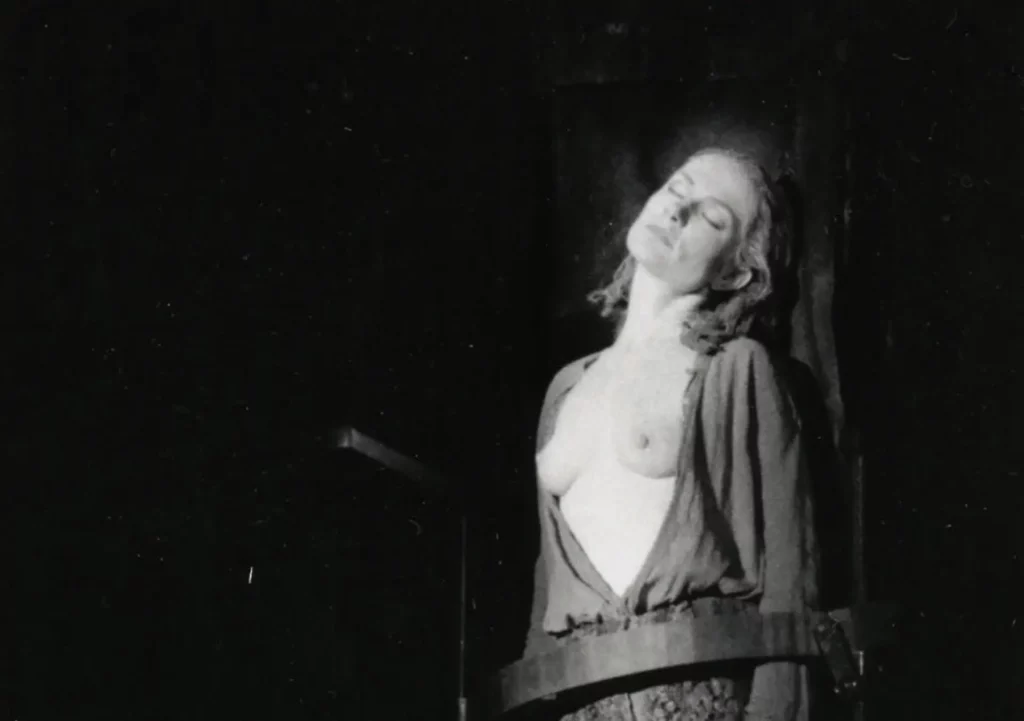





![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

