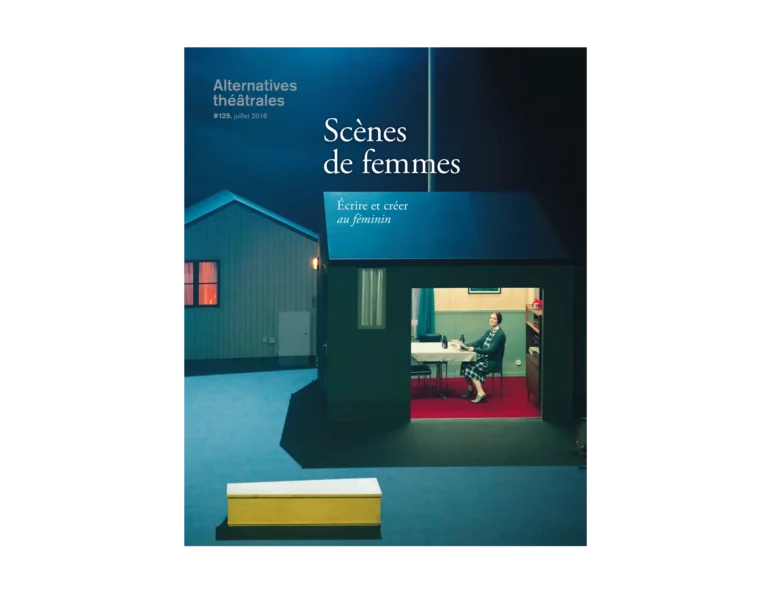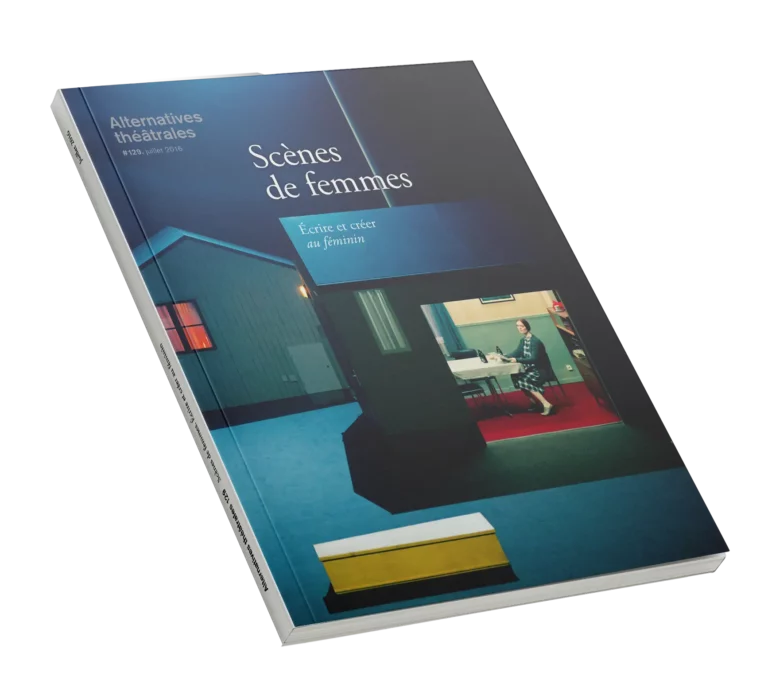Entre l’affirmation de l’académicien François-Eudes de Mézeray : « L’ancienne orthographe […] distingue les gens de lettres d’avec les ignorants et les simples femmes » (c’était en 1673) et la nomination d’une ministre déléguée aux droits de la femme (Yvette Roudy, en 1981, dans le premier gouvernement de François Mitterrand), trois siècles auront passé. Entre-temps, à la Libération, les Françaises auront obtenu le droit de vote (dix ans après les femmes turques…), alors que des femmes sous-secrétaires d’État ont siégé au gouvernement du Front populaire sans pouvoir voter elles-mêmes. Quelques révolutions et deux guerres mondiales n’auront pas réussi à ébranler ce bastion inexpugnable qu’était jusque-là l’orthographe française. En fait, c’est Mai 68, et, dans son sillage, le mouvement des femmes pour leurs droits (à l’égalité, au travail, à l’avortement et à la contraception, à la sexualité…), qui fera bouger les choses.
Lentement, mais inexorablement. Avant, c’était simple : il y avait les « métiers et fonctions d’homme » (président, ministre, préfet, commissaire, juge, secrétaire général, professeur, écrivain, docteur, pilote…) et les « métiers de femme » (infirmière, hôtesse de l’air, sage-femme, cantinière, speakerine…). Les « anomalies » se comptaient sur les doigts de la main : un mannequin était une jeune femme, une estafette ou une recrue était un homme. Quand des postes hiérarchiques ou d’autorité étaient occupés par des femmes, l’usage administratif et les règles du savoir-vivre commandaient que l’on distingue entre la fonction et la personne : « Mme le président », « Mme le secrétaire général », « Mme le professeur émérite des universités ». « Mme la présidente » désignait la femme du président, « Mme la sous-préfète »… la femme du sous-préfet. Mais, de plus en plus, l’armée, la magistrature, la police embauchèrent des femmes. Il fallut donc les « nommer » : un policier/une policière, un sergent/une sergente… (Encore plus simple quand le nom est épicène, c’est-à-dire dont la forme ne varie pas selon le genre : un/une capitaine, un/une juge, un/une commissaire.) Et trouver des terminaisons féminines qui satisfassent à la fois la structure du français, ne heurtent pas l’oreille ou la vue ou ne déprécient pas la personne ou la fonction exercée (« procureuse », par exemple, s’est effacé devant « procureure » ; à l’inverse, « metteuse en scène » s’est imposé).
Avant, c’était simple :
il y avait les « métiers et
fonctions d’homme » et
les « métiers de femme »
Dès 1984, une commission de terminologie réfléchit à ces questions, avant que soit conçu, sous l’égide du CNRS et de l’Institut national de la langue française, un « Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions », publié au Journal officiel en 1999.
Comme toujours lorsqu’il s’agit du français, mais surtout du rôle et de la place des femmes dans la société, des résistances se firent jour. Avec des arguments où la misogynie se cachait à peine. Heureusement, une langue évolue et s’enrichit sans toujours attendre les textes officiels. Et des femmes écrivains, parmi les premières, tinrent à ce qu’on les distinguent de leurs collègues masculins en se proclamant « écrivaines ». Et revendiquèrent d’être appelées « auteures », usage qui se répandit dans les journaux et les publications spécialisées en littérature, avant d’être avalisé par un dictionnaire comme le Larousse. Néanmoins, cette désignation, qui se distingue à l’écrit, ne s’entend pas à l’oral, au point que certaines… auteures revendiquent l’appellation « autrices », qui eut droit de cité jusqu’au XVIIe siècle, avant d’être chassé des dictionnaires (elle fut réintégrée assez récemment par le Robert, assortie de la mention « rare »). Ces évolutions ne font pas toujours l’unanimité. Aussi le débat reste-t-il largement ouvert pour les journalistes, secrétaires de rédaction et correcteurs, qui sont en première ligne pour accompagner le mouvement, sans heurter de front ceux qui hésitent. Mais quitte à bousculer ceux qui, comme « Mme le secrétaire perpétuel de l’Académie française », continuent à résister.