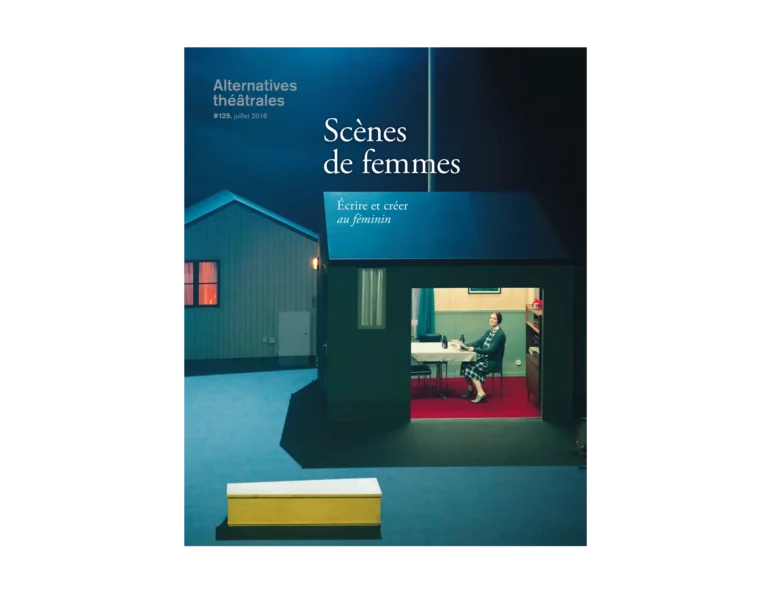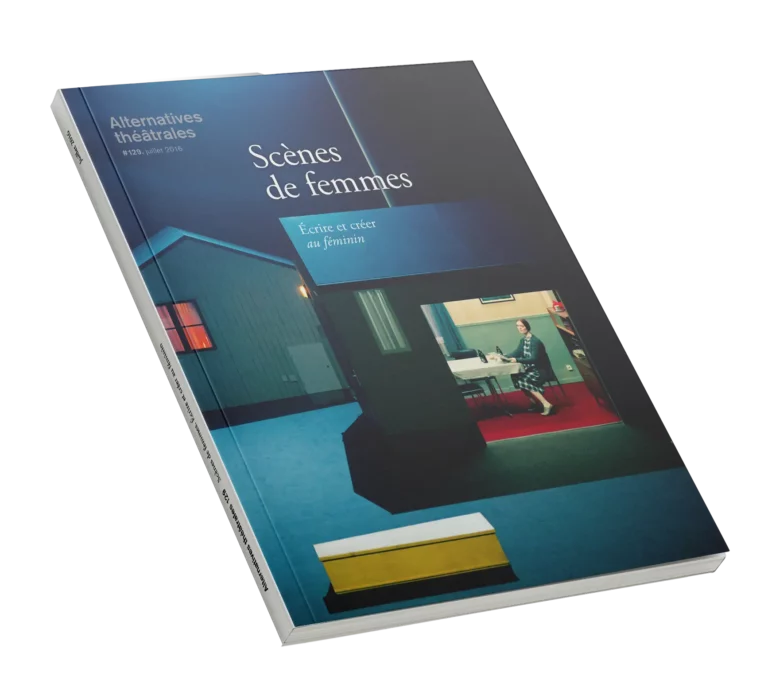Depuis les Pères de l’Église, haine du théâtre et haine des femmes ont eu partie liée : ce n’est pas un hasard si Tertullien écrit à la fois l’un des plus célèbres réquisitoires contre le théâtre (De spectaculis, ca 198) et l’un des plus virulents pamphlets misogynes (De cultu feminarum, ca 197 – 201). Les polémistes qui ont lancé de véritables campagnes théâtrophobes, en Europe, entre le dernier tiers du XVIe siècle et le milieu du XIXe, ont manifestement hérité de la misogynie des clercs : s’ils dénoncent les méfaits du théâtre, c’est souvent en les présentant – implicitement ou explicitement – comme typiquement féminins.
La pratique dramatique tend pourtant à gommer la différence de genre : hommes et femmes se trouvent en effet engagés dans la même activité, sur la scène (jouer) comme dans la salle (regarder et juger). Mais la différenciation est nette, qui va parfois jusqu’à la ségrégation. En France, pendant toute la première partie du XVIIe siècle, les femmes ne sont pas admises à la farce, présentée dans la deuxième partie de la séance ; dans les années 1630, les théâtres se dotent de galeries et de loges qui leur sont réservées. Si on leur ménage des espaces privilégiés et en quelque sorte protégés, cela les place aussi très explicitement sous le regard des spectateurs masculins. À quelques exceptions près, comme les loges grillagées, si elles regardent, c’est pour être regardées.
Les controverses sur le théâtre cristallisent cette participation genrée à l’expérience théâtrale. Les discours théâtrophobes singularisent les femmes, qu’elles soient actrices ou spectatrices : les premières incarnent le danger que représente le théâtre et les deuxièmes en sont les premières victimes. Si les premières sont un danger, les deuxièmes sont en danger.
Les actrices stigmatisées
Globalement, les acteurs – surtout itinérants – sont traités comme des marginaux et depuis l’antiquité romaine, on les accuse de s’exhiber sur scène pour de l’argent, c’est-à-dire de se livrer à une forme de prostitution. Les actrices sont encore plus exposées à ces accusations car, en exposant leur corps fardé dans des poses aguicheuses, elles suscitent des regards concupiscents et des passions incontrôlées. Le père Voisin fait preuve dans ce domaine d’une virulence exceptionnelle, en dénonçant l’actrice à la fois comme le contraire même de ce que doit être une femme honnête et comme le concentré de toutes les abominations que toute fille d’Ève représente intrinsèquement. Il fustige ainsi la séduction vénéneuse de la comédienne en scène : « La nudité de son sein, son visage couvert de peinture et de mouches, ses œillades lascives, ses paroles amoureuses, ses ornements affectés, et tout cet attirail de lubricité, sont des filets où les plus résolus se trouvent pris. […] Ce sont des machines qui font entrer la mort par les yeux, par les oreilles, et par tous les sens du corps de ceux qui s’y exposent. Voilà les fruits que remportent les Spectateurs : ils y reçoivent des leçons de péché : Ils l’y trouvent avec des attraits qui le fait aimer » (Voisin, 477). Séduction féminine et séduction théâtrale sont prises dans une relation totalement réversible : les charmes de l’actrice incarnent parfaitement la puissance du spectacle, celle d’un artifice qui piège les sens du chrétien pour le détourner de son salut.
L’actrice est aussi présentée comme un ferment de désordre politique et social. En Espagne, le père Mariana évoque des groupes de jeunes gens qui, aveuglés par leur désir, ont enlevé des comédiennes, en tirant l’épée contre les comédiens (Mariana, 426). Dans une longue suite d’anecdotes qu’il destine à Philippe II pour le convaincre de maintenir les théâtres publics fermés, Lupercio Leonardo de Argensola accumule les anecdotes de gentilshommes qui abandonnent leurs offices et leurs devoirs pour vivre dans le péché avec ces femmes perdues (Argensola, 66b). Pour cet ancien dramaturge, la pratique théâtrale n’est qu’un paravent pour une activité prostitutionnelle.
Même quand les femmes n’ont pas le droit de monter sur les planches, comme c’est le cas en Angleterre avant 1660, les théâtrophobes n’épargnent pas les comédiennes : pour qu’ils se déchaînent, il suffit qu’une actrice étrangère paraisse sur scène ou que, pour une représentation privée, des femmes amateurs interprètent un masque. Le plus virulent des polémistes anglais, William Prynne, compare le recours à des actrices et à des boy actors pour refuser de trancher entre deux maux également abominables (Prynne, 214 – 215). Il dénonce, dans les boy actors, le danger de l’effémination, à la fois pour les jeunes hommes qui, en contrefaisant leur voix et leurs attitudes, se font femmes, et pour les hommes qui, dans la salle, sont portés à un désir contre-nature. Comme il réveille en toute actrice le serpent qui sommeille, le théâtre émeut, en tout homme, la femme qui s’ignore.
La spectatrice, entre rapt, possession et perversion