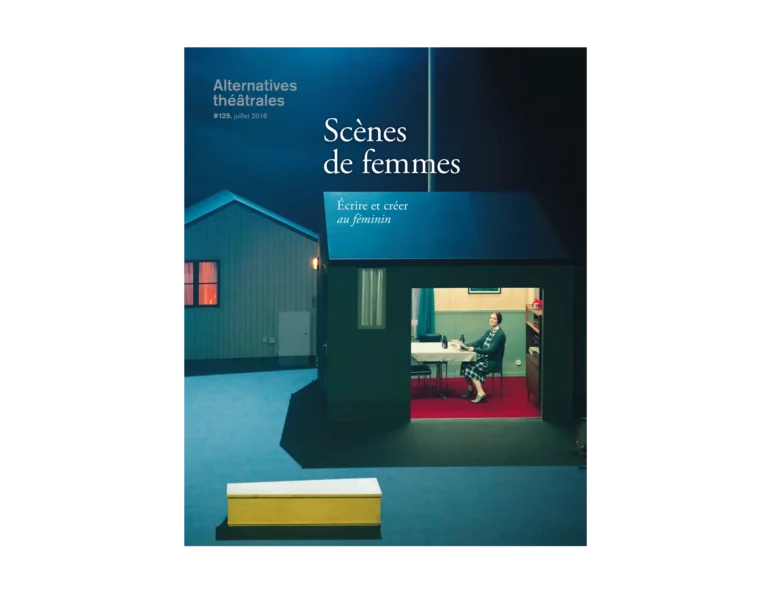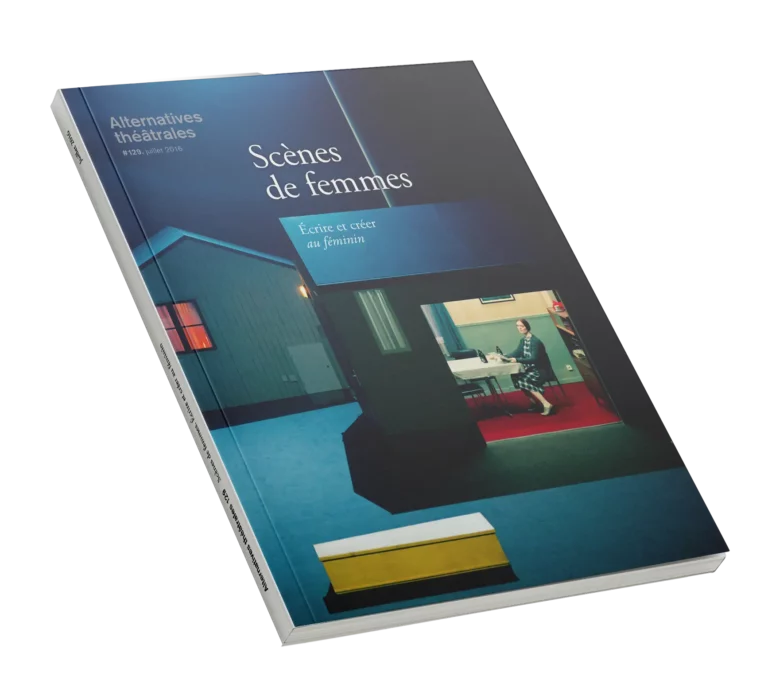Tout est allé vite, pour Maëlle Poésy. En 2011, à vingt-sept ans, à peine sortie de l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS), elle a créé sa compagnie, Crossroad (Drôle de bizarre). Elle a mis en scène Funérailles d’hiver, d’Hanokh Levin, Purgatoire à Ingolstadt, de Marieluise Fleisser et Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, d’après Voltaire. Candide a emballé les programmateurs, a beaucoup tourné, et la saison théâtrale 2015 – 2016 a été pour Maëlle Poésy celle d’une reconnaissance précoce et éclatante : la jeune femme a présenté Candide au Théâtre de la Cité internationale, et mis en scène, au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, Le Chant du cygne et L’Ours, deux petites pièces de Tchekhov. Et la voilà à Avignon, où elle est programmée dès l’ouverture du festival avec une création, Ceux qui errent ne se trompent pas, inspirée par La Lucidité, le roman de José Saramago.
Visiblement, aucun obstacle ne s’est dressé sur la route de la jeune « metteuse en scène » qui, comme beaucoup d’autres aujourd’hui, assume ce terme plutôt que celui de « metteure en scène », trop neutre. « Je préfère que les fonctions soient vraiment mises au féminin. Il me semble important qu’il existe des mots féminins attribués à certaines fonctions, et que ceux-ci entrent peu à peu dans l’usage. Mais j’ai pas mal de soucis avec les services de relations publiques des théâtres, qui, la plupart du temps, refusent d’employer le terme de « metteuse en scène » dans leurs documents de communication… ».
Maëlle Poésy s’amuse que l’« on pose toujours les mêmes questions aux femmes-metteurs en scène, notamment celle de savoir si nous traduisons dans nos spectacles un point de vue féminin sur le monde. Mais on ne demande jamais aux metteurs en scène hommes s’ils imprègnent les leurs d’un regard masculin ! ». « Je ne m’envisage pas du tout comme femme metteuse en scène, mais comme metteuse en scène tout court, poursuit-elle. On fait du théâtre avec sa subjectivité, quelle qu’elle soit, et elle n’est pas réduite à la question sexuée. Et au sein de mon équipe, qui est constituée de femmes et d’hommes, c’est une question que je ne me pose jamais, et que l’on ne me pose jamais ». Pour autant, la jeune femme reconnaît l’importance d’une démarche politique et volontariste, dans un théâtre français qui a tardé à accorder une place aux metteuses en scène. « L’impulsion donnée par Aurélie Filipetti a réellement entraîné un changement, et ouvert des portes. Nous nous retrouvons aujourd’hui plus nombreuses », constate-t-elle. Mais Maëlle Poésy n’aime pas beaucoup les étiquettes. « Et je ne suis pas une grande fanatique des « gender studies » à l’américaine. Je travaille plutôt à l’intuition. Ce qui m’importe, c’est que la pensée du monde soit partagée, au théâtre. La pensée est un apanage humain, et non genré ».
Elle s’étonne, quand on lui dit que l’on peut voir, tout de même, dans sa mise en scène de L’Ours, un regard féminin porté sur la pièce de Tchekhov, une interprétation qui tranche avec celles qui ont souvent pu être apportées à cette œuvre de jeunesse de l’auteur russe. Ce n’est pas tant que le regard porté sur le personnage féminin soit différent – quoique… –, dans cette pièce qui confronte une jeune propriétaire, qui joue les veuves éplorées depuis sept mois, et un jeune propriétaire en colère, lesquels se lancent dans une vaste scène de ménage, avant de tomber dans les bras l’un de l’autre. C’est plutôt que les rapports homme-femme y soient envisagés avec plus de subtilité qu’ils ne le sont le plus souvent dans cette pièce, la plupart du temps montée comme une simple farce avec les stéréotypes d’usage, projetés aussi bien sur l’homme – forcément un rustre et un goujat – que sur la femme – forcément une hystérique.