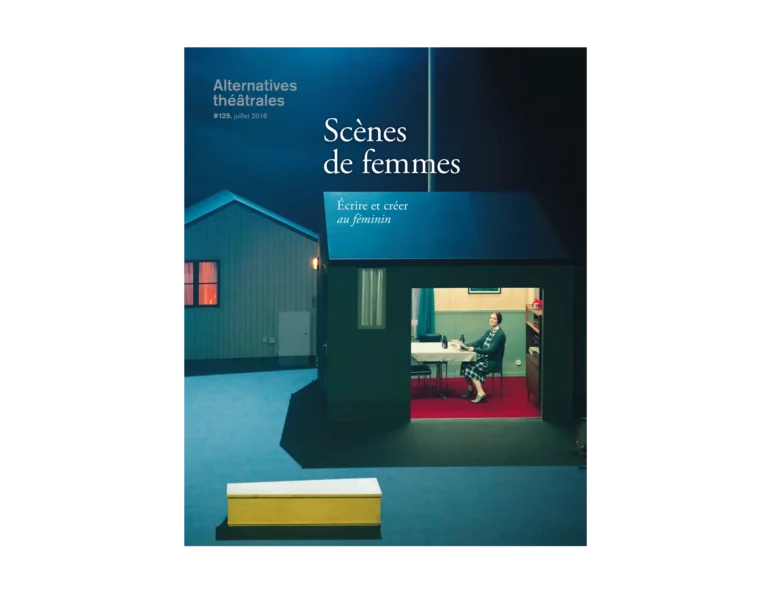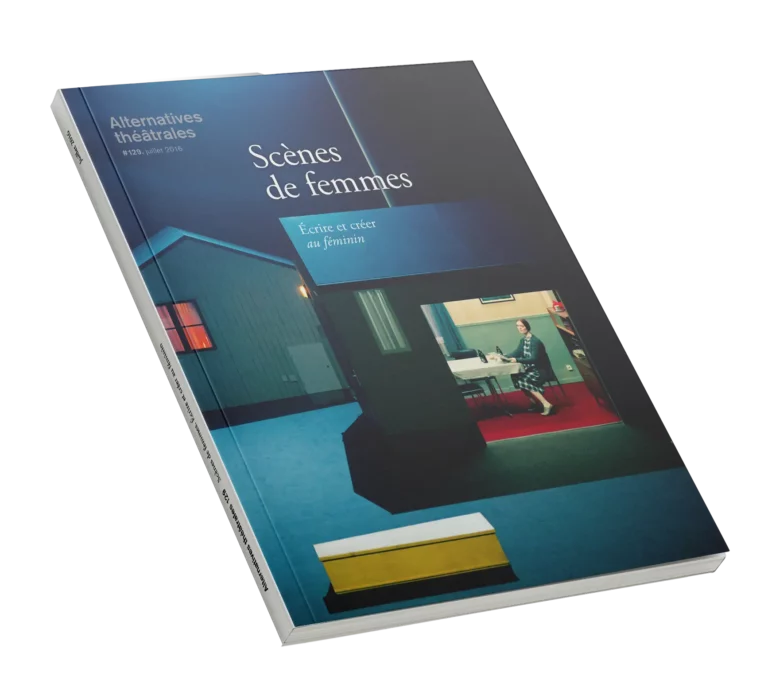Longtemps cantonnée aux théâtres de « mauvais genre », tels les Foires, les Boulevards, plus tard le Grand Guignol ou le Théâtre érotique de la rue de la Santé, enfin le cabaret ou le café concert, voire la redécouverte de l’effeuillage dans le sillage du New Burlesque, la nudité a soudain basculé, dans les années 1970, du côté de l’avant-garde et de l’expérimentation artistique, notamment depuis Dionysos in 69 de Richard Schechner en 1967 ou Paradise now par le Living Theatre au Festival d’Avignon en 1969. Cette tendance a atteint un point culminant avec la programmation conçue par l’artiste invité Jan Fabre pour l’édition 2005 du Festival d’Avignon, provoquant la cabale que l’on connaît1. Entretemps, on est passé d’une monstration honteuse et sublimée de la nudité, jouant sur les artifices théâtraux afin de contourner l’interdit en le rendant acceptable au regard d’un public populaire à la fois friand de frileux, vers une exhibition assumée et désinhibée, cherchant le scandale et repoussant le seuil d’intolérance d’un spectateur rompu à l’image médiatique ou publicitaire à caractère sexuel, scatologique ou pornographique2. De là à penser l’exposition scénique des corps dans les termes d’une « éroscénologie »3, il n’y a qu’un pas…
Alors que la controverse sur les scènes de sexe non simulé agite le monde du cinéma, notamment depuis la sortie de Love de Gaspar Noé en 20154, ou que le milieu de la production pornographique se structure autour de modes d’exploitation capitalistes, selon une culture de métier largement hétéro-normative5, le théâtre s’interroge6 de façon distanciée sur la finalité de mettre en scène une nudité d’autant plus ambiguë qu’elle s’exerce en coprésence entre un acteur en situation d’exhibition et un spectateur en position de voyeur, a fortiori dans le cadre d’un service de prestation tarifée. Espace transitionnel autant que transactionnel, la séance théâtrale offre donc un dispositif en mesure de mettre en cause le repositionnement idéologique et esthétique dont relève une posture post-féministe revendiquant la nudité ostentatoire comme vecteur d’un engagement politique malgré tout ambigu : émancipation contrariée ou conscientisation active, la surenchère obscène ou pour le moins inconvenante d’une partie du théâtre de performance porte à nouvel examen la question des stéréotypes de genre et de la responsabilité de l’art dans leur réactivation, à moins qu’il ne s’agisse de leur déconstruction sujette à caution…
Lauréat en 2013 de la cinquième édition du festival « Impatience », coordonné par le Cenquatre, la Colline et le Rond-Point, Bad Little Bubble B., proposé par la compagnie Mesden à l’issue d’une résidence à la Loge, mis en scène par Laurent Bazin et interprété par Cécile Chatignoux, Céline Clergé, Lola Joulin, Mona Nasser et Chloé Sourbet, expose cinq corps de femmes dénudés dans une proposition scénique hybride, située entre conférence, danse, théâtre, pantomime et performance. Y sont tour à tour exposés la domination masculine, l’aliénation de la femme, l’exploitation sexuelle, la possibilité d’une jouissance, voire d’une pornographie féminine et la responsabilité de la femme dans la reproduction des stéréotypes de genre. Qu’il s’agisse de simuler l’orgasme sous les injonctions d’une voix off, de simuler un casting pour un strip-tease, d’animer un tchat érotique sur les réseaux sociaux, de dévoiler les mécanismes du plug anal, de commenter les catégories des sites pornographiques, de s’entremêler dans un corps à corps tantôt sensuel, tantôt convulsif, le spectacle dérange, sans jamais sombrer dans la complaisance. Postures et discours associés à la « pornification » de notre société post-moderne sont convoqués sur scène par une succession de tableaux vivants tantôt brutaux, tantôt grinçants, tantôt franchement hilarants. Si l’objectif affiché est de s’en prendre à « la crise du sens à l’heure de l’hyper-exploitation des désirs »7, au moyen d’un protocole où « cinq femmes mettent à l’épreuve notre voyeurisme », ce sont bien, de façon faussement provocatrice, une nouvelle fois, des femmes qui se déshabillent à la demande d’un metteur en scène masculin, dans une proposition artistique qui vise la « puissance d’intranquillité »8. Mobilisant le répertoire des numéros du théâtre érotique, voire des Slide Shows et Freaks Shows, exploitant les possibilités performatives des corps exhibés, le dispositif met avec lucidité en abyme le discours scientifique des Porn Studies, à l’instar d’une séquence particulièrement bienvenue de conférence-performance parodiant l’expertise académique et le jargon psychanalytique. Plaçant l’exhibition du corps féminin sous le regard des hommes dans l’ère du soupçon, il exacerbe la pulsion scopique, tout en rendant justice à la libido sciendi d’une « volonté de savoir ».
Éloge de la nudité
La finalité du spectacle n’est certes pas douteuse, conformément à ce que son titre programmatique laisse présager, en se référant à la fois au B. final qui renvoie « à certaines obscénités qui abondent dans la culture pornographique », en particulier les Bubble Butts, succédané audiovisuel des théâtres de spécialité, et au principe poétique de composition d’une « élaboration bulleuse », « comme une sorte de montée de bulles à la fois irrépressible, imprévisible et anarchique ». Laurent Bazin caractérise sa proposition artistique comme un « peep-show euphorique qui rend hommage à la vitalité créatrice et au pouvoir de métamorphose de l’acteur ». Il l’assimile à une « divagation spectaculaire » qui « entremêle l’éloge plastique du genre pornographique et sa critique »9, se montrant confiant dans le pouvoir subversif intrinsèque de ces images et imaginaires détournés et dans les vertus roboratives d’une « investigation poétique et critique ». L’homme de théâtre convoque ainsi sur scène « certaines obscénités qui abondent dans la culture pornographique », en particulier la « catégorie ludico-trash du porno », refuse les catégorisations de spectacle érotique ou pornographique et surtout compte sur un processus de double réception : « un temps où l’image nous tient captifs, et le moment réfractaire où le support nous apparaît dans toute sa vulgarité et sa laideur »10.
La gageure de ce « spectacle en droit impossible et coupable » est parfaitement consciente : « Un homme qui monte un spectacle sur la pornographie avec cinq filles, sur le papier c’est accablant. Nous étions tous conscients de cette faute originelle, sujette à tous les malentendus, mais nous avons justement décidé de nous nourrir de ce foyer d’impossibilités »11. Elle explique la réticence du collectif à rendre public un travail d’atelier d’abord élaboré en huis clos à l’occasion d’une résidence artistique qui n’avait pas vocation à donner lieu à représentation ; on en conserve la trace dans la dimension méta-théâtrale et auto-parodique d’un spectacle soucieux de plonger dans la « nébuleuse pornographique » par un système collectif d’énonciation mêlant travail à la table et improvisation au plateau :