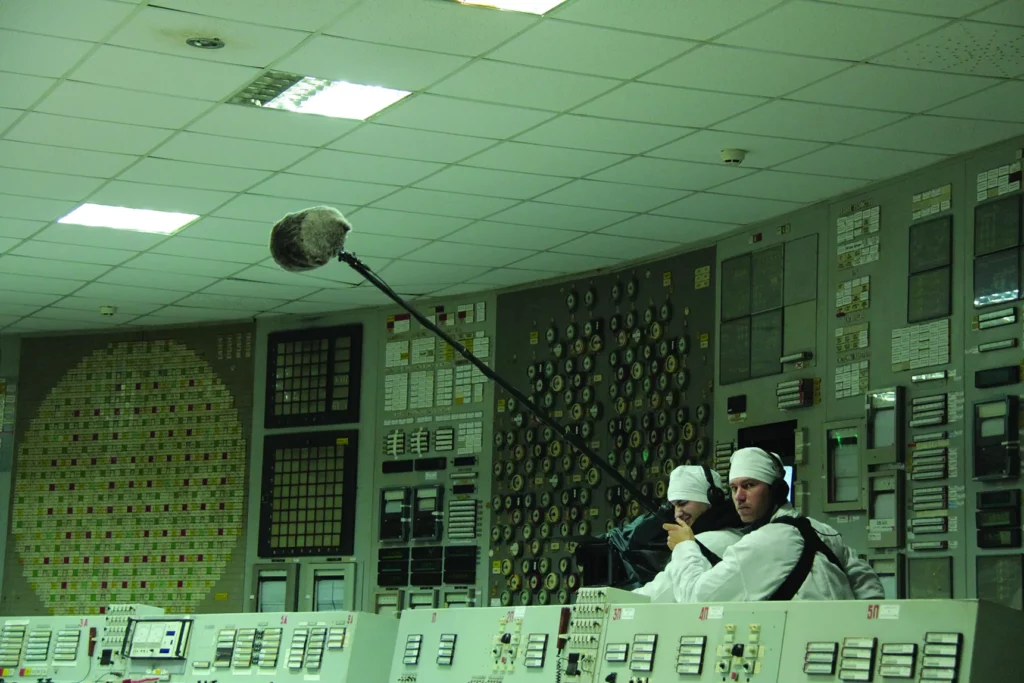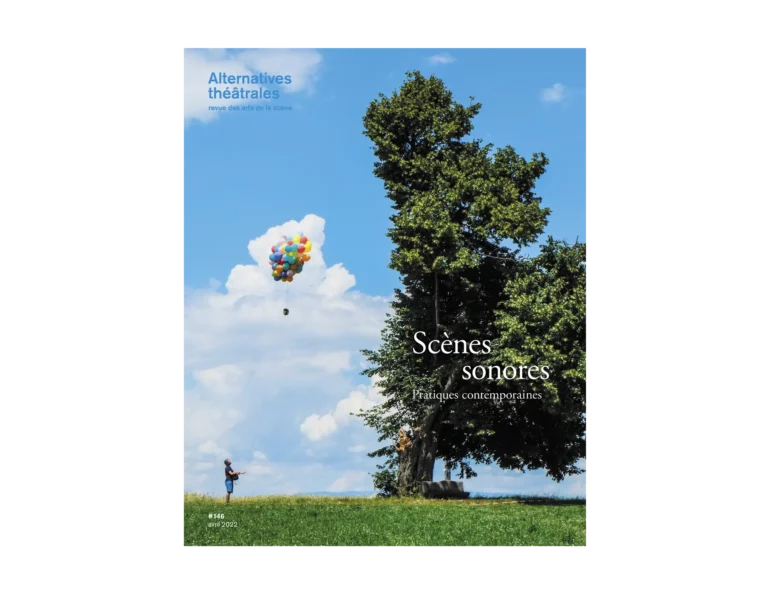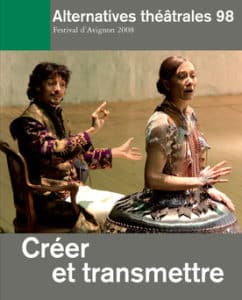Artiste sonore, pédagogue et ingénieur du son pour le cinéma, Félix Blume place l’écoute au centre de son travail et développe depuis de nombreuses années une œuvre protéiforme, entre pièces sonores, vidéos et installations qui invitent à modifier notre perception de l’environnement au travers de la matière sonore. Il vit entre la France, le Mexique et le Brésil.
Lors d’une conférence au Centre Pompidou1 tu évoquais l’idée de brouiller les frontières de ce qui relève de l’artistique et ce qui relève de la technique dans les métiers du son, pourrais-tu développer un peu plus cette question ?

C’est curieux : lorsque je fais une création sonore, je suis considéré comme un artiste et lorsque j’exerce en tant qu’ingénieur du son pour un film réalisé par quelqu’un d’autre comme un techni- cien. Il y a un changement de statut alors que pour moi toutes ces activités sont la continuité d’une même démarche. J’aime beaucoup le terme « sonidista » utilisé en Amérique Latine hispa- nophone pour désigner celui qui travaille le son comme une matière sans distinguer le technique et l’artistique. Un peu comme « peintre » qui peut désigner à la fois celui qui utilise la peinture comme matériel de création et celui qui peint un mur. Il n’y a pas d’équivalent en français pour « sonidista », parfois on utilise « sondier » dans le milieu des arts du spectacle, mais ce mot a une connotation purement technique. J’aime l’idée de travailler le son comme une matière. Une même prise de son peut aussi bien être considérée comme technique ou artistique selon le contexte de son écoute. Plus que l’acte de l’enregistrement, c’est l’acte de l’écoute qui détermine le statut d’un son. L’artistique n’est pas dans le faire mais plutôt dans la réception. Je considère mon travail d’artiste sonore ou d’ingénieur du son comme n’étant qu’un point entre un son qui existe par lui-même et les personnes qui vont l’écouter. Ces sons ne m’appartiennent pas. Certes, je les ai enregistrés avec mon microphone et j’ai choisi le moment de le faire : dans l’acte d’enregistrer, de choisir un son, d’en faire un montage ou de faire une création sonore il y a, bien entendu, une dimension subjective, mais finalement je ne suis qu’un passeur entre différentes réalités et certaines oreilles, certaines écoutes possibles. L’objectif pour moi c’est que l’auditeur de mes pièces sonores puissent sortir dans la rue le lendemain et écouter autrement les sons de leur propre environnement. Plutôt que d’inviter l’auditeur à « dévorer » des paysages sonores, je préfère l’inviter à écouter le monde qui l’entoure et à vraiment l’écouter, sans essayer d’annuler ou d’évacuer tout ce qui pourrait être considéré comme étant de la pollution sonore, comme quand on met un casque dans le métro pour créer une barrière avec le monde réel. On s’attache souvent à la question de l’architecture ou à la culture par rapport à un lieu ou à un pays, mais on se pose assez peu la question du quotidien sonore d’un lieu, il y a beaucoup de sons disparus, d’autres qui surgissent et on ne se soucie pas d’en prendre conscience. Alors que l’écoute est justement quelque chose qui peut nous aider à comprendre l’Autre et les Autres. En pensant les Autres pas forcément comme des humains mais comme des êtres en général. Ce qui me tient à cœur, c’est qu’une écoute puisse dépasser le sonore.
Le point de départ de ta démarche artistique multi-médiatique était le cinéma ?
C’est par la musique que je me suis intéressé au sonore, j’ai pratiqué la percussion classique pendant dix ans au Conservatoire. J’ai choisi de faire un BTS audiovisuel avec l’idée de travailler pour la sonorisation des concerts mais je me suis assez vite rendu compte que le rythme de vie de ce métier ne me convenait pas. J’ai alors enchaîné avec une formation à l’INSAS – Institut Supérieur des Arts, une école de cinéma à Bruxelles, en option son. En en sortant en 2008, j’ai commencé à travailler comme preneur de son principalement pour des documentaires et assez rapidement j’ai pris cette « étiquette » du preneur de son, un peu aventureux, pour des projets dans des pays lointains. En 2005, j’étais parti dans un petit village au Mali pour travailler sur un premier projet – un documentaire sur les peuls. La rencontre d’une réalité complètement différente fut un choc et la qualité d’écoute que ce dépaysement a provoqué en moi était une expérience si forte que j’ai voulu la retrouver. Le fait de pouvoir rencontrer des lieux, l’Autre et d’apprendre à travers le sonore est quelque chose qui a beaucoup marqué mon travail.
Dans quelle mesure ces aller- retours entre différentes espaces géographiques ont impacté ta propre écoute ? La relation qu’on peut avoir avec le bruit, par exemple, n’est pas du tout la même au Mexique, au Brésil ou en France.
Je pense que le statut d’étranger, le fait d’arriver dans un endroit qu’on ne connaît pas change nos habitudes y compris par rapport à l’écoute. C’est la même idée qu’avec le bruit du frigo : on s’y habitue et on ne l’entend finalement que quand il s’arrête. Lorsqu’on va dans un autre endroit tout d’un coup on se dit « Ah, oui, là il y a tel oiseau » ou « il y a telle ou telle chose qui manque » parce que les sons ont changé. On ne questionne pas son environnement sonore quand on est dedans, ce n’est qu’à partir du moment où celui-ci change qu’on prend conscience du nouveau et de l’ancien. Cet aspect est très présent dans Los Gritos de México (2014). Quand j’étais à Mexico, je vivais en plein centre avec tous ces vendeurs qu’on entend dans cette création sonore. Avant ça, je vivais à Bruxelles où il y a ce silence un peu partout. Le contraste avec Mexico pouvait me donner l’impression d’une ville morte quand j’y revenais. J’ai pris ainsi conscience de l’identité sonore d’un lieu : quels sons me font penser que je suis à Bruxelles ? Est-ce qu’il y a une marque sonore de cette ville ou de ce lieu que j’habite ? Quand j’arrive à Mexico City au contraire, une seule minute d’enregistrement contient déjà assez d’éléments sonores pour reconnaître la ville. Mexico City a une forte identité sonore mais peut-être que les personnes qui y vivent, entourées par tous ces vendeurs, ne s’en rendent pas compte parce que cela fait partie de leur quotidien. Le fait de voyager permet de travailler cette écoute du détail et des différences.