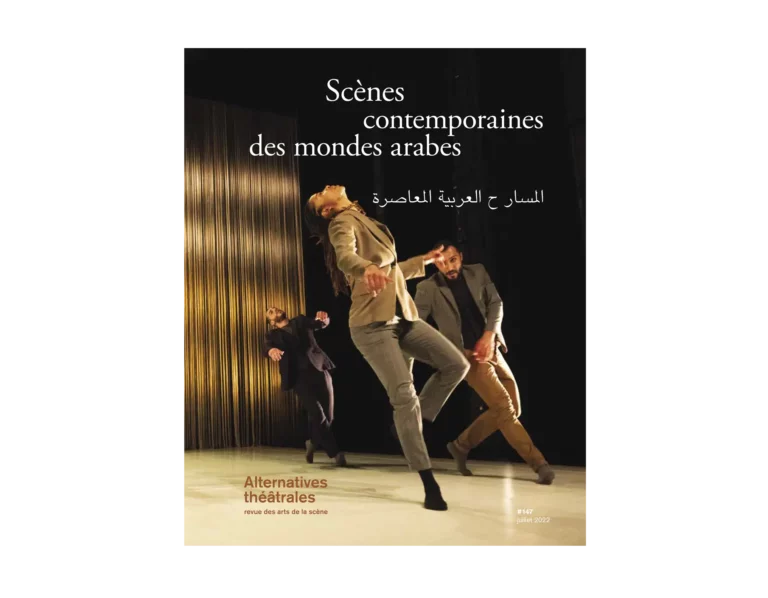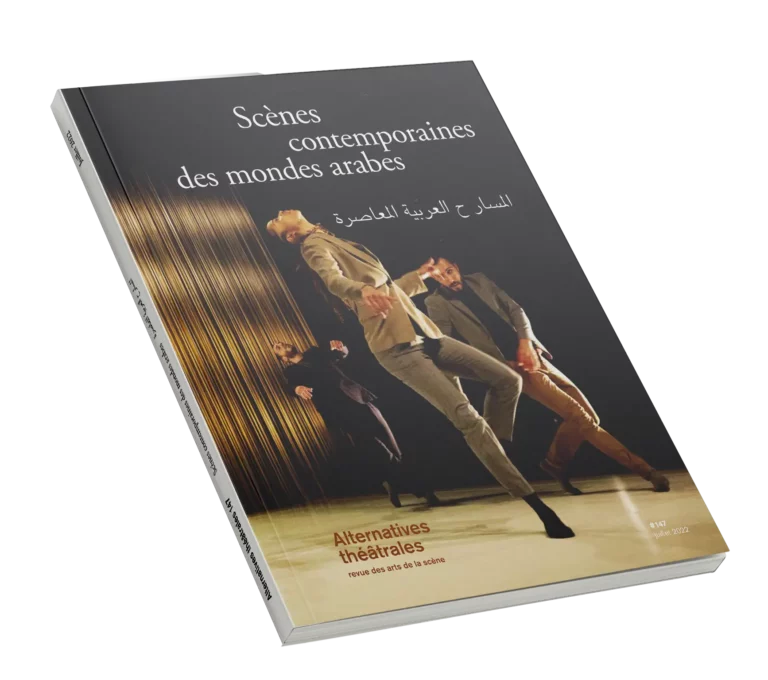Ils s’appellent Mourad Merzouki, Héla Fattoumi, Kader Attou, Farid Berki…
Le paysage chorégraphique regorge de chorégraphes aux racines familiales maghrébines. Certains font de leur héritage culturel un élément porteur de leurs créations, d’autres l’évoquent à peine. Par contre, il est rare de rencontrer des chorégraphes qui ont commencé à créer de la danse dans leur pays d’origine pour s’implanter en Europe par la suite. Ceci pour des raisons diverses, qui tiennent tout d’abord aux possibilités qui sont plus que limitées, en Algérie d’abord, mais même en Tunisie et au Maroc. Dans ces pays, où la danse d’auteur n’est pas soutenue, il est difficile de se revendiquer artiste chorégraphe. L’émergence d’un vrai tissu de danse contemporaine au Maghreb est un projet qui ne cesse de renaître et de subir des revers, faute d’un soutien institutionnel qui serait pensé sur la durée. Dans le paysage chorégraphique, en France et en Belgique, l’enrichissement est considérable.
7 ans, 5 ans, 2 ans…
La plupart des chorégraphes qui travaillent en Europe et font résonner dans leurs créations les échos du Maghreb sont nés de couples venus d’ailleurs – c’est le cas d’Abou Lagraa ou de Rachid Ouramdane – ou bien de couples mixtes (Ali et Hèdi Thabet, Sidi Larbi Cherkaoui…). Beaucoup d’autres sont arrivés jeunes, très jeunes : Fouad Boussouf, à l’âge de sept ans. Nacera Belaza, à cinq ans. Héla Fattoumi, à deux ans. Ces deux ans de vie font-elles une différence avec un certain Angelin Preljocaj, arrivé dans le ventre de sa mère depuis Tirana en 1956 ? Dans les créations du directeur du Centre chorégraphique national (CNN) d’Aix-en-Provence, les traces de liens avec l’Albanie sont infimes. Par ailleurs, il ne parle que peu la langue maternelle de ses parents et met rarement le pied à Tirana. Il en va autrement chez les enfants de parents maghrébins, où les liens familiaux avec les pays d’origine restent aussi intenses que la cohésion communautaire dans les pays d’accueil. D’où une double culture faisant partie intégrale de leur identité, qui peut devenir le moteur d’échanges culturels. Ainsi, Nacera Belaza a enseigné la danse contemporaine à Alger alors qu’Abou Lagraa et son épouse marocaine, Nawal Aït-Benalla, se sont investis à partir de 2010 dans la création d’une cellule de danse contemporaine au sein du Ballet national d’Alger, créant avec des danseurs de rue algériens une pièce qui remporta, en 2011, le Grand prix de la critique française du meilleur spectacle de danse, Nya, un doux rituel oriental dansé sur le Boléro de Ravel.
« Je ne peux créer qu’en mon pays. »
Il n’est cependant pas impossible de se mettre à la danse à Tunis et de faire une belle carrière en France, comme le prouve le couple et duo Aïcha M’Barek/Hafiz Dhaou, véritables passeurs entre les deux rives. En 2002, Hafiz créa à Tunis Zenzena (Le cachot), un solo subtilement subversif, dénonçant officiellement l’empêchement de bouger causé par une blessure au genou. Le public sut en faire une lecture plus politique… En 2005, ils créent en France leur compagnie, Chatha (une danse), et deviennent aussi une référence en Tunisie. En 2011 et 2012, ils assurent la direction artistique des Rencontres chorégraphiques de Carthage. On pourrait comparer leur situation à celle d’un autre chorégraphe, Radhouane El Meddeb, qui a lui aussi commencé son parcours artistique à Tunis. Mais c’est le théâtre que Radhouane a pratiqué à Tunis ! En danse, il ne s’est révélé qu’une fois installé en France, avec un solo au titre désarmant : Pour en finir avec moi. Et il fonda la Compagnie de SOI, dès le départ identifiée comme chorégraphique. Conclusion : les chorégraphes transfuges venant du Maghreb sont bien plus rares qu’on ne le pense. Pourquoi ? Nawel Skandrani, la pionnière tunisienne, donna une part de réponse en 2019, au Festival Carthage Dance où elle déclara : « Je ne peux créer qu’en mon pays. » Et ce alors qu’elle doit affronter tous les empêchements matériels : « En trente ans, je n’ai pas été reçue une seule fois au ministère pour parler de mon travail. » On pourrait alors parler d’exil chorégraphique intérieur.
La Tunisie, telle une douleur fantôme
Radhouane El Meddeb, naturalisé français depuis 2008, a choisi l’exil géographique et culturel. Vivre à Paris lui offre plein de possibilités. Sauf une. À l’heure de la révolution tunisienne en 2011, il était condamné à suivre les événements en ligne, au lieu de pouvoir être présent et soutenir ses proches et son peuple. C’est à partir de ses remords qu’il créa en 2012 son solo Tunis, 14 janvier 2011, une performance où il se mêla aux spectateurs pour partager sa détresse par un état de corps tourmenté, tiraillé, instable et au bord du vide. Celui-ci resurgit en 2016 dans son solo À mon père, une dernière danse et un premier baiser : « À mon père, j’ai envie de raconter la révolution, le changement, l’espoir de tout un peuple arabe d’un monde meilleur, libre et juste. Avec mon père, j’ai envie de partager notre désarroi, la menace d’une pensée extrémiste, obscure et la pensée d’un futur meilleur. À mon père, je veux hurler ma colère, mes angoisses dans un monde de plus en plus violent, hurlant, chaotique. » Il le fait d’un geste désarçonné, sur le mode de la confession et sur les Variations Goldberg de Bach. Dans ses solos, El Meddeb révèle donc sa condition d’exilé, plus que tout autre chorégraphe d’origine maghrébine. Un double exil même, car son corps dont il assume la différence, par sa générosité des volumes et de la volupté, est en soi un étranger dans le paysage de la danse. Mais El Meddeb crée aussi des pièces de groupe et quand celles-ci se réfèrent au monde arabe, il dévoile sa part romantique. À l’occasion de Face à la mer, pour que les larmes deviennent des éclats de rire (2017), il écrit par rapport à sa relation avec la Tunisie, cette autre moitié de lui-même qu’il voit lui échapper :