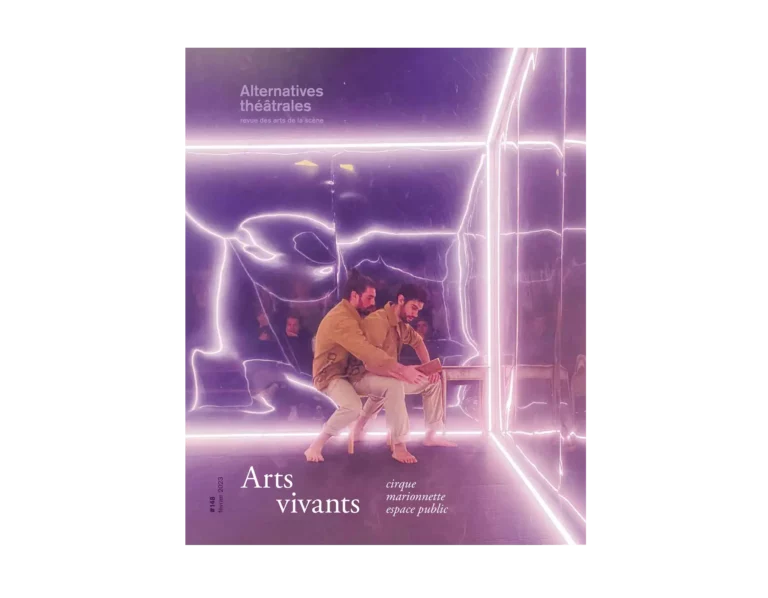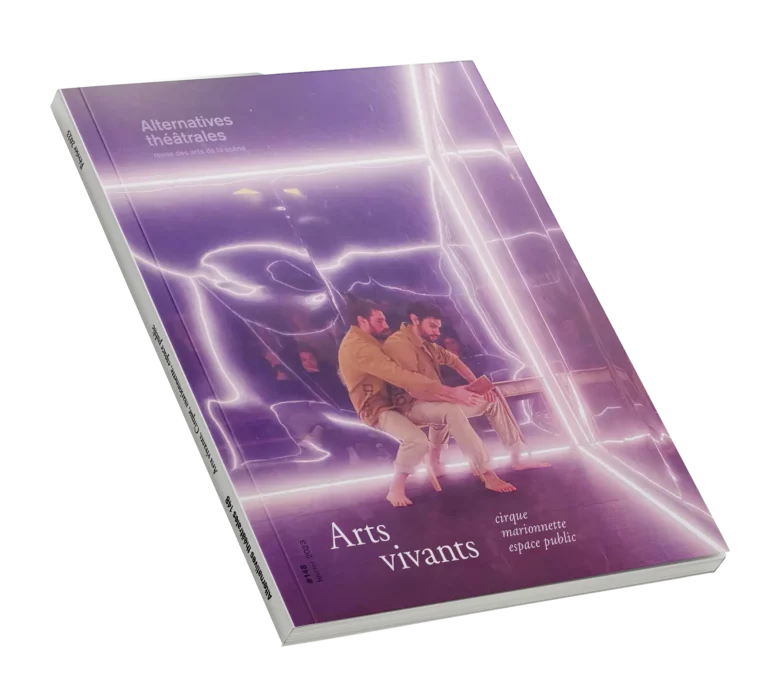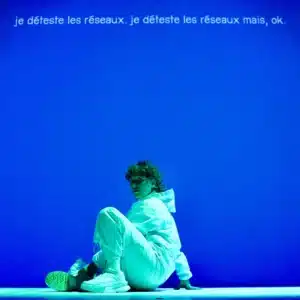Longtemps, le terme « Boerenzij » fut utilisé de manière désobligeante pour désigner les travailleurs migrants ruraux et leurs familles installé·e·s dans les quartiers et sur d’anciennes terres agricoles près des ports de Rotterdam, sur la rive sud de la Meuse. Beaucoup venaient de très loin, laissant derrière elles et eux les communautés et les modes de vie ruraux. Ce sont les Rotterdammois·e·s du nord de la Meuse qui les appelaient « boeren » (paysan·ne·s). Quand j’ai déménagé à Rotterdam en 1992 et que je me suis installée sur la rive sud, les gens m’ont dit que j’habitais à Boerenzij. Excellent, pensais-je à l’époque, et aujourd’hui, trente ans plus tard, j’y vis toujours.
Ville portuaire
À partir de la fin du XIXe siècle, la ville et le port de Rotterdam annexent de plus en plus de polders et de villages. Lentement mais sûrement, des résidences de plus en plus cossues, des restaurants et lieux de loisir apparaissent sur la rive sud. Pendant ce temps, la migration continue ; de nos jours, les quartiers anciens et nouveaux continuent à attirer les nouveaux.elles arrivant·e·s. Certain·e·s viennent travailler dans les serres ou le secteur du bâtiment, d’autres viennent étudier ou vivre dans un lieu sans guerre, d’autres encore veulent un nouveau penthouse avec une vue panoramique sur les quais. Depuis des décennies, dans ce contexte, la gentrification est particulièrement visible autour de Rijnhaven et sur Katendrecht. Des tours d’immeubles conçues par d’éminents architectes dominent les entrepôts convertis où le tabac et d’autres produits coloniaux étaient stockés dans le passé, et qui ont maintenant été désignés comme sites du patrimoine industriel. La colonisation, la mondialisation et la migration sont au cœur de Rotterdam et de son port international. Le projet d’art Boerenzij n’a cependant pas été conçu comme un document local mais plutôt, à l’instar de Walter Benjamin lorsqu’il compare la microanalyse à un cristal, comme l’exposition de la structure d’une dynamique plus grande en se concentrant sur un seul moment. Boerenzij nous met au défi de repenser la culture urbaine. Pourquoi les agriculteur·ice·s locaux.ales sont-iels censé·e·s abandonner leurs terres pour faire place à l’urbanisation et pourquoi les nouveaux.elles arrivant·e·s sont-iels implicitement censé·e·s laisser derrière elles et eux leurs connaissances et leur culture rurales ? Le temps est venu pour la culture rurale de retrouver une place dans la ville et de contribuer à la construction d’un avenir collectif. D’autres formes de connaissances engendreront un ensemble révisé de valeurs et de nouvelles façons de voir. Car le fait que pour la première fois dans l’Histoire, la population urbaine dépasse la population rurale ne signifie pas nécessairement que l’urbanisation a prévalu. Souvent, la migration rurale n’est qu’une des nombreuses conséquences de l’utilisation des terres et de la géopolitique.
L’art dans la ville
La transformation de mon quartier de « périphérie urbaine » en « partie du centre » génère des changements rapides de perspective et modifie la dynamique de la culture informelle et institutionnalisée. Au Kop van Zuid, nous voyons de plus en plus d’instituts d’art et d’activités culturelles et de loisirs. L’art est considéré comme faisant partie intégrante des nouvelles économies postindustrielles. Ainsi, l’idée que l’art renforcerait économiquement les villes a commencé à prendre racine au cours des trois dernières décennies. Cela ne m’a pas surprise, car le modèle artistique selon lequel j’ai été formée aux Pays-Bas dans les années 1980 associe presque automatiquement la haute culture aux modes de vie urbains et occidentaux. C’était tellement évident que personne n’a même pris la peine de le mettre en mots. Le monde de l’art au milieu des années 1980 était un bastion de longue date, enraciné et masculin. Puis vint la chute du mur de Berlin et la mondialisation s’accéléra. Cela a rendu les années 1990 plus hétérogènes et j’ai entendu de nouvelles voix de mondes inconnus, mais même alors, l’instrumentalisation de l’art et des travailleur·euse·s de l’art et la demande inattaquable d’une monoculture étaient à l’affût.
Cependant, le fait demeure qu’aux Pays-Bas et à Rotterdam, des groupes de plus en plus larges de créatif·ve·s travaillent dans des zones urbaines nouvelles et établies, ce qui est très bon pour la couche d’humus et la qualité de vie dans la ville. Mais comment nourrir cette couche d’humus si la haute culture, fidèle à la tradition, continue de l’étouffer ? Qui aura son mot à dire ? Qui a une voix ? Comment quelque chose comme une culture rurale partagée avec les nombreux contextes et langages, visuels et autres, peut-elle acquérir une valeur durable dans la culture urbaine contemporaine désormais dominante ?