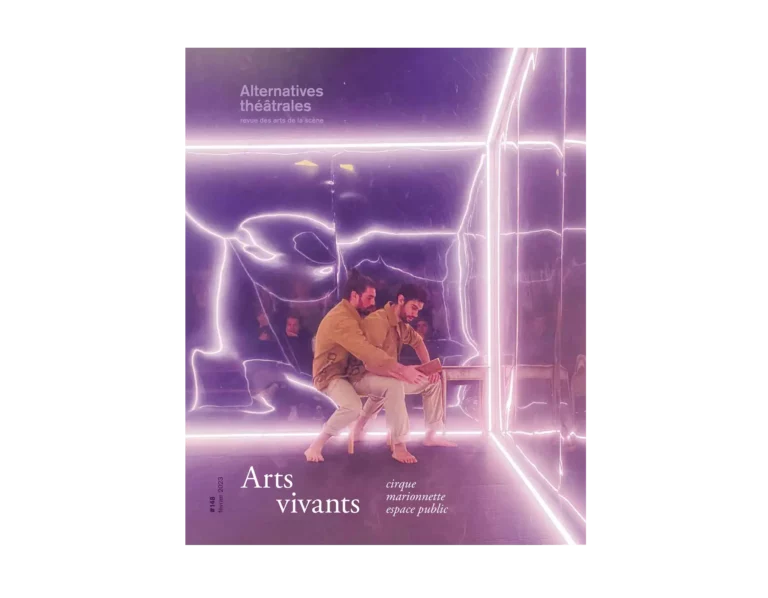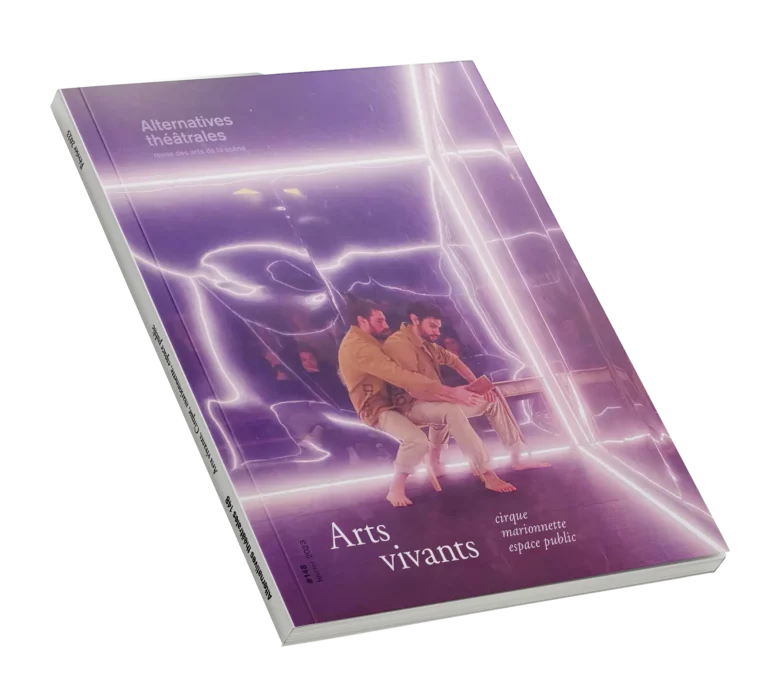Dans l’expression « arts de la marionnette », le mot « marionnette » est un terme générique pour désigner aujourd’hui toute forme théâtrale dans laquelle l’inanimé s’anime. Cet inanimé, qui en l’occurrence peut être une marionnette, un objet, une matière, un corps, une image, des mots, des ombres, de la lumière, une machine… s’anime sous l’impulsion d’un manipulateur, d’un comédien-interprète, d’un corps danseur ou circassien le temps d’une représentation.
Le champ est donc très vaste et très libre. Il s’invente, se renouvelle sans cesse au gré de l’évolution et des rencontres des différentes disciplines en jeu. Ouvert sur son époque, il est friand des hybridités générées par divers croisements que ses artistes se plaisent à multiplier : tradition, technologies de pointe, histoire, arts numériques, patrimoine, cultures, anthropologie, sciences, mouvements artistiques, musique, arts plastiques, danse, cirque, arts de la rue, arts forains, peinture, écritures théâtrales contemporaines, textes classiques, littérature, philosophie, cinéma, documentaire… Dans l’expression « arts de la marionnette », il faut donc entendre les marionnettes sous toutes leurs formes et leurs arts associés.
On considère donc qu’une forme relève des arts de la marionnette dès lors que sur le plateau du théâtre se mélangent diverses disciplines artistiques et que l’on dépasse le champ théâtral classique du jeu de l’acteur et du texte. Le sens n’est plus ou pas seulement porté par le texte, il se dégage ou se développe dans le jeu, le mouvement, dans la relation à l’espace, aux corps, aux objets, à la marionnette, à la matière, à l’image, à la lumière, aux dispositifs scénographiques, aux machines inventées… De ces interrelations naît alors un langage spécifique, nouveau à chaque représentation, dont vont s’emparer les spectateurs, un langage différent et unique pour chacun, qui échappe bien souvent à leurs auteurs. Quel que soit son âge, le spectateur est actif. Il mobilise ses sens, son imagination est au travail, son intelligence dépassée par l’émotion que génèrent l’esthétique et l’inventivité des marionnettes et des dispositifs, la virtuosité de la manipulation ou encore l’inattendu. Il est complice de l’illusion qui se crée devant lui, devenant instantanément partenaire de jeu. C’est donc un art du jeu, jeu entre l’inerte et le vivant, jeu entre le manipulateur et ses marionnettes ou ses objets, jeu entre les artistes et les spectateurs. On le retrouve avec les marionnettes de toutes sortes, à gaine, sur table, à tige, sur l’eau… en castelet ou à vue, avec le théâtre d’ombres, le théâtre de papier… de facture et d’écriture traditionnelle ou contemporaine. Il est présent dans les formes de théâtre où sont manipulées matières, structures, mécanismes et machines inventées, ainsi que dans le théâtre d’objets qui allie art de l’acteur, art du conte, jeu d’échelles, procédés cinématographiques.
Il est fréquent dans le cirque contemporain où les agrès deviennent scénographie et éléments signifiants, dans la danse contemporaine quand les danseurs jouent avec les objets, les costumes, les mots… dans le théâtre musical quand partition, voix, instruments et objets sonores ne font qu’un. On est séduit par la virtuosité de la manipulation et des corps, mais on y apprécie aussi l’ouverture poétique sur le monde, sur l’humanité, qui questionne nos rapports sociaux et politiques.
La marionnette est un art à la fois populaire et prospectif. Il s’adresse à tous – tout âge et toute culture –, il expérimente et innove. Les marionnet – tistes ne travaillent pas seuls. Ils sont regroupés en compagnies ou collectifs qui réunissent toutes les compétences nécessaires : auteurs, manipulateurs, constructeurs, comédiens, metteurs en scène, scénographes, musiciens, plasticiens, informaticiens, techni-ciens… Ils se sont rencontrés pendant leur formation initiale – école d’art, école de théâtre, conservatoire de musique, ESNAM (École supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières…) – ou continue (stage, workshop…). Du temps est nécessaire pour produire leurs spectacles : pour la conception et la construction des marionnettes ou dispositifs, pour l’écriture souvent en aller-retour avec le jeu au plateau, pour les répétitions au plateau en aller-retour avec l’atelier de construction. Et enfin du temps pour la confrontation avec le public qui viendra terminer l’œuvre. Il faut aussi des moyens financiers pour lancer la production et organiser la diffusion. Certaines compagnies sont subventionnées par les collectivités territoriales. Elles sont reconnues et aidées par des structures de programmation. Pour d’autres, le départ est souvent difficile, il faut de la pugnacité pour rencontrer les programmateurs, trouver un premier lieu de diffusion, et décrocher une première subvention… Cette première étape marque l’entrée dans le réseau professionnel, elle est difficile à franchir. Chez les marionnettistes, cependant, il y a une vraie culture de l’entraide. La marionnette ayant longtemps été à la marge du théâtre, elle a développé ses propres ressources dans un réseau organisé pour pallier les manques dus à sa spécificité : lieux, ateliers, outils, espaces de rencontre et de réflexion…
Des compagnies « chevronnées » ont ainsi donné naissance aux lieux-compagnies missionnés pour le compagnonnage. Il y en a aujourd’hui huit en France : Le Bouffou Théâtre à la Coque (Hennebont – Bretagne), Le Jardin parallèle (Reims – Grand Est), Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes (Amiens – Hauts-de-France), La Nef – Manufacture d’utopies (Pantin – Île-de-France), Le Théâtre aux Mains Nues (Paris – Île-de-France), Odradek/Compagnie Pupella-Noguès (Quint-Fonsegrives – Occitanie), le Théâtre Halle Roublot (Fontenay-sous-bois), Le Vélo Théâtre (Apt – Provence-Alpes-Côte‑d’Azur). Elles disposent d’un atelier de construction et d’un plateau de répétition. Leur utilisation ne se limite pas à la création de leurs spectacles. Elles accueillent d’autres artistes, les conseillent, aident à la professionnalisation, développent de la formation, sous forme d’ateliers réguliers, de stages ou de master classes… Ce compagnonnage permet des échanges, des ouvertures vers d’autres arts, encourage des regards croisés entre artistes, rend possibles les confrontations avec les publics, les expérimentations, la recherche, la fabrication, la transmission de techniques, de savoir-faire, d’histoires du métier… Certaines s’engagent aussi dans l’accompagnement administratif, voire dans la production déléguée, permettant ainsi aux jeunes artistes sortant de l’école de se consacrer pleinement à la création.
Elles sont à l’initiative de rencontres avec les publics en organisant sorties de résidence ou festivals, et développent dans leurs territoires tout un travail de pédagogie. Travail important non seulement pour la connaissance de cet art et de ses multiples facettes, sa reconnaissance et son développement, mais aussi pour faire tomber les a priori réducteurs. Et c’est un constat : dans les régions de France où il y a des lieux de diffusion des arts de la marionnette, il y a du public curieux, prêt à prendre les risques de la découverte. Et cela est fondamental pour toute la création contemporaine.
Les structures de programmation sont donc essentielles. Elles peuvent s’engager dans la coproduction et/ou dans l’accompagnement d’équipes. Certaines sont identifiées arts de la marionnette : Le Mouffetard à Paris, l’Espace Jéliote d’Oloron-Sainte-Marie, L’Hectare de Vendôme, Le Théâtre de Laval, Le Sablier en Normandie, Le Tas de Sable à Amiens et le Théâtre à la Coque à Hennebont. Elles viennent d’être labellisées centres nationaux de la marionnette (CNMa), label national récent. On compte aussi l’Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières, deux centres dramatiques nationaux dirigés par des marionnettistes, le TJP à Strasbourg et, dernièrement, le CDN de Rouen. À cela s’ajoutent les festivals : un mondial à Charleville-Mézières, des festivals d’envergure nationale en Île-de-France, à Strasbourg, à Mirepoix, des festivals en région à Toulouse, Marseille, Apt, Amiens, le festival off d’Avignon où les marionnettes sont très présentes… des festivals de proximité à l’initiative des compagnies, festivals de rue, festivals tout public, festival jeune public…
Les arts de la marionnette sont donc des arts de l’hybridité, une hybridité à tous les niveaux : de la création artistique, de l’organisation de la production et de la diffusion, et des publics.

Des arts d’aujourd’hui en somme !