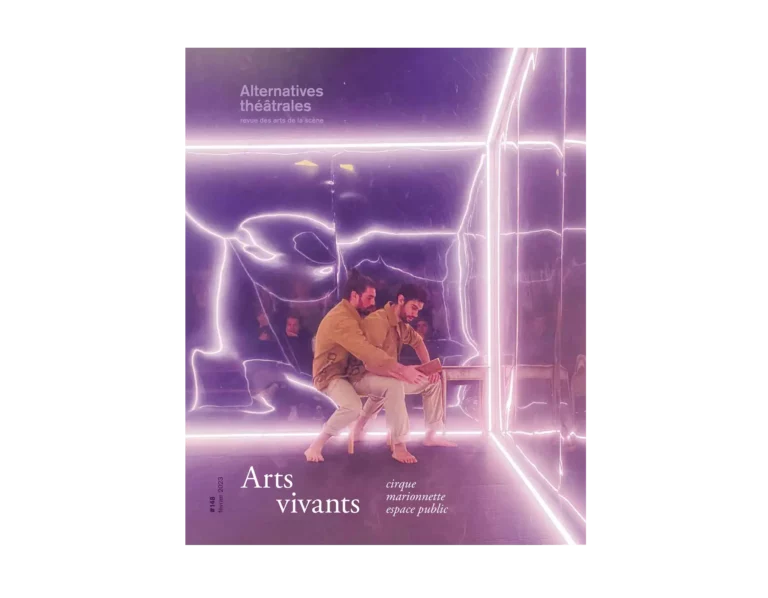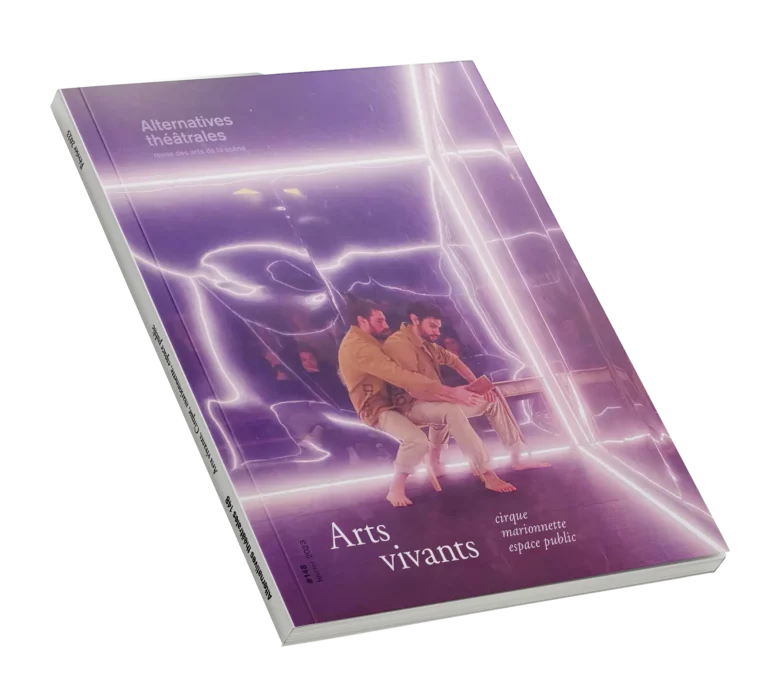Alors que le public s’installe dans la salle, sur la scène, des bras désarticulés sont déjà sortis d’un vêtement de fourrure informe et s’étalent, inertes sur le sol. On ne distingue pas de quoi ou de qui il s’agit. Pas de visage, pas d’identité, mais le spectateur peut établir un lien entre cette masse de poils et la grosse souche de bois placée plus loin à cour. Il y a du sauvage dans l’air.
En contraste, côté jardin, une table de Formica blanche accompagnée d’un meuble de rangement installe l’intimité du foyer, ce quotidien immaculé – à toujours scrupuleusement nettoyer – que la société vend aux femmes. Autre violence perceptible, celle du conditionnement. Le décor est posé, la personne au sol peut se relever, titubante, en état de choc, pour nous entraîner dans l’observation du spectacle d’un cauchemar civilisé, le féminicide.
La compagnie Gare centrale travaille en peintre. Par touches d’objets dans l’espace, elle nous donne à voir l’enchâssement de situations assassines depuis la nuit des contes.
Il y a également du Buster Keaton chez Agnès Limbos. Ce même talent pour incarner le tragique en traversant l’absurdité avec l’impassibilité d’une horloge et pour faire sourire le spectateur en guise d’ultime sursis avant de le saisir d’effroi. Le théâtre d’objets comme art du décalage pour mieux atteindre la cible.