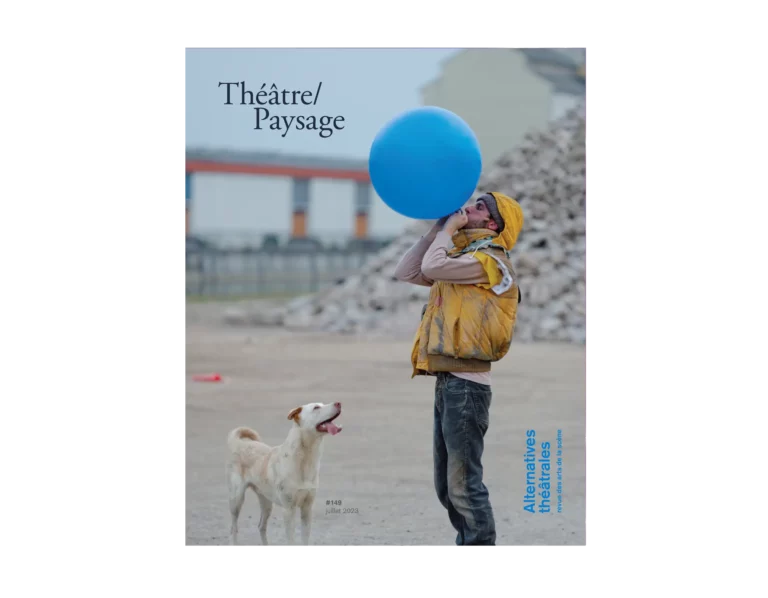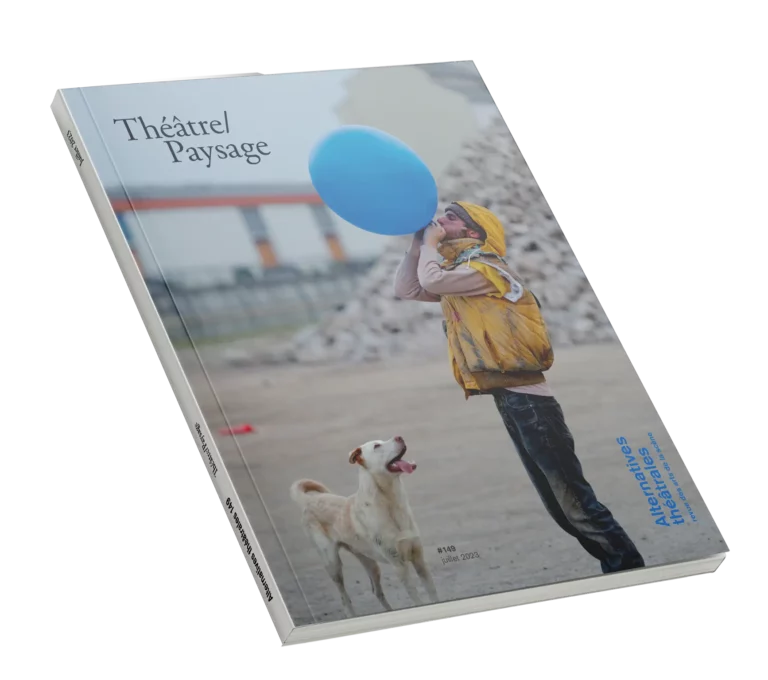À la mémoire d’Arlette Bonnard, magnifique mourante bien vivante désormais morte qui touche
1.
La vivante des Morts qui touchent a creusé la terre – elle a déterré le corps inhumé quelques heures auparavant de sa mère morte, pour en voir enfin le visage que, mourante, celle-ci avait refusé de montrer. « Je suis sur le dos dans la terre. J’aperçois quelques cirrus, ils sont, je me dis, à plus de quinze kilomètres de moi. (…) une bouffée de cirrus, une bouffée de visage (…). Ciel1 ! ». Plus tôt, au début de la pièce, le corps de Cristobal Kendo, jeune adolescent burkinabé ayant tenté de rejoindre la France en se cachant dans le train d’atterrissage d’un Boeing 747 d’Air France à destination d’Orly et mort de froid durant le vol, avait chuté lorsque, à l’approche de l’atterrissage, le train s’était ouvert, au-dessus de la forêt de Rambouillet : tombant du ciel sur le « chœur des épines au sol », à côté d’un sanglier qui fouissait tranquillement la terre pour y trouver sa nourriture. Il y a la terre et le ciel ; nous sommes toujours sur la terre et déjà dans le ciel. « Où commence le ciel ? », se demande Alexandre Koutchevsky : « le ciel commence à la surface de l’herbe et ne se termine pas », « le ciel est là, toujours, il épouse la surface de la Terre2. » Plus qu’en « plein air » ou « en extérieur », son théâtre-paysage est, les pieds bien dans le sol, un théâtre « à ciel ouvert ».
Les Morts qui touchent est une pièce qui n’a pas donné lieu à une mise en scène en paysage3 ; mais c’est bien un « texte-paysage4 » – un « texte pour vivants, fantômes et paysages » (c’est son sous-titre), c’est-à-dire tout ce qui nous accompagne, nous les vivants, et nous décentre, nous décadre ou plutôt nous recadre, présences au milieu de toutes les présences qui nous entourent, dans l’espace et dans le temps liés ; et les principes qui la fondent sont les mêmes que ceux qui fonderont la pratique du théâtre-paysage koutchevskien. Ce sont les lieux qui y condensent l’émotion – « l’émotion particulière qui nous prend quand un lieu nous parle » ; qui sont les dépositaires des souvenirs, des affects, des drames et des destins qui s’inscrivent en eux, comme diffusés et disséminés dans cet autre cadre et cette autre échelle qu’est le paysage, en une relativisation qui n’est en rien une réduction mais une forme, géographique, de présence sensible accrue. Ainsi la vivante « collectionne des lieux5 » comme d’autres des objets, construisant son deuil en parcourant ceux liés au souvenir de sa mère, dont le fantôme l’accompagne. Et la construction de la pièce, dans ce parcours comme dans les croisements qu’elle suscite, suit une logique géographique traçant un parcours de regard : du ciel à la terre, de Ouagadougou au cimetière de Châtenay-Malabry en passant par la forêt de Rambouillet et un champ attenant ou les anciennes Pompes funèbres de la Ville de Paris6.
Tout part d’un trajet : Ouagadougou-Rambouillet [puis] c’est [comme un] travelling : un enfant monte dans un train d’atterrissage à Ouagadougou, on suit l’avion, l’enfant mort tombe lorsque l’appareil ouvre ses trappes de trains, une fois au sol dans la forêt de Rambouillet un sanglier s’approche du corps, et à cent mètres de là se trouve l’autoroute, on passe dans une voiture où une mère atteinte d’un cancer discute avec sa fille, on les suit jusqu’au point d’arrivée : la fille déterre sa mère. Ce sont des images, des histoires qui se jouxtent : tuil[ées] dans la géographie7.
Tuilages de lieux et de destins au sein d’un paysage, ou de paysages au sein d’un trajet, parcours, extension et circulation du regard, trajectoires et coalescences. Vues du ciel ou vues du sol, décrites à travers l’objectivité topographique et mathématique d’un système de coordonnées temporelles et spatiales ou au plus intime des pensées qui n’ont pas pu se dire : les points de vue circulent dans Les Morts qui touchent en un jeu de focalisations, zooms et plans larges. Que la naissance du théâtre-paysage soit pour Koutchevsky intimement concomitante à sa découverte de la pratique de l’aviation n’est pas anodin : son écriture naît d’un regard géographique qui appréhende les choses de haut, comme un « volume de ciel » (projetant au sol une surface de terre) où s’inscrivent les êtres et les lieux au sein des paysages, mais sait aussi y percevoir les détails singuliers pour en atteindre le plus ténu, et les faire en retour résonner dans cette échelle plus ample.
Telle est la « logique de paysage » : une « coalescence des paysages, [le] passage d’une figure à l’autre dans un même plan-séquence8 » – et leurs mises en écho, en relation. C’est celle qui fait voir, de haut, autour d’un aéroport, à Rennes ou en Afrique, les camps de rétentions, les champs, les terrains vagues, les vies multiples qui l’environnent. Ou qui met en perspective nos « petit(s) destin(s)9 », relie et fait éprouver, sans qu’ils n’aient conscience l’un de l’autre, dans Les Morts qui touchent, deux deuils : celui, inaperçu et inconnu, de Cristobal Kendo, qui ne sera veillé que par le sanglier et les épines du sol, et celui de la mère ; deux morts apparemment si différentes, une lointaine et une proche ; deux morts qui s’équivalent, et se mettent à résonner ensemble, toutes deux prises au milieu de millions d’autres et comme toutes petites (mais non pour autant moins poignantes) au milieu de l’espace, terrestre et aérien.
2.
Alexandre Koutchevsky demande à ses acteurs de « devenir des acteurs géographiques », c’est-à-dire de « ne jamais cesser de se sentir en rapport avec les éléments naturels et humains qui les environnent10. » L’épreuve concrète de cela serait peut-être les « respirations paysage » qui ponctuent régulièrement ses spectacles – « respirations paysage » des acteurs, qui ouvrent au spectateur la suspension d’un temps de contemplation et d’ouverture similaire : l’extension de sa perception et de la conscience de son inscription dans ce dans quoi, parmi quoi on est ; ou, dit autrement, « la simple présence de chacun avec toute chose11 », le sentiment de son appartenance et de sa participation au paysage, et avec lui à la planète12. Cela ne veut en rien dire une abolition ou une négation de l’humain et de ses émotions – c’est, bien plutôt, l’humain à sa juste place, l’humain situé, et inscrit : sur la terre, dans le ciel, et aussi dans l’ensemble des humains, plus proches ou plus lointains, qui nous ont précédés et nous succéderont, dans ce paysage ; comme une communauté implicite (de vivants, de fantômes, de paysages…). Terre et ciel, mais aussi géographie et histoire, espace et temps : abscisses et ordonnées.
Les spectacles de Koutchevsky commencent d’ailleurs quasiment toujours par une telle énonciation de sa localisation dans les coordonnées du paysage (à partir desquelles, comme après un décollage ainsi préparé par l’établissement précis de ces données, pourront alors se déployer, dans l’espace et dans le temps, des lignes, des trajectoires, des tracés). Un exemple parmi d’autres :
ÉLIOS – Flora Diguet ?
FLORA – Flora Diguet.
FLORA – Élios Noël ?
ÉLIOS – Élios Noël.
FLORA – Ciel ? (silence, geste)