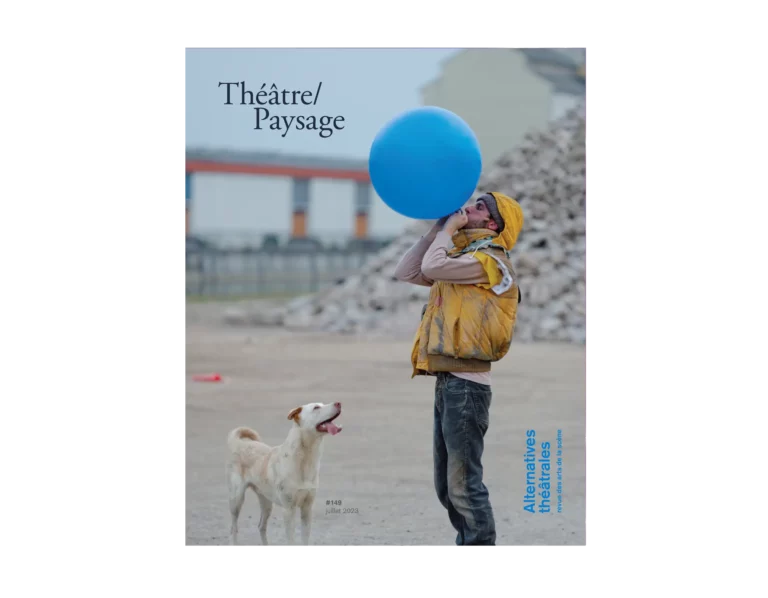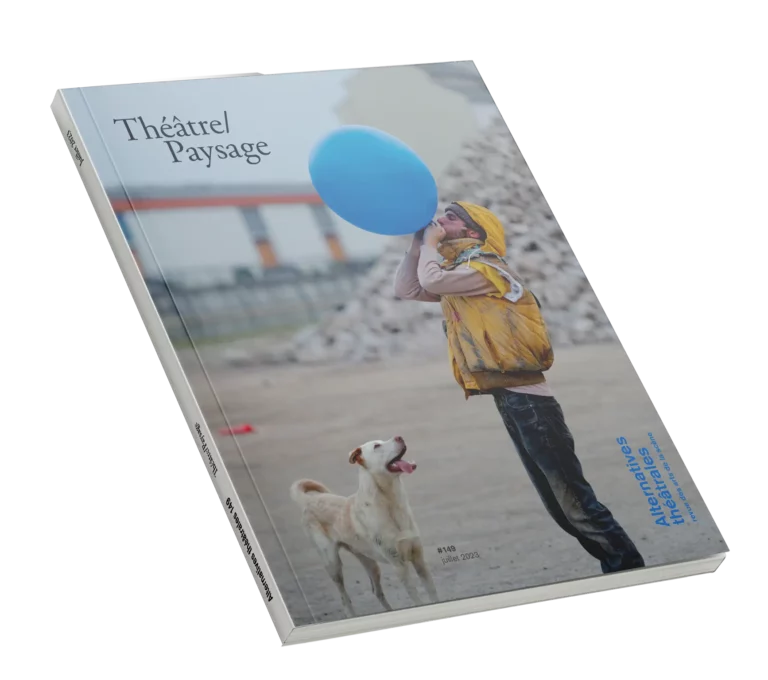Dans son manifeste pour le théâtre-paysage, Alexandre Koutchevsky oppose la boîte noire, espace supposément neutre dans lequel les artistes créent de toutes pièces un monde, au théâtre à ciel ouvert, un théâtre qui, comme il l’écrit, impose de « faire avec ce qui existe », ou encore « faire théâtre de ce monde-là, dans ce monde-là1. »
À Ouagadougou (Burkina Faso), le théâtre ne s’isole jamais du monde extérieur : il se fait dans des cours à ciel ouvert. Poreux aux sons et atmosphères de la ville, il inclut les éléments de son environnement dans ses décors et dans l’expérience qu’il offre aux spectateurs2. Ses murs ne le coupent pas du monde, ils le séparent seulement des habitations voisines. Mais dans de nombreux lieux, cette séparation même est limitée : en regardant le spectacle, on peut à la fois écouter, et à la fois observer les activités qui se déroulent chez les voisins, ce qui provoque un constant aller-retour entre la représentation et le réel. Cette proximité entre le théâtre et la vie n’est toutefois jamais aussi forte que lors du festival Les Récréâtrales qui se déroule tous les deux ans à Ouagadougou.
Fondé en 2002 à l’initiative d’Etienne Minoungou, le festival visait avant tout à susciter des dynamiques de création entre auteurs, metteurs en scène et comédiens. C’est au bord du plateau, à partir d’expérimentations communes que les auteurs étaient invités à écrire. Ce laboratoire dédié aux nouvelles dramaturgies s’est d’abord déroulé dans les différents espaces théâtraux de la ville, jusqu’à ce qu’en 2012 il s’organise intégralement au sein d’un quartier unique : Bougsemtenga. Depuis lors, il se déploie dans l’artère principale du quartier, la rue 9.32, désormais officiellement baptisée « Rue des Récréâtrales », ainsi que dans différentes parcelles des cours d’habitation où, le temps des résidences de création et des représentations, les familles ouvrent leurs portes aux artistes et spectateurs. Les « salles » de théâtre, c’est donc chez les Zida, les Nombre, les Gyengani, etc. Les cours familiales deviennent à cette occasion des lieux de travail pour les artistes invités en résidence. Pendant un mois, ils créent aux côtés des habitants de la cour. Ils s’inspirent de la vie et de l’environnement qui les accueillent et mobilisent les éléments présents comme éléments scénographiques. C’est donc bien un « théâtre de ce monde-là, dans ce monde-là » qui s’actualise avec les Récréâtrales.
Nous proposons ici de nous plonger dans le processus de création d’un spectacle en particulier, conçu lors de la dernière édition du festival : Que nos enfants soient des géants de Sèdjro Giovanni Houansou (écriture et mise en scène, Bénin). Ce spectacle est en réalité le seul à avoir été intégralement créé lors des Résidences (étape de création organisée en octobre) du festival, et ce en raison des conséquences économiques, sécuritaires et politiques du pays qui a connu deux coups d’État au cours de l’année 2022 et qui est en proie à la violence terroriste depuis 2015.
Créer chez Ouango : le processus de création dans une cour familiale
Alors que le texte Que nos enfants soient des géants a été écrit en 2021 dans le cadre d’une commande du festival Afrique-Cologne, la création s’est faite sur place, en quatre semaines. Houansou a fait le pari de monter le texte à partir de l’espace lui-même : celui-ci tient donc une place fondamentale dans la mise en scène et la scénographie. Dans la cour de la famille Ouango qui recevait l’équipe et, ensuite, les représentations, un dispositif minimal a été installé pour accueillir l’équipe : des gradins et quelques éclairages ainsi qu’un podium d’environ 1,50m² légèrement surélevé. Cette scène ne correspondait pas à l’espace de jeu, il s’agissait d’un élément scénographique qui permettait de jouer avec la théâtralité et de mettre en exergue certaines prises de parole. En l’absence de toile d’ombre, l’équipe n’était pas en mesure de travailler pendant les heures les plus chaudes de la journée et prolongeait les séances en soirée. Conséquemment, la création se faisait pendant que les enfants rentraient de l’école et les adultes du travail. Ces derniers suivaient ainsi quotidiennement l’œuvre en train de se faire, avant de poursuivre leurs activités aux côtés des artistes.