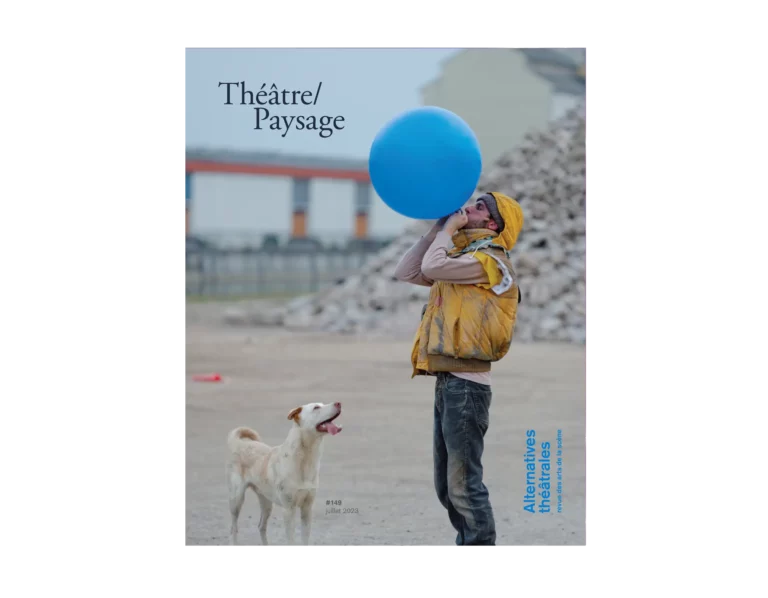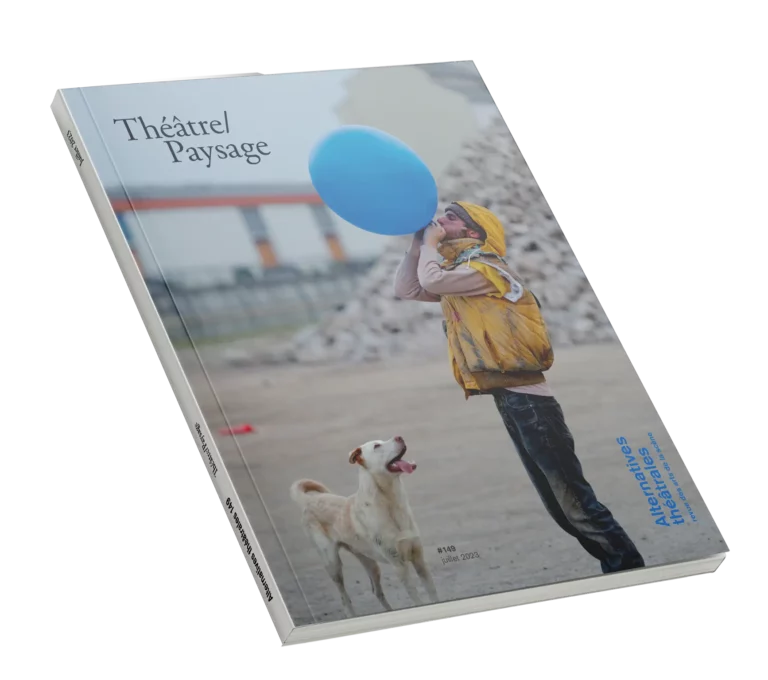Depuis une dizaine d’années, je mets en scène des spectacles hors les murs, souvent en marge des villes, dans de vastes « zones » à l’usage indéterminé, dans lesquelles je choisis un point de vue, cadre l’espace de représentation et compose un paysage à partir de ce qui existe. Jouer hors des théâtres, et même si je n’ai jamais quitté les salles par ailleurs, a profondément modifié, formé, déformé mon rapport à la mise en scène. De même pour les créateurs et créatrices qui m’accompagnent dehors comme dedans : nous avons inventé un vocabulaire commun. La condition qui me paraissait, il y a quelques années encore, nécessaire pour qualifier un spectacle-paysage, à savoir son « extériorité », affublée de quelques relations singulières à son lieu, laisse aujourd’hui place à cette hypothèse dont je suis la première surprise : une dramaturgie particulière serait en fait le sceau d’un spectacle-paysage, indépendamment du lieu où il se déroule. Ce singulier appareil sensible et mental d’où procède la création de tels spectacles n’aurait pu, cependant, se construire sans l’expérience des paysages réels. Ses obsessions viennent du dehors. Le lieu est définitivement un être de langage auquel la fiction se greffe ; la scénographie se pense avec la complexité de composition des règles de l’art paysager ; le rapport au vivant est central ; ou encore la taille humaine n’est plus l’étalon vitruvien qui proportionne l’espace de représentation. En paysage, l’interprète peut devenir minuscule, sa présence équivaut celles des éléments et phénomènes autour. En changeant la focale visuelle, on ouvre aussi le prisme narratif, car à la fiction s’ajoute l’histoire du paysage, ce que sa forme, sa géographie, son passé disent de lui, et qui est exhibé dans la mise en scène. Le signe théâtral, perçu simultanément depuis cet autre point de vue narratif, apparaît plus éphémère, rare et fragile. Tout spectacle-paysage pourrait avoir pour épigraphe ces mots de Rilke : « Regarde, les arbres sont. Nous seuls passons devant les choses comme un mouvement de l’air. »
Contexte
En 2021, les Subsistances à Lyon me proposent de mettre en scène une forme in situ, sous leur Verrière (une immense cour pavée qu’enserrent les bâtiments en pierre de taille de l’école des Beaux-Arts). L’invitation s’inscrit dans une programmation particulière : pendant quelques mois, des spectacles et performances sont créés sur place en connivence avec une installation plastique monumentale, en l’occurrence une tornade géante faite de papier, réalisée par Domitille Martin et Alexis Mérat. C’est la première fois que je travaille à partir d’un lieu. Pour mes spectacles-paysage c’est toujours le texte qui oriente le choix de l’espace. Pour une fois ce sera un lieu, habité par cette installation, qui sera mon matériau de départ.
La Tornade épouse les dimensions de la verrière, condamne son ciel, la sature par le haut, la centrifuge. Elle fige l’infigeable violence du phénomène climatique, suspend le temps (qu’il fait et qui passe), transpose le mouvement de l’air en matière lourde et froissée, et finalement, substitue à la menace de ce qu’elle représente une sorte de douceur monstrueuse. Pensée in situ, la Tornade côtoie et exacerbe la monumentalité de l’espace, c’est ce qui me parle tout de suite : comme au théâtre-paysage, le lieu indexe l’œuvre à son échelle et concourt sensiblement à sa réalisation. Au-delà de l’imaginaire qu’une tornade de papier suggère ‒ comme métaphore spirituelle, catastrophe climatique, etc. ‒ c’est l’artefact d’un élément paysager par excellence, construit à partir de la forme d’un lieu clos que je retiens. La tornade devient alors le fragment d’un paysage à imaginer. Comme par déduction. Je prends la commande au pied de la lettre, en fais une expérience radicale dans ma recherche sur le théâtre-paysage : c’est le lieu qui aura d’abord lieu et dictera son régime théâtral.
Le temps de répétition sur place est court (10 jours), mais la préparation en amont me donne assez de visibilité pour faire de la contrainte une méthode : il faut se consacrer à concevoir la scénographie et le dispositif. Les répétitions serviront à expérimenter des « activations » du paysage. Créer les outils nécessaires à ce qu’il devienne narrateur. Entrer dans son temps incommensurable (l’idée qu’on peut s’en faire). Adopter son point de vue sensible. On pense au rêve de landscape-play de Gertrude Stein, où les choses sont présentes les unes aux autres et où il n’y a d’histoires qu’isolées dans des fragments de paysage : une métaphore pour dire la capacité narrative propre d’un espace naturel. Ça bouge dedans, mais reste immobile.
Composer le paysage
Pour créer un paysage, il faut revenir à la peinture. Comprendre les règles picturales qui ont inventé, par sa représentation, le paysage perçu dans le monde réel. Démonter l’appareil optique des premiers peintres de paysage pour adapter le principe, transposer la mécanique. Cadre, plans, structure d’horizon, vastitude, lignes de perspective, intrication signifiante des éléments, ordonnancement d’un sens de lecture du regard, cohérence autonome et expressive du tout. En provoquant d’abord le plaisir de la vue, le paysage s’adresse à nos facultés d’imagination.
Avec Hervé Cherblanc, le scénographe, nous inventons les volumes, les plans, la topographie du paysage à venir. Ici un relief vertical qui se perd dans la tornade, là une vallée, un mont qui arrête le regard, par là il peut s’enfuir, illusion d’infini. On imagine un dispositif qui multiplie le sens du paysage en le rendant visible depuis trois points de vue ; on prédispose la réception : le public sera installé dans des transats placés en trifrontal et libre de changer de place pendant le spectacle. Trois points de vue nous obligent à organiser l’image pour chaque cadrage, et plus tard dans la mise en scène, à s’assurer que chacun soit toujours une scène active. Le cadre, ce parergon essentiel qui arrête et parachève le sens de l’image, sera un ruban lumineux au sol. La frontière doit être stricte et nette. Ostentatoire même. Elle signale et organise la cohérence de l’espace vu. Devant le cadre, rien de ce qui appartient au paysage ne doit déborder. On s’amuse à faire comme s’il y avait une vitre, comme si c’était un vivarium. Pour les interprètes ce sera trois « quatrièmes murs ».