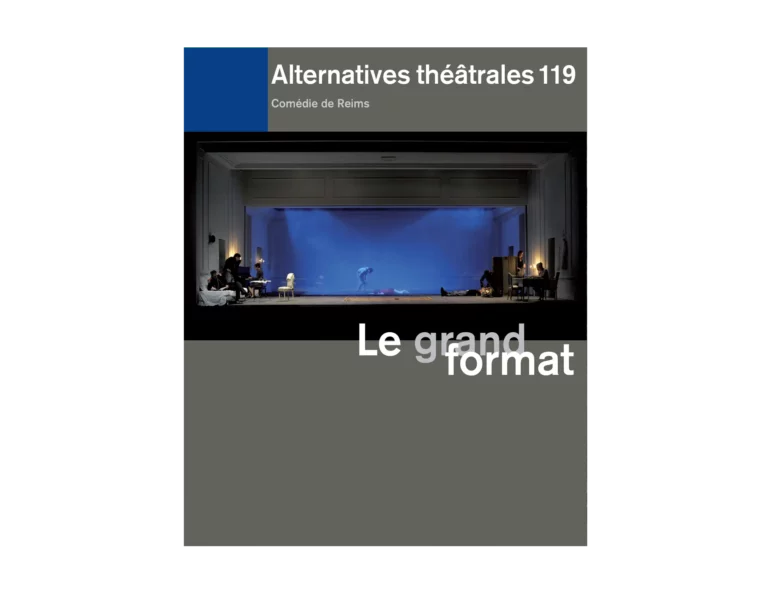« MÉMORABLE VOYAGE », « grand feuilleton », « ovni » théâtral : les formules ne manquaient pas, cet été encore, pour commenter la dernière mise en scène, faussement intégrale, du FAUST 1 ET 2 présentée par Nicolas Stemann et le Thalia Theater de Hambourg dans la nouvelle salle de la FabricA inaugurée pour l’ouverture du Festival d’Avignon 2013.
Depuis le marathon conçu par Peter Stein à Hanovre afin de célébrer le début du troisième millénaire, la grande œuvre de Goethe semblait provisoirement tombée dans les oubliettes des textes réputés injouables pour leur longueur (plus de 12 000 vers), le nombre de personnages à interpréter (plus d’une centaine sans compter les innombrables chœurs) , le coût des décors à réaliser (une vingtaine pour FAUST 1, davantage pour les cinq actes de FAUST 2 – et bien plus grandioses !), les financements exceptionnels enfin que supposait une telle production.
Le spectacle de Stemann déjouait pourtant allégrement les pièges du gigantisme en réduisant les vingt-deux heures de l’authentique intégrale proposée par Stein à 8 h 30 de représentation (pauses comprises), grâce un habile dispositif de distribution des rôles pour FAUST 1 et, surtout, grâce à des coupes et des passages adaptés et truffés d’improvisations, pour l’«irreprésentable » FAUST 2. La première partie, la plus connue et la plus souvent jouée (du moins dans sa version lyrique), était prise en charge durant plus d’une heure par un seul comédien lisant tous les rôles (Sebastian Rudolf, remarquable), rejoint ensuite par deux autres acteurs interprétant avec lui, à tour de rôle, tous les personnages de la pièce. Seul un affichage lumineux précisait pour les spectateurs à qui la réplique devait être attribuée jusqu’à ce que les acteurs s’identifient plus nettement à un personnage : Philipp Hochmair à Méphisto, montré comme un double sensuel de Faust, et Patrycia Ziolkowska à Marguerite, puis plus tard, dans FAUST 2, à Hélène. Dans une scénographie minimale, avec ce procédé de relative déconstruction du texte, et porté par des comédiens très convaincants, FAUST 1 ne s’attira que des éloges. Le public et la critique furent plus divisés à propos de FAUST 2. Du texte foisonnant et hétérogène de Goethe, Stemann avait tiré une sorte de show contemporain, reprenant les grandes articulations de la pièce sans les conserver toutes. Restait un fourre-tout « post-post-post moderne » irrévérencieux qui tenait à la fois du cabaret et du spectacle télévisuel où l’on pouvait voir la vie du couple Faust et Hélène comme une caricature de foyer moderne envahi par les biens de consommation et assujetti à la tyrannie de leur insupportable rejeton, ou encore la scène de la rédemption finale de Faust comme une ascension burlesque accompagnée par le chœur des anges, figurés par les marionnettes déglinguées de la compagnie Das Helmi.
Truffée d’ironiques commentaires sur le théâtre post-dramatique, sur l’obscurité de la pièce aux yeux de la critique universitaire, ou d’allusions à la mise en scène du FAUST de Stein1 comme à celle du HAMLET d’Ostermeier2, la représentation prenait des allures de carnaval bon enfant, suscitant l’agacement de certains et l’adhésion enthousiaste de la majorité du public, tout heureux d’avoir survécu par un beau jour d’été à l’épreuve d’un spectacle de huit heures trente.
Repensant plus tard à ce dernier « défi sportif », selon la formule de Stemann, il m’a semblé que le plus surprenant n’était pas tant l’accent iconoclaste de sa mise en scène, ni sa présence sur le plateau pour commenter ou anticiper l’action qu’un certain changement d’inflexion apporté à cette vision de FAUST comparée à celles que j’avais pu voir des années ou des décennies plus tôt. Que veut-on trouver aujourd’hui dans FAUST en effet ? Le spectacle et plus encore le discours critique d’accompagnement – car le propos ne m’a pas paru toujours très lisible sur le plateau – mettaient en évidence le caractère visionnaire des intuitions de Goethe dans la seconde partie de son œuvre monumentale. À la lumière des crises que traverse aujourd’hui la civilisation occidentale, l’acte I situé à la cour de l’empereur d’Allemagne devenait prémonitoire de la crise des économies virtuelles. Que proposent en effet Méphisto et Faust à l’empereur sinon de faire fonctionner la planche à billets en garantissant les valeurs en circulation par des richesses enfouies dans le sol et encore inexploitées ? Une soudaine prospérité qui ne pourra générer que ruine et guerre à l’acte IV. De même, l’acte V, au cours duquel Faust et Mephisto veulent exploiter le littoral et construire à tout-va en expulsant les anciens habitants (Philémon et Baucis) et en gagnant des territoires nouveaux sur la mer, est-il facilement interprété comme une mise en garde adressée à tous les pilleurs de réserves naturelles de la planète.
Goethe dénonciateur de l’économie virtuelle et défenseur de l’écologie : nous sommes bien loin aujourd’hui des grandes mises en scène de la dernière décennie du XXe siècle. Car si ces passages du texte n’étaient pas gommés dans les spectacles de Strehler ou de Stein, leur traitement obéissait à une tout autre logique.
Nous avons tous pu constater à quel point certains auteurs ou certains textes connaissent soudain un succès international ou à tout le moins européen. Vague d’ORESTIE (Stein, Mnouchkine, Lavaudant, Sobel, etc.) pour ancrer le théâtre européen dans ses racines grecques ; vague de MÉDÉE au théâtre et à l’opéra (Lassalle, Deborah Warner, Wilson, Warlikowski, sans compter toutes les adaptations modernes) et, aujourd’hui, retour aux auteurs américains, hier décriés : O’Neill et Tennessee Williams (Langhoff, Warlikowski, Van Hove, etc.).