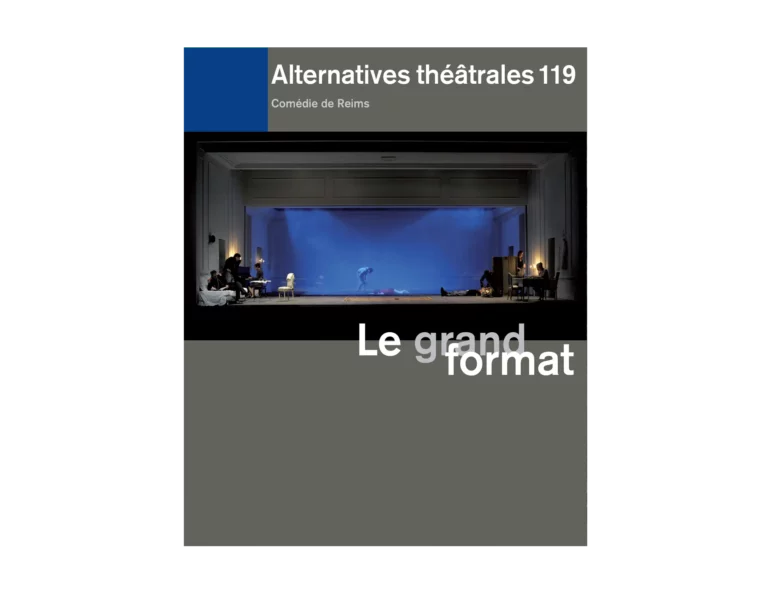Damien Chardonnet-Darmaillacq : La trilogie d’HENRY VI est une œuvre mal connue, très longue et parfois alambiquée sur le plan dramaturgique. Sa complexité pose d’emblée la question de sa réalisation scénique. Tu as pourtant choisi non seulement de la monter dans son intégralité, mais encore de ne jamais rogner ni adapter le texte. Il n’y a guère que le découpage auquel tu aies touché : telle que tu la présentes, la trilogie se divise en deux cycles de deux épisodes chacun. Le premier cycle de huit heures (épisode 1 et 2) a été créé en janvier 2012 au Trident- Scène nationale de Cherbourg-Octeville. Puis s’est ajouté l’épisode 3 créé au TnB à Rennes en novembre 2013. Reste le dernier épisode sur lequel tu travailles déjà. Pour l’intégrale qui sera dévoilée bientôt, tu anticipes seize heures de représentation. Le temps est donc doublement long, à la fois dans l’élaboration du spectacle qui aura mis plus de deux ans à aboutir, et dans la durée de la version finale. Qu’est-ce qui t’a conduit à te lancer dans une entreprise aussi ardue, à choisir de mettre en scène, au long cours, cette œuvre pleine d’écueils qui interroge les possibilités de sa propre représentation ?
Thomas Jolly : Je vois quatre raisons. La première tient d’abord à l’histoire de la compagnie, La Piccola Familia, qui démarre en 2006 et avec laquelle je monte ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR de Marivaux, TOÂ de Sacha Guitry, puis PISCINE (PAS D’EAU) de Mark Ravenhill en 2011. Cette dernière pièce marque la fin d’une certaine période qu’on pourrait appeler la période de jeunesse de la compagnie. On a ressenti le besoin d’ouvrir le plateau à de nouvelles perspectives, à de nouvelles rencontres, à des acteurs d’une autre génération, alors qu’au départ nous étions tous des enfants des années 1980. En même temps, de mon côté, je souhaitais structurer davantage mon langage de metteur en scène. Cette période a coïncidé avec la publication de l’intégrale des pièces historiques de Shakespeare dans la Pléiade. En 2004, j’avais déjà traversé HENRY VI en tant qu’acteur à l’école du TnB, pendant un atelier où Line Cottegnies avait mis à notre disposition sa traduction en cours. Cinq ans plus tard, j’allais tout retrouver. Je suis saisi par l’intensité, la complexité, le lyrisme et la poésie de l’œuvre. Je me rends bien compte que c’est un projet démesuré, un projet déraisonnable. Mais, comme pour l’amour, le désir était allumé, incandescent, et je ne pouvais ni ne voulais aller contre. Il fallait que ce projet trouve une réalité et il ne m’en a pas fallu davantage pour me mettre au travail. Pour notre compagnie, c’était le bon projet, le bon moment.
La deuxième raison tient au défi artistique. HENRY VI représente un formidable terrain de jeu pour la miseen scène et les acteurs. Oui, cette pièce, ces trois pièces sont archaïques, moins calibrées que les autres pièces de Shakespeare, mais elles permettent de déployer un geste artistique très large en passant continuellement d’un registre à l’autre. Et puis, j’avais envie d’une œuvre pour ainsi dire initiatique. C’est d’ailleurs ce que je suis en train de vivre : mon voyage initiatique. Il y en a qui prennent leur sac à dos et qui font le tour du monde ; moi, je monte HENRY VI !
Ensuite, il y a la question du texte et des raisons qui font qu’on le monte aujourd’hui pour ce qu’il raconte. Au début, on croit monter un texte pour telle ou telle raison, et plus ça va – puisque le temps qui passe joue beaucoup –, plus je me rends compte que les raisons que j’avais identifiées au départ sont dépassées. J’en viens à me dire qu’avec HENRY VI j’interroge une origine de notre époque, marquée par le début de la modernité, la circulation des idées et des œuvres, l’invention du moi en philosophie, les premières idées capitalistes, la prise de conscience de l’ampleur du monde qui bascule précisément au moment où règne un roi faible, sans aucune prise politique. Je m’interroge aussi sur le rapport de l’homme au divin. Henry VI ne s’en remet qu’à Dieu, mais cela ne marche jamais. Son assassinat est un sacrilège. En miroir, la montée en puissance du futur Richard III pose d’ailleurs la question de la prédestination du pouvoir, de l’altération de soi par le pouvoir : est-ce qu’on peut être sur le trône sans se déformer – physiquement ou mentalement ? La pièce s’ouvre sur un conflit entre deux royaumes, puis l’intrigue se resserre sur deux familles, puis sur une seule famille, les York qui vont s’entretuer, et elle finit par se focaliser sur une seule personne : Richard III. Le grand conflit de départ, qui s’étendait sur des milliers de kilomètres, se réduit à l’échelle d’une personne ; mais c’est finalement le même conflit qui se joue. Voilà ce que nous enseigne Shakespeare : le rapport du grand au petit et du petit au grand. Comment l’un est à l’origine de l’autre et vice versa.
Enfin, la quatrième raison qui m’a fait choisir HENRY VI, c’est que je me sentais pris dans un système culturel frileux, qui induit qu’on monte à quatre ou cinq des spectacles d’une heure et quart qui tournent sans problème : on arrive le matin, on monte, on joue le soir, on part le lendemain ; ça ne coûte pas cher, ça plaît à tout le monde, à tous les âges, à tous les publics… J’ai trouvé ça mortifère, je me suis dit « je vais mourir » – artistiquement –, et c’est pourquoi j’ai voulu lancer un projet ambitieux qui fasse bouger les lignes. Parce qu’il est trop gros, trop cher, trop compliqué, parce qu’il implique trop de monde, parce qu’il n’entre pas dans les cases de programmation, parce qu’il demande au public et aux équipes des théâtres de réinventer un rapport à la représentation, à la durée de l’œuvre, au temps que l’on passe devant l’œuvre. Tout cela me passionnait et continue de me passionner. C’est l’aspect le plus vivifiant de ce projet.
D. C.-D. : Tu n’avais pas encore trente ans quand tu as commencé à t’intéresser à cette pièce. Thomas Jolly et HENRY VI, est-ce que ce n’est pas un peu David et Goliath ?
T. J. : C’est drôle, c’est ce que je dis souvent ! Henry et moi, c’est un duel, oui ! Tout ce que j’ai cru savoir est remis en cause et j’ai perdu tous mes repères. Au départ j’ai eu des idées de scénographies énormes et très chères. Mais on n’a pas pu les réaliser et c’est tant mieux ! La pièce a été écrite pour une toute petite scène avec trois espaces distincts : ça suffit pour qu’on puisse tout y faire, ça suffit pour y déployer seize heures de représentation. Mes prétentions de metteur en scène ont été mises à terre par le texte. La longueur contraint aussi à penser autrement les questions de rythme de travail ou de répétition. Pourtant, c’est curieux, on ne peut pas être angoissé par HENRY VI. C’est tellement énorme que ça dépasse l’entendement. On ne peut pas se représenter cette énormité. C’est comme gagner trois cent millions au loto : on ne comprend pas, en tout cas moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. On ne mesure pas la démesure. Et donc ça finit par me rendre sage. Pour prendre une autre image, c’est comme un paquebot : on ne tourne pas le gouvernail comme ça, sinon le Titanic aurait évité l’iceberg. Et donc on doit anticiper son geste, ça va très lentement.