Le concept d’espace peut s’envisager selon deux angles opposés : celui de l’espace individuel subjectif et celui d’un espace collectif relativement objectif et quantifiable.
Au sein de chaque culture, l’espace individuel est naturellement flexible, qualitatif plutôt que quantitatif, l’espace où nous vivons nos rêves est si amorphe qu’on ne peut pas même parler de contiguïté. L’espace collectif, à l’autre extrême, est la base conceptuelle sur laquelle s’organise le plus souvent toute communication politique, sociale et économique.
Chaque culture possède en propre un concept collectif de l’espace, élaborant par exemple ses propres principes pour une mesure scientifique de l’espace. Chaque conception de l’espace (individuelle, communautaire, urbaine, culturelle, administrative) peut être vue comme un type de texte ou sous-texte d’une culture. C’est dans le cadre de ces sous-textes que les membres d’une culture affirment leur identité et puisent dans le code culturel par lequel ils communiquent. S’agissant d’une conception administrative ou légale de l’espace, soit d’un type de sous-texte particulièrement rigide, les messages véhicules par ce code seront plutôt des messages sociaux ; dans le domaine de l’espace individuel, par contre, nous disposons de codes plus flexibles, reflétant notre personnalité, dans le cadre desquels nous pouvons décoder nos propres messages inexprimés.
On peut dire des formes théâtrales qu’elles reflètent un niveau semi-conscient de la conceptualisation de l’espace, mettant en rapport, en un sens, les images spatiales de l’imagination collective avec notre cadre architectonique concret.
Dans chacun de ces trois cas cependant — espace intérieur, extérieur ou théâtral -, le sujet tend à organiser le sous-texte spatial dans le cadre duquel il conçoit sa position dans le monde selon deux pôles opposés : le centre et la périphérie. Ce sont ces deux termes que nous allons maintenant examiner.
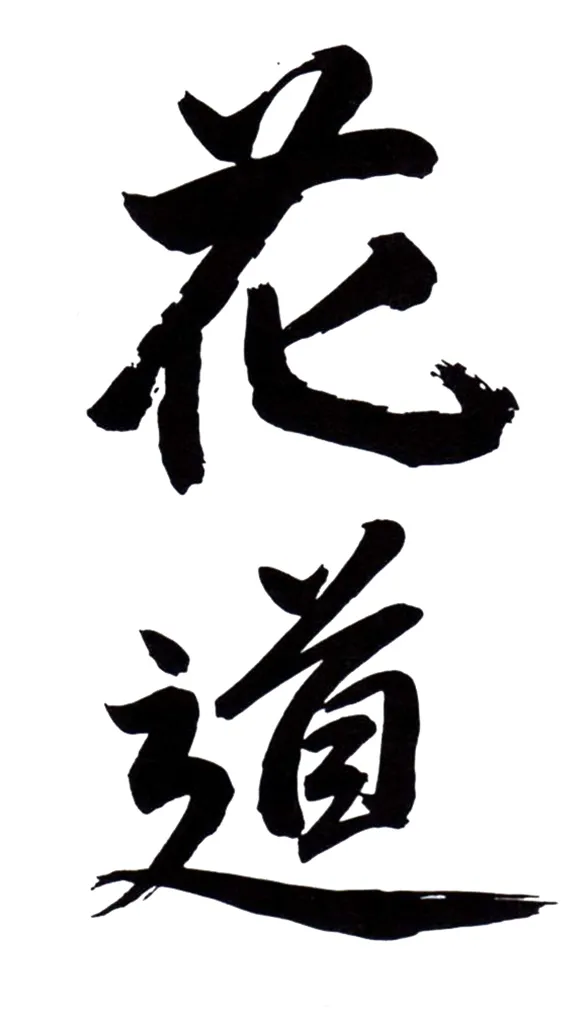
Aspects topographiques
On a souvent évoqué l’absence d’un espace central dans les cités rurales du Japon, contrastant la pauvreté du schéma urbain japonais en parcs et autres lieux collectifs avec, par exemple, la plaza centrale caractéristique des cités italiennes. Alors que dans d’autres cultures pauvres en lieux publics (les cultures africaines, entre autres) le marché remplit ce rôle d’espace central de rencontre, d’échange d’informations et d’ostentation d’un statut social et politique nouvellement acquis, il semble que dans le Japon pré-moderne, le rôle crucial soit revenu non à cet espace central, mais bien à la limite du village, cet espace ambivalent où le « dedans » se fond dans le « dehors » (d’où les connotations à la fois fastes et néfastes associées par exemple au pont bâti sur la rivière qui constitue cette limite).1
Avant l’apparition des temples, de nombreux villages disposaient d’un édifice public nommé jijo-dô, où les prêtres itinérants frayaient avec les villageois, célébrant les rites d’expiation de leurs sectes mais aussi récitant des contes et exécutant des spectacles rudimentaires, basès souvent sur les chansons de geste.2 Comme ces prétres-amuseurs colportaient également les nouvelles d’autres régions et de la capitale, cet espace marginal et ambigu devint le point de contact entre le microcosme villageois et le monde extérieur :en ce lieu de rassemblement ouvert à divers types de communication, l’espace du dedans se rafraichissait au contact d’un « air » venu du dehors. Même la célébration des fêtes liturgiques au sanctuaire du village n’a pu donner corps à l’idée d’un espace central, ceci du fait que ces fêtes avaient lieu selon un strict calendrier saisonnier, faisant ainsi prédominer l’aspect temporel de la visite des dieux sur son aspect spatial.
La cosmologie japonaise a choisi la montagne pour représenter le centre du monde ; mais le symbole visuel de la montagne évoque en même temps la maternité, comme l’illustre la légende populaire de Kintaro3, élevé parmi les bêtes sauvages par sa nourrice et mère adoptive Yama-Uba (“nourrice des montagnes »), un monstre femelle qui s’identifie avec la déité incarnant l’esprit de la montagne. La montagne figurait ainsi pour l’habitant du village japonais un espace cardinal à l’extérieur de celui-ci, et ce en fonction d’une triple symbolique : celle de l’axis mundi, celle du sommet où se rejoignent la terre et le ciel et celle du sein maternel. D’où les tentatives, abondantes dans toute la culture japonaise, de représenter la montagne à l’intérieur du village :tant les huttes miniatures surmontant les habitations traditionnelles de la région de Kyôto et Nara que le cimier ouvragé des casques de samurai renvoient à la notion de yama et à l’image de la montagne, de même encore que le shime-yama (« Montagne au poteau décoré »), où elle est figurée par une petite éminence couverte de sable et souronnée par un mât décoré de bandelettes de papier ou entourée par une corde tendue entre quatre poteaux.4

