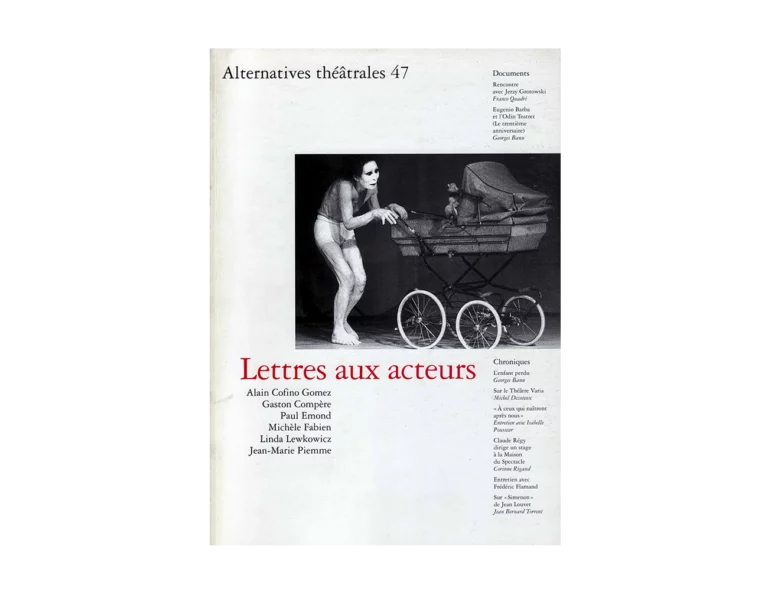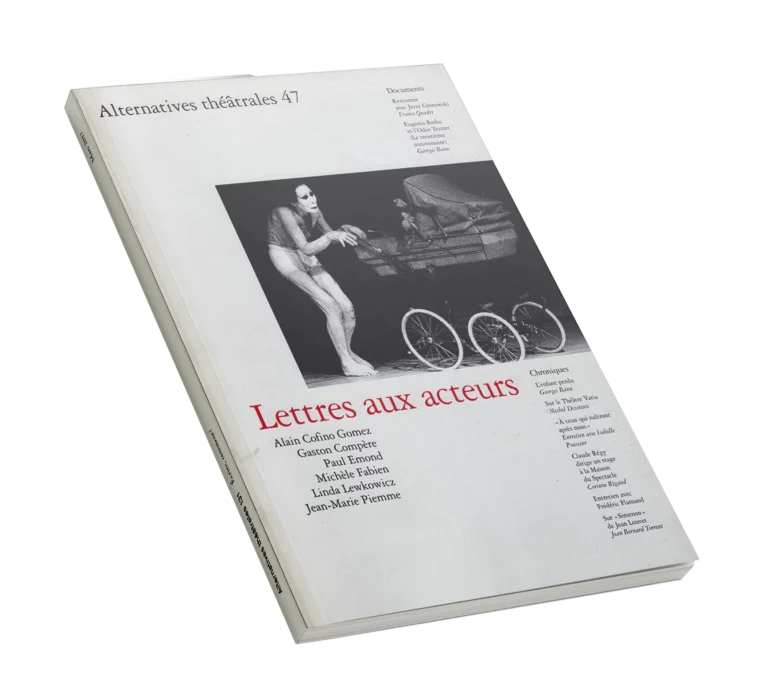MA TOUTE CHERE COLETTE,
Tu ne me croiras pas, je le sais, et pour te dire les choses au plus juste, je t’écrirai : je le sens je sens que ru te prendrais volontiers pour un cygne aveugle que le fleuve fait dériver parmi les lenticules, les joncs, les massettes velues, tu glisses, tu t’éloignes, tu te fais petite, tu disparais. Vois-tu où tu es ? Mettons les points sur les i : vois-tu où je crois que tu es ? dans l’eau, les reflets, l’ombre qui naît, les roseaux, là, tout près sans doute – où je ne te vois pas. Je ne sais où tu es, je ne sais où je suis : alexandrin parfait, et là, sûr ! il me faut mettre une relation de cause à effet entre le premier hémistiche et le second. C’est dans ce contexte que d’Yvoir je t’écris, ma toute chère, c’est te dire – c’est te dire où je nous vois, chacun dans notre coin, et entre nous quoi ; le bouillon à boire, le grand. Nous en sommes tous là et, à l’image de Molière qui trouvait que c’est une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens, je t’assure trouver également étrange l’entreprise de t’écrire dans ces conditions – le sort commun d’ailleurs, mais qui s’en aperçoit ?
Me croiras-tu quand je te dirai que nous étions deux à parler de toi toute la nuit passée à deux, Cornélius et moi – à longueur d’heures. Je récupère pour l’instant, et le fais à t’écrire dans la verdure mosane. Ce premier mai, que l’après-midi a de charmes ! Souviens-toi de Guillaume de Lorris : Mout a dur cœur qui en mai n’aime. Nous avons aimé ton nom toute la nuit, Cornélius et moi : « Muse tu nous étais, et Meuse également ».
Nous avions assisté à la représentation de MADEMOISELLE JULIE et avions pu nous rendre compte sur le vif – expression admirable – à quel point les caractères, aux dires de Strindberg lui-même, étaient des conglomérats. Puis le public était parti, et je l’avais laissé partir pour éviter la presse : j’ai une jolie fouine dans la cuisse droite, et les fouines ont les dents affilées de la sciatique. Cornélius est venu s’asseoir à mon côté. Il y a eu le va-et-vient un peu maigre d’après le spectacle, puis il s’est épuisé. Et enfin est venu Béranger. Béranger ne me refuse rien (nous sommes des amis de longue date), ni à Cornélius, qui, comme tu le sais peut-être, se trouve être son beau-père.
Cornélius :
— Comment va Julie ;
— Laquelle ? Mademoiselle ou madame ;
— Madame-ma-fille.
— Bien. Nous partons demain pour Milan.
— Et l’autre année, l’année dernière, pour mille ans de mariage heureux (excuse-moi de penser à ma fille) c’est cela ?
— Hum … Heureux, oui.
— On peut rester quelque temps à bavarder ?
— Le temps qui vous convient. Éteignez avant de partir et rirez la porte derrière vous.
— Merci.
Je le remerciai à mon tour. Il est parti. Nous sommes restés à trois : Cornélius, moi – et toi, Colette. C’est ainsi. C’est bien. Je t’écris maintenant. Je t’écris d’un lieu tout proche – qui est l’autre bout d’un monde. Tu me connais. Essaie de m’entendre.
« La nuit s’épaississait ainsi qu’une cloison. » Avoue que le vers de Baudelaire est bizarre. Et cependant il dit exactement ce que je ressentais cette nuit-là. Et le théâtre en faisait autant, du moins il m’en donnait l’impression – l’impression bizarre – deux fois zarre, fillette, ouh, ouh, il me vient l’envie d’une crise épilepse, avec grimastes et bistournes tortillées, ach, mein Gott !
CORNÉLIUS : — Mais, nom de Dieu, quand je te dis que je la connais !
Et, ma chère Colette, il s’est lancé dans une histoire assez insane, où il était question de tes origines et des siennes. Tu me diras ce qu’il faut en penser. Et la conversation s’est éternisée par ta grâce, à hue et à dia, à pepsi et à cola, au pousse ce je comme va, ceci-cela, soua-soua, frocci frocca (les mens-sana), cahin-caha évidemment, alphoméga-omégalpha — là. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger, disent les Sisyphe — n’est-ce pas ? Il paraîtrait que toi et lui êtes cousins plus ou moins éloignés de Pouchkine, Huss, Smetana, Pankowski, Hrabal et caetera. Il se donne des origines slaves. Il c’en prête. Des origines slaves, grand dieu ! tu dois le savoir, il y a grand risque que le sujet soie inépuisable : je l’ai fait taire. Rien à dire contre Hrabal et Pankowski, au contraire même, mais Smetana, grand dieu ! Smetana et quelques autres : insupportable pour moi. Pour moi, j’insiste : je suis ravi que d’autres y trouvent leur provende ec leur providence. Cornélius s’est tu.
Tu sais à quel point ce théâtre peut être amical en dépit de ses banquettes trop serrées. Ma sciatique y souffrirait le martyre n’étaie l’amitié de Béranger, qui me fair placer au premier rang. C’est sur cette rangée que nous étions assis, qui rend la gambade possible. Deux fois déjà, Cornélius avait fair le tour de la scène, à niveau. ’
LUI : — Colette me trotte en tête, va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi au juste. Car il est des raisons plus prochaines que celles-là, des raisons plus prochaines sans grand intérêt, avoue. Cette amie, cette chère amie… Excuse-moi, je ne vois pas pourquoi je l’ajoute, cet adjectif. Comme j’entends ami, cher fait furieusement pléonasme. Je vois là une de nos misères fondamentales, et c’est la plus commune, celle qui vient du temps et de son usure : on voie les mors perdre de la substance – une substance qu’ils ne retrouvent par prodige que lors de circonstances quasi miraculeuses. Ils la perdent et il leur faut sans cesse suppléer à cette carence pathétique. Mon cher ami remplace mon ami, et guette, guette ! tu ne seras pas long à voir se pointer mon très cher ami…et nous voilà sur un chemin donc on ne sait rien, ni où il va, ni où il s’arrêtera. Comme le dit qui tu sais, nous participons tous à cette problématique. C’est la plus commune qui soit, et la plus universelle.
MOI : — Et le théâtre n’y échappe pas, Cornélius. Les pièces ont besoin d’être rafraîchies. Les seules bonnes sont celles qui répondent. On les couche, elles frissonnent. Ce matin, tiens, je suis tombé sur ce vieux programme. Lis ce que j’y avais souligné. C’est signé Kemp, Robert : le nom doit te dire quelque chose.
Il lut ceci, Colette, de la belle voix qu’il a, donc je l’envie, et que tu admires, paraît-il.
LUI : — L’œuvre, « il faut la réveiller comme une belle endormie, lui poser les questions qui nous émeuvent, lui montrer le monde tel qu’il est devenu, et lui demander ce qu’elle en pense. Une pièce sans vitalité profonde ne répond pas, et se rendort. Les vrais chefs-d’œuvre s’échauffent, discutent, prennent parc à nos inquiétudes, et nous disent : C’est comme moi, j’ai cru aussi…» Eh oui, rien de plus vrai. Comme je suis historien, ce n’est pas là le genre de souci donc j’ai cure. Mais je connais assez les affres de Béranger, qui ne peut pas se résoudre à laisser une pièce dormir. C’est le genre de garçon qui n’arrête pas de se prendre pour le prince charmant. Il a traversé le bois magique. Il est entré dans le château. Son souffle rencontre celui de la belle. Er tout à coup la voilà qui chance en fa dièse mineur : pourquoi me réveiller au souffle du printemps ?
MOI : — Parce que je t’aime. dit-il.
LUI : — Sans doute. Mais aussi parce que dans la belle… non, ce n’est pas tel « problème » qu’il aperçoit en elle, mais tel « problème » joué par tel acteur ou telle actrice. Colette, tiens… lady Macbeth … virago des ténèbres… ce n’est pas tant l’ambition de la femme à la main cachée que Colette jouant à vouloir disparue la sanglante souillure … Le théâtre est sans cesse confronté au concret, et cela lui est d’une aide incomparable, cela lui tient le glaive droit et le balancier régulier. Colette, justement …
MOI : — Colette, oui.
LUI : — Imagine la scène : Béranger réveille la belle, lie en elle, non point son secret – il n’en demande pas cane – mais ce qu’il appelle son problème de base. en elle, oui, au plus profond, semble-t-il, son problème comme un grain de café, obscur et neurogène, cu vois, de nouveaux nerfs dans toutes les directions, j’ai en tête une toile d’Odilon Redon, tu vois — tu vois ?
Je ne voyais pas. « C’est sans importance » , dit-il. Son problème à elle… Inutile de précipiter les choses. Eclairons.
MOI : — L’éclairons sonne la charge.
LUI : — Ce n’est pas malin. Tes enfantillages me cassent les bonbons. Voyons… Où en suis-je ? La peste…
MOI : — La peste de Camus et de tes gamineries – quoique (j’ignore si tu le sais), Hugo soutienne que la gaminerie est « une nuance de l’esprit gaulois ». Je me suis toujours senti le fils d’Ambiorix. Cela étant dit, je ne me suis risqué à ce jeu de mots que parce que, l’autre soir, Colette, que j’avais rencontrée chez elle, m’en avait offert un qui m’avait diverti, puis fait rêver. Tu connais, comme disent les puristes, sa salle de séjour : c’est chaleureux, cela vous déstresse, vous désénerve, vous décontracte, vous démyélitise — hein ? Le feu ouvert … arrogant comme un roquet, ou faisant doux la chattemite… la table basse… les tasses précieuses et la théière que l’on vide… Tu me vois venir ?
Cornélius ne voyait rien. L’amitié seule m’empêcha de faire une réflexion inconvenante.
Tu aurais ri, Colette, à voir son œil rond et interrogatif, mais tu peux le deviner.
MOI : — Mon pauvre ami… (Soupir). J’aimerais te dire certaines choses, sans trop savoir si vraiment il est bon de le faire. Tout a été dit, tu le sais. D’accord. Tout a été dit de l’homme et de ce qui intéresse son destin. Tout a été dit du théâtre. On se répète. On ne cesse de se répéter. On ne cesse de ne cesser de se répéter. Le seul ennui est qu’il y en a qui l’ignorent. Ils apparaissent sur la scène du monde, puis sur la scène de leur petit district. Ils ont des choses à dire, ils l’imaginent du moins. Mais quoi, après tout, s’il y a de nouvelles bouches, il y a de nouvelles oreilles. Je ne vais pas reprendre l’antienne. La jeunesse est souvent délicieuse sur ce point. Mais les vieux cons de mon âge deviennent sinistres quand ils se mettent à radoter et à se prendre au sérieux. Regarde-les assis dans leur Empyrée. J’aimerais assez ne pas faire partie de leur troupe. Mais va savoir… Il est peut-être une fatalité particulière qui fourre les vieux canassons dans la même écurie. Ah, bon sang ! où est l’étalon de Mazeppa ? la jument de Sitting Bull ? Toi, Cornélius, que je vois si fringant malgré l’heure…
LUI : — Je m’entretiens le cerveau.
MOI : — … toi, comment t’y prends-tu pour…