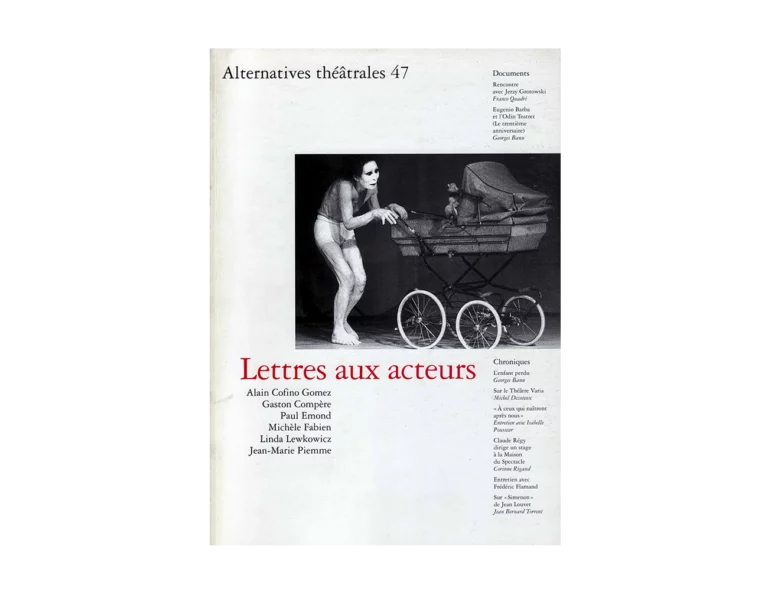BRUXELLES, le 3 août 1994
Mon cher, mon très cher acteur au pied de nez,
Depuis que eu es encré dans ma vie, dans mes rêves, dans mes passions, je me suis toujours dit qu’il fallait qu’un jour je t’écrive. Tu ne me connais même pas, alors que j’ai fait de toi mon confident secret. Dès qu’il s’agit de théâtre, de littérature, d’arc, de ce que je vois, de ce que je lis, ou même et surtout de mes propres textes, c’est d’abord à toi qu’en moi-même j’en réfère, c’est avec toi que je débats, imagine, réfléchis, crée, m’illusionne, prends parti, avance ou recule. Et voilà que m’est donnée cette superbe occasion de t’adresser cette lettre. Alors, je me jette à l’eau, j’oublie tout scrupule, toute fausse honte, les phrases se pressent dans ma tête, j’ai tant de choses à te dire ! Enfin, pouvoir te faire comprendre l’importance que tu as prise à mes yeux !
Mais quels mots utiliser pour expliquer avec un minimum de cohérence cet élan qui me pousse vers toi, pour expliquer ce qui nous rassemble à propos de choses si essentielles que c’est le meilleur de notre vie que nous y consacrons ! Il faudrait que je puisse écrire avec mon sang, moi qui n’écris même plus avec de l’encre mais avec une machine qu’on appelle traitement de texte ! Traitement de texte ! Pourquoi pas traite des textes, tant qu’on y est ! Est-ce que tout, aujourd’hui, se prostitue ? Même le langage, on ne saiet plus très bien où il va. Mais sait-on seulement encore où, nous-mêmes, nous allons ?
Bon, je m’égare déjà, alors que je ne t’ai même pas encore dit comment je ce connais. Il va falloir que tu t’y fasses, je suis un peu brouillon, désordonné, et, par dessus le marché, dès que je me mets à écrire, horriblement bavard : c’est comme ça, on ne me changera plus… Les personnages de mes pièces – puisque j’écris des pièces – ou les narrateurs de mes romans – puisque j’écris ça aussi – n’en finissent pas d’avoir des histoires à raconter, ils en ont plein la bouche, jusque derrière la cravate, et, pour tout dire, c’est même le fait de raconter qui les tient en vie.
Comment je ce connais ? Pourquoi ce ton si intime ? J’imagine déjà ton air un peu méfiant. Oui, je sais, j’ignore où tu te trouves pour l’instant, ce que tu fais, je ne sais même pas si même eu vis encore. En fait, la seule chose que je connaisse de toi, c’est ce que m’a raconté il y a quelques années, mon ami Jules-Henri Marchant, un homme de théâtre d’ici, dans un train très matinal de Bruxelles à Amsterdam, quelque part entre Breda et Utrecht, pour être précis. Mais il me l’a raconté de façon si enthousiaste et si précise que ton image s’est fixée en moi une fois pour toutes. Et elle est là, depuis, elle y vit avec une intensité extraordinaire. Comme si je t’avais toujours attendu, comme si j’avais toujours su qu’un jour je te rencontrerais. Tu vois, je parle comme les amoureux transis dans leur première lettre ; il est vrai que, depuis le récit de Jules-Henri, il ne s’est pas passé même un seul jour où je n’ai pensé à toi…
Bien sûr, on aurait pu trouver un cadre un peu plus adéquat, un peu plus théâtral peut-être, pour ton entrée dans ma vie ! Mais tant pis, à la guerre comme à la guerre ! Jules-Henri Marchant et moi-même étions assis à la fenêtre l’un en face de l’autre, le train était bondé de Hollandais mal réveillés et plongés dans les nouvelles sportives du matin, mon voisin, par exemple, lisait que l’Ajax avait battu Rotterdam et qu’il avait fait particulièrement chaud au Tour d’Espagne, bref, le tout venant. Et dehors, un ciel déjà trop bleu surplombait un paysage bourré de vaches hollandaises qui nous regardaient passer en broutant de l’herbe trop verte. Ajoute deux ou trois moulins et le décor de ton entrée dans ma vie sera kitsch à souhait. Mais il y avait notre conversation.
Depuis que nous avions quitté Bruxelles, Jules-Henri et moi-même parlions de théâtre et de littérature et je crois que c’est moi qui, du côté de Breda, ai prononcé le nom de Gogol. Gogol ! Que ne t’ai-je pas parlé de Gogol, depuis, à toi aussi, mon cher acteur au pied de nez ! Quelle joie, quel plaisir, que ce soie par le biais de Gogol que eu as débarqué dans ma vie ! Si eu savais avec quelle voracité je me nourris de Gogol ! LES AMES MORTES ! Je n’arrête pas de crier autour de moi : lisez LES AMES MORTES ! C’est un roman extraordinaire ! Et c’est tellement contemporain ! Ça montre tellement ce que nous sommes en train de redevenir aujourd’hui, des personnages sans ardeur, sclérosés, empêtrés dans tous les conformismes ! Tiens : chaque fois que me pèse vraiment trop l’existence quotidienne dans notre belle Belgique d’aujourd’hui, je reprends LES AMES MORTES. Nicolas Gogol, mon viatique. Comme Thomas Bernhard, comme Gaston Compère. Quand j’enrage, c’est chez un de ces trois-là que je me réfugie, dans leur humour, leur férocité. Er puis, les crois grandes pièces de Gogol, LE RÉVIZOR, LE MARIAGE, LES JOUEURS, quel théâtre ! Un sommet du théâtre grotesque, un sommet du théâtre universel ! Bon, je m’échauffe, je m’emballe : ce n’est pas toi qu’il faut convaincre …
J’ai donc sorti à Jules-Henri Marchant mon petit coupler sur Gogol. J’ai même dû m’enthousiasmer un peu trop vivement car un de mes voisins hollandais a levé son nez des nouvelles sportives pour me regarder d’un air hostile et inquiet. Et c’est à ce moment précis que Jules Henri – je me suis alors rendu compte qu’à propos de Gogol, il n’y avait vraiment pas à le convaincre, lui non plus – m’a raconté la mise en scène du RÉVIZOR qu’il avait vue à Moscou dans les années soixante. C’est à ce moment précis, mon cher acteur au pied de nez, qu’il m’a parlé de toi. Et ce qu’il m’a raconté là, jamais je ne l’oublierai.
Tu es certainement comme moi, n’est-ce pas, comme tous ceux qui aiment le théâtre : il y a, dans la vie de chacun de nous, deux ou trois spectacles qui nous ont impressionnés plus que tous les autres, saisis au plus vif, marqués au fer rouge. Des spectacles que chacun, selon ses goûts et inclinations, a trouvés superbes et extraordinaires, de l’art pur. Des spectacles qui sont venus percuter en plein dans le mille le petit monde de fantasmes que tous nous trimballons. Si tu savais avec quel luxe de détails je t’ai déjà parlé de mes spectacles à moi ! De ceux que je garde comme des morceaux d’absolu, comme des instants de bonheur parfait – « la littérature est une des formes du bonheur », dit Borges dans une belle formule à laquelle je reviens toujours ; mais c’est vrai aussi pour le théâtre, et je suis sûr que tu le sais mieux que personne. Sans hésiter, je citerais d’abord l’ANTIGONE de Sophocle par le Living Theatre – c’était en 1967, il y a longtemps déjà – , et SUR LA GRAND-ROUTE, la petite pièce de Tchekhov, montée par Grüber en 1984. Un jour, dans une autre lettre, je t’expliquerai pourquoi particulièrement ces deux spectacles-là. Parce que, si je m’y mecs maintenant, je n’aurai jamais le temps de ce parler de toi.