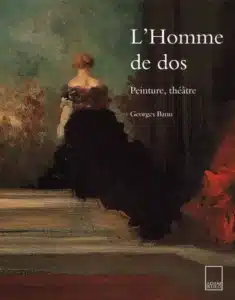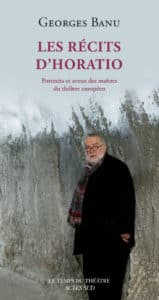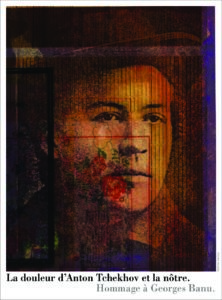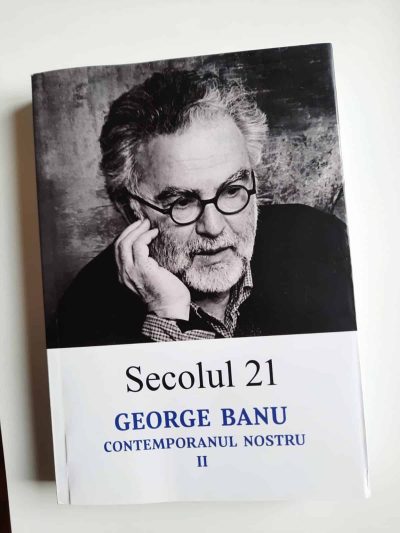Une lumière au cœur de la nuit : le lustre, de l’intime à la scène
Georges Banu, Paris, Editions Arléa, coll. « Littérature française », 2020, 128 p., ISBN : 9782363082169
En 2009, Georges Banu faisait paraître Des murs… au Mur aux Editions Gründ. En 2015, La Porte, au cœur de l’intime, aux Editions Arléa. Cette dernière maison a offert à l’auteur une nouvelle opportunité d’écrire un de ces textes situés un peu à la marge de ses publications habituelles, généralement consacrées au théâtre (pour ne citer que les plus récentes : Shakespeare, Le monde est une scène, Gallimard, 2009 ; Le Voyage du comédien, Gallimard, 2012 ; Amour et désamour du théâtre, Actes Sud, 2013 ; Le Théâtre ou le défi de l’inaccompli, Les Solitaires Intempestifs, 2016 ; Le Théâtre de Anton Tchekhov, Ides et Calendes, 2016). Le théâtre inspire inévitablement de nombreuses pages du volume, qui s’attaque cette fois à la mythologie – au sens que Barthes attribue à ce terme – du lustre. Il occupe néanmoins une place à peine plus importante que l’art, et tous deux sont pris dans un flux qui relève plus largement de la vie, qui permet au critique de passer « du salon à la scène, du privé au public ».
Des murs aux portes, des portes aux lustres, Georges Banu trace un itinéraire qui mène dans des lieux de plus en plus intimes. Dans la continuité de ses précédents essais, il commence d’ailleurs par distinguer les différents types de lumières qui strient la nuit, avant d’avouer qu’il s’invite parfois en pensée chez les personnes dont il voit le lustre rayonner depuis la rue. Cette fois, l’auteur pousse néanmoins la porte qu’il s’était efforcé de déchiffrer auparavant, et franchit le seuil qui sépare l’extérieur de l’intérieur.
Le caractère intime de ce texte – l’adjectif était déjà mis en valeur dans le titre de son essai sur les portes – n’est pas que d’ordre spatial. Dès les premières pages du volume, le lecteur retrouve le « je » qui fait la marque distinctive des essais de Georges Banu. Loin de s’embarrasser du « nous » de rigueur dans le champ universitaire, l’auteur assume dans tous ses textes la première personne. Toujours, il parle en son nom, revendique sa sensibilité et son histoire, et convoque ses expériences moins comme des exemples que des souvenirs personnels. D’ouvrage en ouvrage, ce « je » instaure une relation de familiarité avec lui. La rencontre avec l’homme, loin de contredire l’image que façonne la lecture, révèle le caractère profondément authentique de cette écriture presque autobiographique. Georges Banu est le même, dans ses livres et dans la rue.
Dans la rue, car Georges Banu est un promeneur. Qu’il marche dans les rues de La Havane ou dans celles dans lesquelles il passe tous les jours, il ne cesse d’observer et de relever tout ce que le réel peut avoir d’intriguant. Il s’arrête et capture ce qui l’a interpelé en prenant une photo avec son portable. Le geste, qui le rapproche des générations Y et Z, lui permet de capter l’instant – peut-être habité – qui a fait surgir en lui une pensée, une idée, un souvenir. Plusieurs de ces photos qui ponctuent son quotidien se retrouvent dans les pages de cet essai. Elles représentent bien entendu des lustres : lustre qui orne un intérieur privé, lustre déposé dans une vitrine à l’étranger, ou lustre gisant dans un carton, au fond d’un garage. Sans même lire la légende, il apparaît au premier coup d’œil qu’elles ont été prises par l’auteur. Non par leur manque de professionnalisme, mais par l’intimité et la spontanéité qui s’en dégagent. L’affection toute particulière que confie Georges Banu pour les lustres dans cet essai laisse penser que ces photos ne sont très probablement qu’un maigre échantillon de toutes celles que l’homme a pu glaner au cours de ses voyages.
Aux côtés de ces clichés personnels, se trouvent également, dans les pages de ce volume, des photographies de mises en scène. Quoique la composition et le grain de ces images révèlent d’emblée leur caractère professionnel, la façon dont Georges Banu les convoque les situe au même plan que les premières. Dans ses textes comme dans sa conversation, chaque phrase est habitée par le théâtre, et les souvenirs de la scène paraissent faits de la même étoffe que les souvenirs intimes. Certains spectacles semblent même s’inscrire avec plus de force dans la mémoire que certaines scènes vécues. Une telle intrication rend vaine la distinction entre d’une part « la vie », et de l’autre « le théâtre », et dans cette continuité profonde réside peut-être la puissance d’analyse de Georges Banu. Avec elle, les spectacles vibrent bien au-delà d’eux-mêmes et continuent longuement de nourrir sa pensée, tandis qu’hors de la salle, le réel est déchiffré avec l’attention aigüe du spectateur-critique.
C’est ici pour explorer toutes les connotations possibles du lustre que le critique puise « dans [la] bibliothèque personnelle des spectacles de [sa] vie ». Si le théâtre se prête à un tel exercice, c’est parce qu’il « est le maître des signes qui se dérobent à ce qui est attendu » (34). Au gré de sa mémoire, Georges Banu voyage donc dans le temps et l’espace, de Bucarest à Paris, de Porto à Saint-Pétersbourg, du milieu des années 1970 – quand il arrive en France et découvre Bob Wilson – à aujourd’hui. En creux, il brosse l’autoportrait d’un spectateur-voyageur, qui ne fait pas de listes, ne s’oblige pas à organiser ses réflexions en système, mais fait resurgir à point nommé tel ou tel souvenir pour découvrir de nouvelles interprétations au lustre. D’une mise en scène à l’autre, le lustre est tour à tour envisagé comme symbole de pouvoir, comme signe d’une époque passée évoquée avec nostalgie ou politiquement dénoncée, comme un accessoire de fêtes somptueuses, comme un élément scénique qui brouille les frontières du dedans et du dehors, ou comme la métaphore d’une résistance à la nuit ou d’un bonheur qui échappe. Ses associations vagabondes sont organisées en chapitres thématiques aux titres percutants – par exemple, au hasard, « Le lustre dans la ville », « Le cristal et la boue », « Mémoire et prestige »… – dont le mystère de l’enchaînement reste intact.
Au-delà du théâtre, l’essai comprend également quelques reproductions d’œuvres plastiques – peintures, installations, photographies. Leur importance révèle qu’elles font elles aussi partie de ce même flux vital qui mêle l’art au quotidien, ce que confirment ces quelques lignes qui renvoient à son enfance : « L’art doit être vu de près, de très près, comme je l’ai fait dans la maison de mon père, où je me couchais en regardant des tableaux de maîtres roumains dont j’ai saisi le secret mieux que tant d’autres en raison même de cette intimité, de cette imprégnation » (101).
Cette confession aux accents proustiens est exemplaire de la mélancolie qui se loge au creux de cet essai. Alors que l’auteur avoue dès le début se percevoir comme « un vaisseau en perdition » (30), il accorde ensuite une place centrale à Tchekhov, et plus particulièrement à La Cerisaie, pièce de la disparition dont il souligne « l’indéfinie tristesse ». Ce ton mélancolique sied parfaitement à l’objet décrit, dont Georges Banu répète à plusieurs reprises la tendre nostalgie qu’il suscite en lui. Les dernières pages prennent néanmoins un tour presque testamentaire, lorsqu’il confie que ce texte lui a été inspiré par le besoin de trouver un refuge dans les temps troublés que nous vivons, et qu’il l’appréhende comme un « ultime rempart avant la nuit d’alentour… » (112).
Les leçons que le maître dispense avec cet essai sont multiples. La première, qu’illustre toute une vie, est une attention profonde au réel, et aux lustres en particulier, qu’il ne sera plus possible de ne pas remarquer sans penser à cet essai. C’est ensuite une démonstration d’écriture qu’offre Georges Banu. Le texte est bref, fulgurant, il se lit d’une traite, crayon à la main, pour relever presque à chaque page des phrases ou des expressions. Au-delà du caractère esthétique de ce style, l’auteur démontre une nouvelle fois la puissance conceptuelle d’une écriture qui saisit le monde et les œuvres, aussi retors soient-ils, en peu de mots. A plusieurs reprises, ses formules s’apparentent à des « miniatures théoriques » (titre d’un de ses essais sur la scène contemporaine d’une pertinence transperçante), qui invitent à prolonger la réflexion dans de multiples directions une fois le livre refermé. Georges Banu énonce enfin une vérité aussi évidente et nécessaire pour tout lecteur et pour tout spectateur qu’informulée : « L’art exige du temps, que ce soit pour l’accomplir ou le regarder » (102).