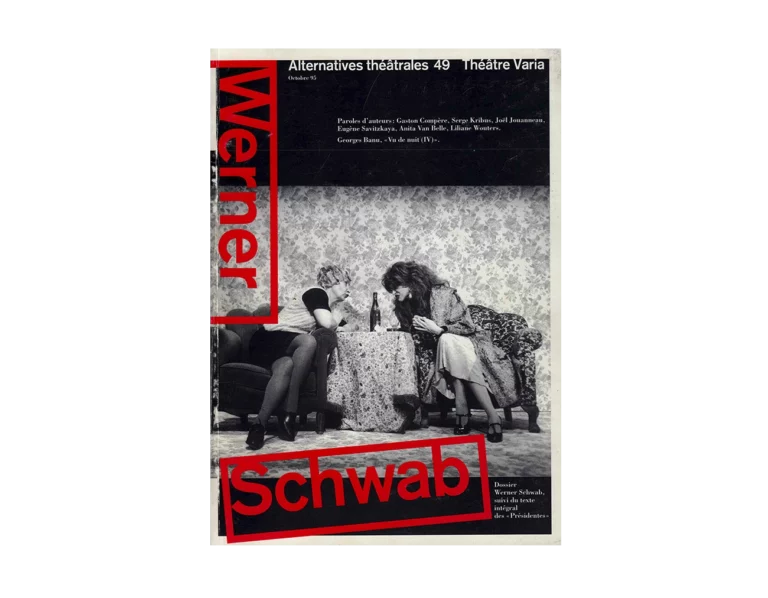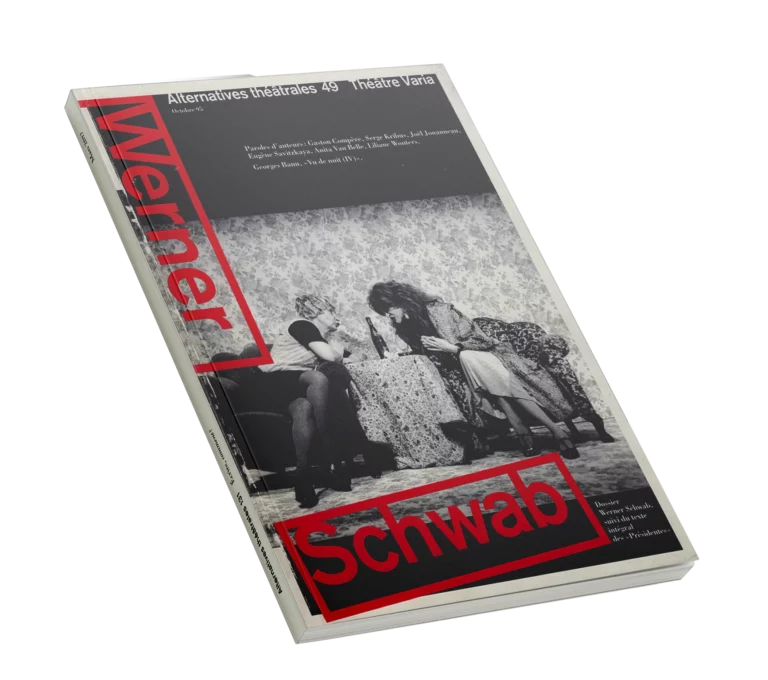DANS FOLIE DE TROILUS ET THÉATRE DE CRESSIDA, la version schwabienne de la pièce de Shakespeare1, les comédiens et comédiennes d’un théâtre institutionnel allemand répètent la tragi-comédie de l’élisabéthain.
Dès le début, les interprètes ne s’intéressent pas vraiment à la pièce de Shakespeare. Un comédien d’un certain âge est le seul à exiger un travail artistique sérieux ; il est tout de même question de meurtre et d’homicides organisés ! Mais la plupart des interprètes abordent leurs rôles plutôt par associations ou d’une manière privée. Ils ne retiennent que ce qui correspond à leur propre biographie, et au fur et à mesure que les répétitions avancent, les personnages et les situations dramatiques de la pièce de Shakespeare servent de plus en plus de prétextes pour s’exprimer à l’intérieur du groupe, sans aucun rapport direct avec la pièce. Personne ne se soucie d’un éventuel message à faire passer au futur public.
Avant même d’arriver à l’entracte, les préoccupations des uns vis-à-vis des autres sont déjà largement au centre du travail de répétition. On ne s’intéresse, pour ainsi dire, plus qu’à une seule question : la comédienne qui interprète Cressida va‑t elle se lier avec l’interprète de Troïlus, humain et engagé, mais naïf, ou bien avec celui de Pandarus, plutôt malin et en dépit de son âge, toujours séduisant.
Le comédien qui tient le rôle d’Agamemnon aimerait conserver, au sein du groupe, l’autorité allant avec son personnage ; cependant, l’interprète d’Ulysse ne rate pas une occasion de lui reprocher sa totale incapacité, tant sur le plan humain qu’artistique. A cette dispute pour la prédominance dans le groupe, se mêlent l’interprète d’Enée, un comédien encore très jeune, et celui incarnant Ajax, âgé et plus réfléchi. Le comédien qui joue Achille se prend, même dans la vie privée, pour un être exceptionnel, et il le fait sans arrêt bien sentir aux autres. « Pâris » a une liaison avec l’interprète d’Hélène. De son côté, celle-ci semble s’intéresser à n’importe lequel des autres hommes, jeunes ou âgés, bien plus qu’à l’interprète de Pâris. Elle se plaît à être celle que tous les hommes de la troupe désirent, et se croit irrésistible.
À mesure que les répétitions avancent, on constate que le déséquilibre, dû au fait que les comédiens se désintéressent progressivement de leurs personnages pour faire montre d’un comportement de plus en plus privé, se manifeste le plus chez l’interprète de Nestor, qui est sur le point de partir à la retraite. Le souvenir d’une défaillance personnelle à l’égard de son épouse, ayant entraîné la mort prématurée de celle-ci, surgit à maintes reprises, s’incruste dans l’interprétation de son personnage et relègue celui-ci carrément au second plan.
La situation arrive finalement à un point où le plateau de répétition, les décors et costumes de plus en plus élaborés d’un acte à l’autre, les contraintes dues aux personnages qu’il faut malgré tout respecter d’une manière ou d’une autre, ainsi que le théâtre en général, ne sont plus ressentis que comme chaînes et obligations. A la fin du troisième acte, l’interprète de Pandarus propose de quitter le cadre habituel du théâtre avec ses règlements et restrictions tels que heures fixes de début et de fin de répétition, pauses réglementées, mise en scène établie, dépendance au texte etc., pour s’installer dans une nouvelle liberté qu’il appelle le « théâtre total » :
«Pandarus : Voulez-vous le théâtre total de sorte qu’apparemment nous ne soyons plus obligés de travailler dans un véritable théâtre ?
Tous : Ouiiii !»
L’endroit où cette nouvelle liberté doit s’accomplir est un camping rempli de caravanes ; les membres de la troupe y organisent un barbecue, indépendamment de Shakespeare, et sont apparemment déterminés à vivre le plus librement possible à tous les niveaux.
Et c ‘est là le véritable problème. Celui qui veut vivre sa vie doit être conscient de lui-même, il lui faut une identité et de l’assurance.
Mais les interprètes mis en scène par Schwab n’ont pas une identité au sens propre du terme. Création de personnages et biographies se confondent en un agglomérat diffus, et cela d’autant plus que Schwab donne deux rôles à chaque interprète. Le vieux « Pandarus » joue également le personnage fringant qu’est Diomède ; « Prince Troïlus » est par ailleurs l’interprète du serviteur troyen Alexandre ; « Cressida » se charge aussi de la sœur de Troïlus, Cassandre, qui sait prédire le futur ; « Nestor » incarne également Calchas, le traître ; « Ulysse », noble et rusé, est aussi responsable du vulgaire et grossier Thersite ; « Hélène », la joyeuse, joue par ailleurs Andromaque, l’épouse sage du héros troyen Hector, et ainsi de suite. La seule exception, c’est l’interprète d’Hector. Il ne joue que ce seul personnage et n’est même pas prêt à l’accepter entièrement.
Cette triple définition des autres interprètes (deux personnages et leur propre existence) rend difficile le développement d’une identité personnelle. « Achille », par exemple, se sent fort et supérieur dans le rôle du héros grec, mais faible et dépendant dans celui de Ménélas, le roi cocu de Sparte. Ce qu’il est en réalité est la dernière chose qu’il voudrait savoir. Dans le deuxième acte, il dit qu’il ne se comportera pas « conformàmoimême ». L’interprète de Pandarus cherche à excuser son envie de contrecarrer l’entente amoureuse de « Cressida » et du comédien qui incarne Troïlus par le rôle de Diomède, son deuxième personnage, n’empêche que cela lui tient également à cœur en tant que personne privée. La comédienne qui interprète Hélène profite de l’attitude trop transparente de Pandarus : elle fait inopinément une apparition habillée et maquillée en Andromaque pour crier son désespoir personnel : « Voilà ce que c’est en soi. Toujours rien que le personnage, une seule et ratée incarnation personnagiste !»