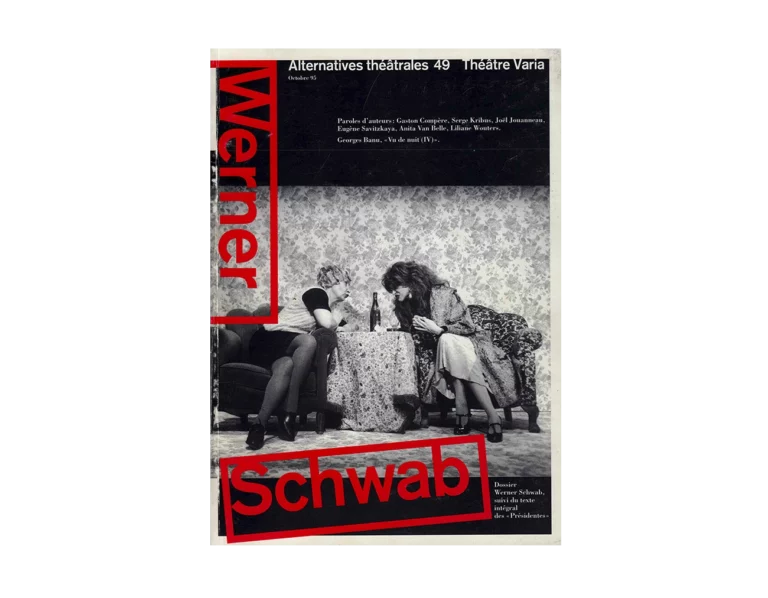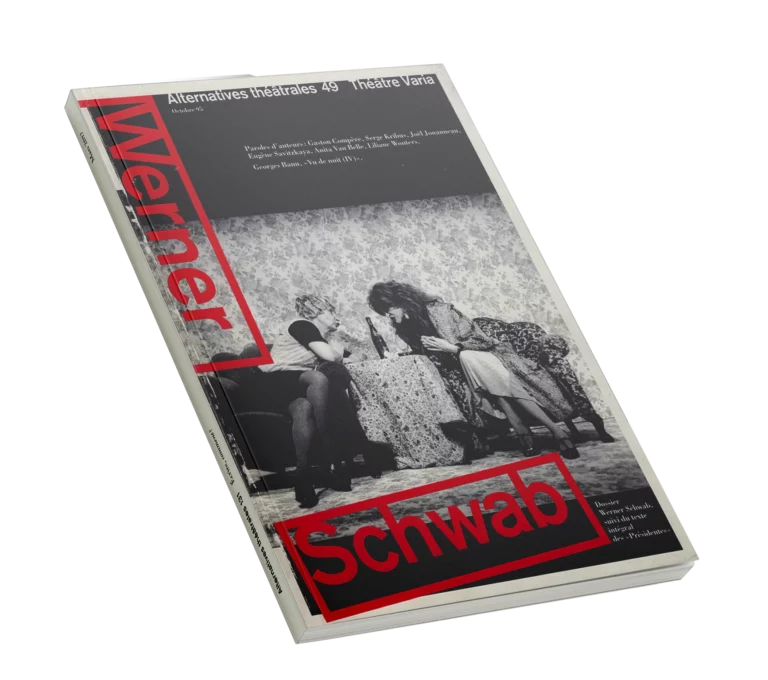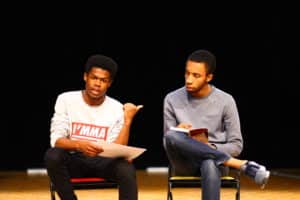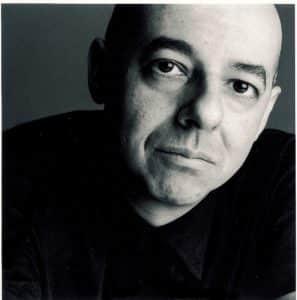GASTON COMPÈRE : C’est un peu par accident que j’en suis venu à l’écriture théâtrale. Il a été un temps où j’étais passionné par le dialogue romanesque. J’en ai cherché la spécificité. Je vous assure, cela peut vous donner un fameux tintouin. La spécificité, c’est tout un problème. Pour bien faire, il faut des points de repère. Je n’avais pas de points de repère. Je me suis dit : il y a l’écriture théâtrale, ça a l’air plus clair de ce côté-là, si j’allais y voir ? J’y suis allé, et, je m’en suis aperçu tout de suite, la situation était incomparablement plus nette : le dialogue théâtral est écrit pour un public qui vous·ouvre ses oreilles ; il est de première nécessité de le toucher directement, sous peine de sanction immédiate. L’écriture doit porter, comme on dit, et son efficacité peut se contrôler à vue d’œil.
C’est de cette confrontation entre deux espèces d’écriture que m’est venu le désir d’écrire pour le théâtre, – écriture que je n’avais jamais pratiquée. C’est nettement plus amusant que l’écriture romanesque. Le lecteur de roman, et, en l’occurrence, de dialogues romanesques est dans un tout autre état d’esprit et de contexte que celui qui, au théâtre, écoute des acteurs. Bon. J’ai donc écrit des dialogues, que j’imaginais pouvoir être portés à la scène. Je ne m’imaginais jamais, à l’époque où j’ai écrit les premiers d’entr’eux, qu’ils pourraient un jour être prononcés sur des tréteaux. Le seul plaisir de les écrire me suffisait amplement. C’est un peu par hasard que j’en suis venu à rassembler tous les fragments d’un dialogue pour en sortir une pièce. Et voilà, l’aventure a démarré – non point contre mon gré, certes, mais sans que j’en pense vraiment quelque chose de sérieux.
En vérité, à cette époque, je n’avais d’autre ambition que d’écrire des romans, et de le faire en quelque sorte d’une façon expérimentale. Ce par quoi ce genre de travail m’intéressait était qu’il pouvait se faire à différents niveaux. Raconter pour raconter ne m’intéressait pas. Il fallait pouvoir déployer le roman comme un éventail. Et je dois dire que Rabelais m’avait été un excellent professeur. Toute l’œuvre se présente comme susceptible d’interprétations les plus diverses. La première lecture d’un roman a son importance sans doute, mais une importance limitée. Ce n’est pas le cas pour une pièce de théâtre : l’action est incomparablement plus directe ; il vous faut être directement efficace. Le public n’achète pas son billet pour se trouver devant des points d’interrogation. Après le spectacle, on peut se permettre de réfléchir, mais c’est là un travail personnel. Le roman vous est dans les mains et propose ses énigmes plus ou moins énigmatiques. Mais le théâtre… Je crois pouvoir affirmer que le théâtre n’a rien à voir avec la littérature. Le théâtre n’est pas un texte, mais un spectacle.
Au début, quand j’écrivais « expérimentalement » pour le théâtre et pour moi-même, je pensais au public, et à un public qui écoute : en conséquence, l’écriture ne se faisait pas de la même manière que lorsque j’écrivais un roman. Quand j’écris un roman, jamais le public ne m’est présent à l’esprit. Je ne dit-ai pas que je m’en fiche, non ; je n’y pense pas, tout simplement. Comprenez, quand il s’agit d’écriture théâtrale, que j’aie pu prendre plaisir à écrire pour un public qui pourra percevoir le texte que j’écris et réagir dans l’instant.
Peu à peu je me suis mis à écrire des pièces, et c’étaient toujours des pièces plus ou moins tordues. Elles étaient là devant moi, sur ma table, jamais terminées, toujours prêtes à être remaniées, et sans espoir jamais d’être tout à fait arrêtées. Les circonstances d’une représentation pouvaient m’amener à les refondre complètement. Jamais de textes aboutis. Mais quand je sentais qu’ils pouvaient marcher pour un public, j’étais content, ni plus ni moins.
Et voilà qu’un jour, une représentation s’est profilée. Le responsable en était Roger Domani, qui dirigeait le Théâtre de Poche à Bruxelles, grand découvreur de textes, et je dis ceci non pas pour mon texte à moi, mais parce que c’est justice de le dire. Il a lu un de mes textes, puis est venu me trouver et m’a dit : « On va faire quelque chose avec ça : pas d’objection ? ». La mise au point du texte n’a pas été faite par moi, mais par François Mestre, qui a repris la pièce, l’a toute retravaillée à sa manière, a fait un travail, mon Dieu, intéressant mais qui n’avait pas grand chose à voir avec le mien et avec mon monde à moi. Mais je dois dire que je n’avais qu’à m’incliner car, et c’était étonnant, il n’avait pas, au fond, tellement changé de choses. C’était là une expérience amusante. Pour un solitaire comme moi, toujours enfermé dans son coin avec ses bouquins et ses textes, tomber, tout à coup, dans un monde vibrant, qui remue, avec ses excentricités, ses égoïsmes, ses générosités, et caetera, c’était vraiment une belle et remarquable expérience. Et j’ai pu entrer en contact avec un tas de gens dont la plupart étaient vraiment sympathiques.
Pietro Pizzuti : Est-ce l’aspect artisanal de votre première approche du théâtre qui maintient vive en vous l’image mentale d’un théâtre inabouti ? Seriez-vous à le remettre sur le métier avec les artisans du passage à la scène ?
G. C.: Oh, mais tout de suite, et avec de la gratitude au cœur. Ce temps qui passe si vite, avez-vous remarqué comme il se fait long lorsque l’ennui vous touche ? En vérité, j’ai toujours pensé travailler avec un metteur en scène. Un metteur en scène est un homme de terrain, moi je ne suis qu’un type qui rêve et qui bredouille dans la nuée. Vous avez déjà sans doute pu le constater, comme moi, qu’il y a des auteurs qui, dès qu’on touche à une virgule de leur texte crient comme des putois et se permettent une crise de nerfs. Je ne suis pas de ces gens-là — oh vraiment pas ! Ce serait d’ailleurs stupide si le texte est un texte écrit pour la scène. Ce texte n’est qu’un matériau, et il faut le faire vivre. Bien sûr, l’option fondamentale de l’auteur est capitale. Au fond, le patron, c’est lui. Il a droit au respect. On n’a pas à lui faire dire des choses qu’il n’a jamais dites. C’est une expérience que j’ai vécue avec mon malheureux Maeterlinck. Toutes les insanités qu’on a pu dire à son sujet et au sujet de ses textes ! Et ce n’est pas fini, hélas !
Tenez, en ce qui me regarde, je suis à peu près dans la même situation lorsque j’écris de la musique. Quand je compose, je n’écris pas la moindre indication. Et si je le fais, c’est si rarement qu’on n’a guère à en tenir compte. De la sorte, chaque fois que le morceau est joué, il est joué différemment, et c’est toujours intéressant à écouter. Évidemment les notes sont en quelque sorte les gardiennes de la partition. Les interprètes ne peuvent pas se permettre n’importe quoi. Mais tout de même, il est bon que l’on se mette dans la tête que l’avis du compositeur n’a en soi pas plus d’importance que celui de l’interprète. Que le compositeur travaille sa partition à sa guise. Mais une fois livrée aux interprètes, qu’il ait assez de bon sens pour se dire qu’elle ne lui appartient plus – ou si peu.