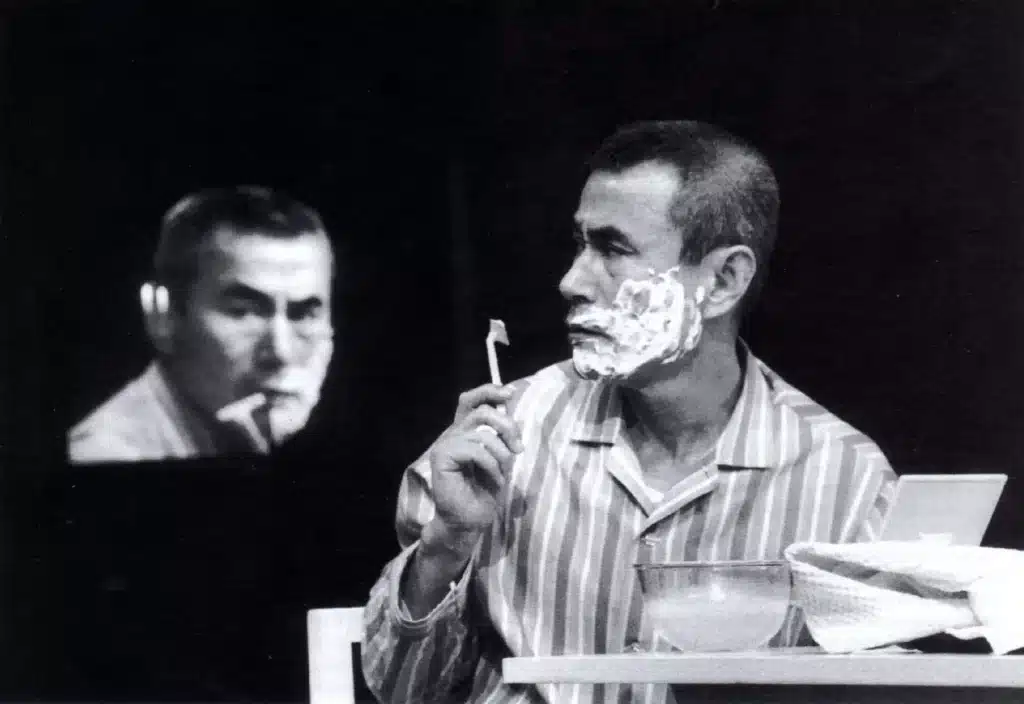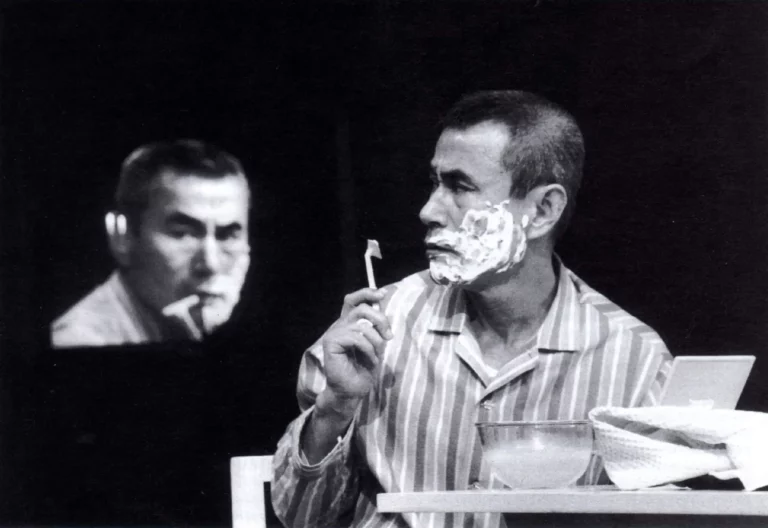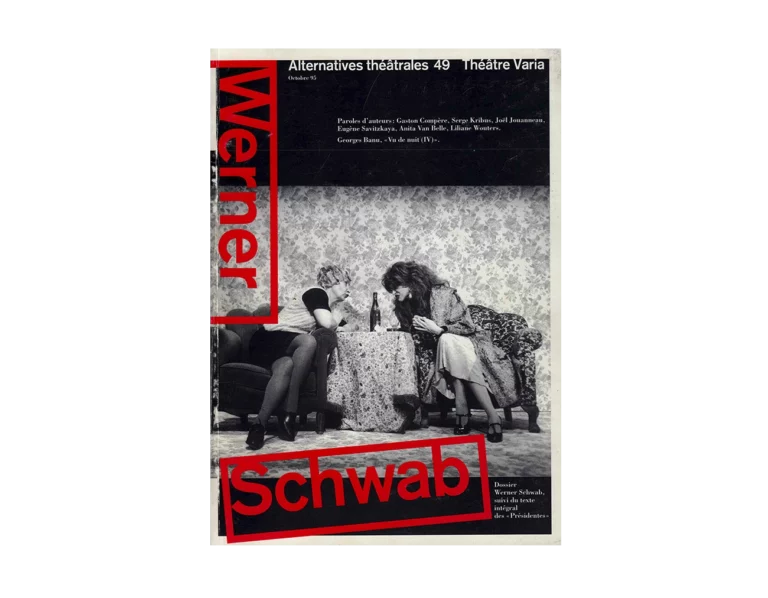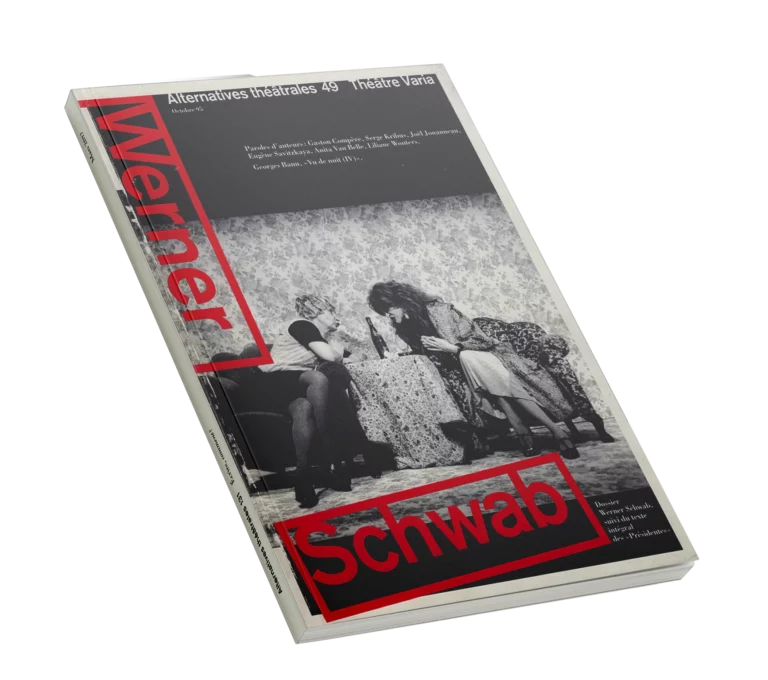Pour Ariane Mnouchkine
SI CE TEXTE DÉBUTE par un raccourci de récit, ce n’est point par narcissisme de l’aveu ou désir d’injecter du subjectif, mais parce que souvent, au théâtre, l’expérience directe transforme une attente diffuse ou une crainte non dite en pensée. Lestée par le vécu théâtral, elle en porte la marque au point d’en être indissociable. Ce vécu d’origine, on se doit alors de l’évoquer.
Dans la Cour du Palais des Papes, presque collé à la lèvre du grand plateau, ayant à côté une amie argentine et quelques jeunes critiques européens, je me livrais à l’exercice agréable de la revisitation… revisitation des chefs-d’œuvre de Pina Bausch ! Cela invite toujours à comparer car les souvenirs d’époques successives se juxtaposent sur fond de continuité de l’œuvre vivante qui, elle, par rapport au livre ou au tableau, bouge tout de même. Double métamorphose, du sujet et du spectacle. Lentement, le regard oublieux de la danse se déplaça vers les danseurs et LE SACRE DU PRINTEMPS me toucha par la dépense extrême de ces êtres du monde réunis sur une scène. Sur des corps différents, noirs, blancs, sur des visages de toutes les formes, la sueur perlait d’abord pour couler ensuite démesurément… l’effort reliait l’ensemble bigarré dont la diversité planétaire se présentait dans une belle entente. L’acte scénique parvenait à réunir un groupe d’êtres humains. Par delà la diversité initiale, l’union finale ! Le sentiment était de plénitude.
Quelques jours plus tard, bonheur inespéré et peut-être immérité, j’écoutais au Mozarteum à Salzbourg un concert dirigé par le vieux maître hongrois Sandor Vegh dont le visage d’octogénaire d’outre-sexe rappelait celui de Gordon Craig… Visage d’innocence sur un corps raidi dont les bras désarticulés semblaient être ceux d’une poupée au terme de sa carrière. Mais de la salle, je ne cessais pas de m’imaginer la brillance du regard qui dirigeait ce jeune orchestre où, une fois encore, le travail réunissait des artistes de tous les coins du globe. Le maître accompli et les musiciens du monde… ensemble ils produisaient de la paix.
Chaque fois, la différence culturelle, raciale, semblait être dissoute par l’exercice de l’art, la musique ou la danse que Béjart avait utilisées, il y a trente ans déjà, pour faire de la IXe SYMPHONIE, la preuve programmatique d’une alliance des êtres par delà toutes les ségrégations. Ce qui chez Béjart semblait alors naïf car trop explicite, devenait chez Pina Bausch ou Sandor Vegh réalité implicite. Elle ne cherchait pas à s’ériger en discours et se présentait uniquement comme donnée du travail, terrain nourricier indispensable, mais pas impérativement évident, que le spectateur reste libre de prendre en compte ou d’ignorer. Cette unité-là rassure. L’unité obtenue par la pratique même de l’art va de soi. Le sens qu’elle dispense, bien que subrepticement, réconforte. Il n’a rien de perturbateur, l’apaisement de la séparation devient possible. Parce qu’ici l’art l’emporte sur l’histoire, et l’unité sur la division, il donne des raisons d’espérer.