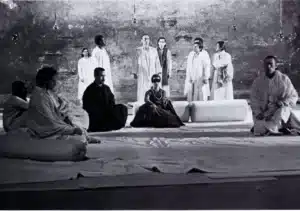Point de reconstitution intégrale de ce paysage au relief varié que fut la vie de Jean-Claude Carrière tant évoquée après sa disparition. Mais, pour paraphraser le titre d’une célèbre toile de Hokusai, Vue sur le mot Fuji, seulement quelques vues sur « la montagne Carrière » obtenues grâce à la proximité, par éclipses, que j’ai entretenue avec lui. L’instant biographique vaut autant que le parcours panoramique : c’est une question de choix. Le myope et le presbyte voient des choses différentes mais l’essence de ce qu’ils parviennent à examiner ne diffère pas.
Lorsque je préparais le numéro 40 – pour moi, inoubliable ! – de la revue Théâtre/Public consacré, pour la première fois, à la traduction théâtrale, émergence propre aux années 80, je me suis voué à une enquête orale parmi les figures emblématiques d’alors. Jean-Claude m’a accueilli dans sa splendide maison près de la place Saint-Georges qui, par des objets et des peintures d’une splendeur sans nom, dessinait son parcours en zig-zag dans le monde autant que ses engouements successifs. Une errance heureuse ! Nous devions parler de son travail récent auprès de Peter Brook pour la version française de Timon d’Athènes qui avait ouvert en 1974 les Bouffes du Nord. Ils avaient relevé ce défi et réussi, ensemble, à définir la phrase de Shakespeare par une organisation propre, différente de la phrase française : ici ils avaient décelé l’énergie des « mots rayonnants », ces mots qui, rétifs aux soucis d’architecture de la syntaxe classique, surgissent, éclairent, se retirent dans une mouvance irrépressible qu’il s’agit de capter lors du passage d’une langue à l’autre. Jean-Claude m’a ainsi évoqué les variations du mot « soleil » dans un des premiers monologues de Timon : son mouvement souterrain, son mode de paraître et de disparaître, son appel, implicite, lancé dans la direction du traducteur autant que de l’acteur. Mercure qui agite les veines du texte ! J’entendais et j’éprouvais la séduction de sa voix, de son timbre velouté ponctué de sourires qui tempéraient toute propension à l’autorité du discours si souvent adoptée dans les années 80. « Il ne faut jamais oublier que le dernier mot écrit par Shakespeare, au terme de La Tempête, c’est liberté » me révélait – il alors. Depuis, on l’a appris… Et une métaphore revint souvent — il aimait tant les métaphores, se dissociant aussi du mépris dont elles étaient frappées à l’époque — la métaphore du traducteur placé dans une embarcation légère afin de « naviguer au plus près » : « cela préserve l’identité du texte et la liberté du traducteur » concluait –il. Voilà sa posture adoptée pour sa première version française d’une oeuvre de Shakespeare dont il ne s’est jamais tout à fais éloigné !
Un soir qu’entassés dans un taxi nous nous dirigions à trois ou quatre vers une table ronde en banlieue, j’ai demandé à Jean-Claude ce qu’il pensait de « l’homme de dos » qui faisait l’objet de mes préoccupations constantes. Il m’a répondu en citant une phrase de Peter Brook car, par-dessus tout, il était un être à même de tisser des échanges et de cultiver des liens : « Quand André Antoine a décidé de faire jouer certains acteurs de dos est née la mise en scène » ! Opinion étonnante : « le dos » de l’acteur assumait la constitution d’un univers propre au plateau désormais insoumis à la salle. Le jeu de face avec ce qu’il impliquait comme soumission était abandonné et la scène se dégageait de son emprise : avènement du metteur en scène ! C’est blotti sur la banquette arrière que Jean-Claude m’a transmis cette idée étonnante de Brook.
Jean-Claude était un laboureur réfractaire à la solitude avec ce qu’elle comporte de rassurant et tout autant de frustrant. Il aimait se livrer à la vie dans sa plénitude, et c’est, sans doute, ce qui a nourri sa relation privilégiée avec Peter Brook. Il m’a évoqué avec force détails — il savait les relever plus que nul autre ! — ces soirées partagées dans la maison d’un érudit expert, de Sacy, qui leur raconta le Mahabharata ; et lorsque le récit fut achevé ils se dirent, en pleine nuit, dans une rue déserte : « Un jour on va le faire » ! Contrat respecté, complicité assumée ! Mais à ce pacte symbolique fait face une autre « vue » tout aussi significative pour la mobilité de Jean-Claude. Nous parlions depuis un bon moment au téléphone le matin tôt quand Jean-Claude, en s’excusant, m’informa courtoisement de l’obligation impérative de mettre un terme à notre dialogue : « Je dois partir car j’ai un rendez-vous avec le Dalaï-lama à Roissy ». De prime abord, cela m’avait semblé être d’une mondanité sans nom, mais ensuite j’ai compris : il savait ne pas se replier dans son bureau pour chercher, indistinctement, son bien partout !
Lors d’un voyage à Naples pour une rencontre dont j’ai oublié l’objet — la mémoire fait un tri sévère et intransigeant — Jean-Claude me convia à quelques promenades ensemble en formulant notre régime de déplacement : « Soyons piétons dans cette ville qui a capitulé devant la voiture » ! Il y en avait partout, garées sans le respect de nul interdit et nous, nous nous livrions à un véritable slalom joyeux dans ce labyrinthe chaotique des véhicules. De retour à Naples, plusieurs années plus tard, le diagnostic formulé par Jean-Claude m’est revenu à l’esprit : la ville s’était rebelleé et avait pris sa revanche sur la voiture ! Mais notre promenade conservait son goût de jadis.
Ici et là, il m’a été permis de rencontrer certaines des nombreuses femmes qui ont traversé la vie de Jean-Claude. Des identités contraires, des relations diverses… jusqu’au moment où, dans un appartement, près de Notre-Dame j’ai éprouvé un double éblouissement en rendant visite à une mère et à sa fille, toutes deux venues d’Iran. La mère, Madame Tajadod, m’était connue de réputation car elle avait collaboré avec Peter Brook pour Orghast, son spectacle le plus radical, et lui avait permis de redécouvrir les sons perdus d’une langue disparue, l’avesta. Une archéologue de la voix ! Sa sérénité était teintée d’une chaleur discrète. A côté, sa fille illuminait la pièce de sa beauté et de la brillance de son regard qui, ensemble, invitaient, sans plus attendre, au dialogue le plus confiant. Jean-Claude arriva et en ouvrant les bras avoua sans réserve : « C’est ma famille ». Je ne les ai pas revus ensemble mais cet instant reste unique. Partage du bonheur des êtres réunis ! Nahal est devenue sa femme et signa des livres grâce auxquels j’ai retrouvé « l’esprit de Téhéran ».
Quand est paru le Cercle des menteurs, ce recueil admirable de contes réunis par Jean-Claude, il m‘a dit lorsque je lui fis part de mon enthousiasme : « Georges, je veux te raconter une histoire que j’ai découverte tardivement quand le livre était sous presse et, qu’à mon grand regret, je n’ai pu y introduire ». Nous sommes restés ensemble devant les Bouffes et il m’a parlé : « Dans une contrée africaine il y avait un homme riche qui, mourant, appela son fils et il lui montra sa maison ornée, débordant de décorations et de nourritures et il lui dit avec contentement : « Tu vois, mon fils, tout ça est à toi ».
Quelque temps plus tard, un vieil homme pauvre, sur son lit de mort, lui aussi, appela son fils et, ensemble, ils sortirent sur le pas de la hutte d’une modestie sans nom. Le père avec un geste large indiqua à son fils les montagnes et les plaines exposées sous leurs yeux « Mon fils, tout ça est à toi ».
Cadeau « immatériel » de Jean-Claude Carrière que je porte avec moi.
P.S. Margarethe von Trotta qui fut son amie et qui est aussi la mienne, m’a écrit : « Cher Georges, Moi aussi je me sens un peu plus seule après la mort de Jean-Claude… Il a eu une vie tellement riche et accomplie, il était si important pour ses amis, aimé de tant de belles femmes… peu de gens ont connu cette plénitude. Alors il faut nous réjouir de l‘avoir rencontré »
P.S. bis. Voici le dernier message que j’ai envoyé à Jean-Claude : « On dirait Peter… très attachante rencontre urbaine ! Avec mon amitié fidèle, Georges »

Jean-Claude m’a répondu : « Oui ! C’est pourquoi j’ai traduit « A l’écoute » de Peter chez Odile Jacob ! » Notre ultime échange ! Silence !