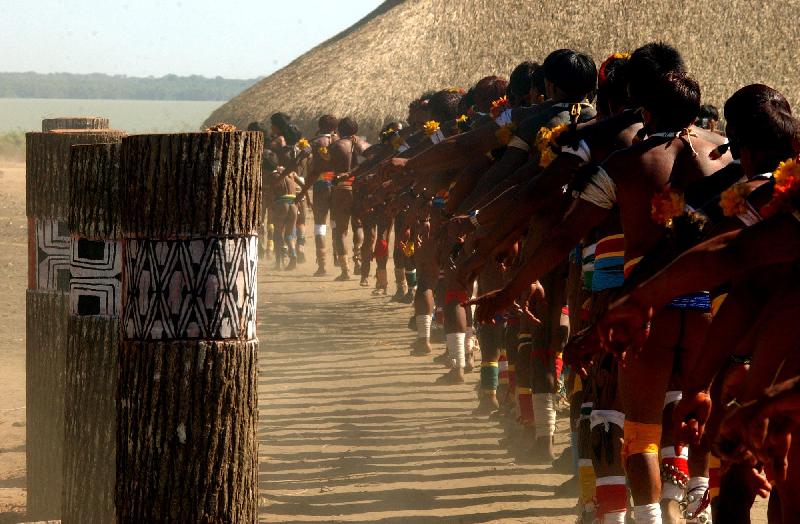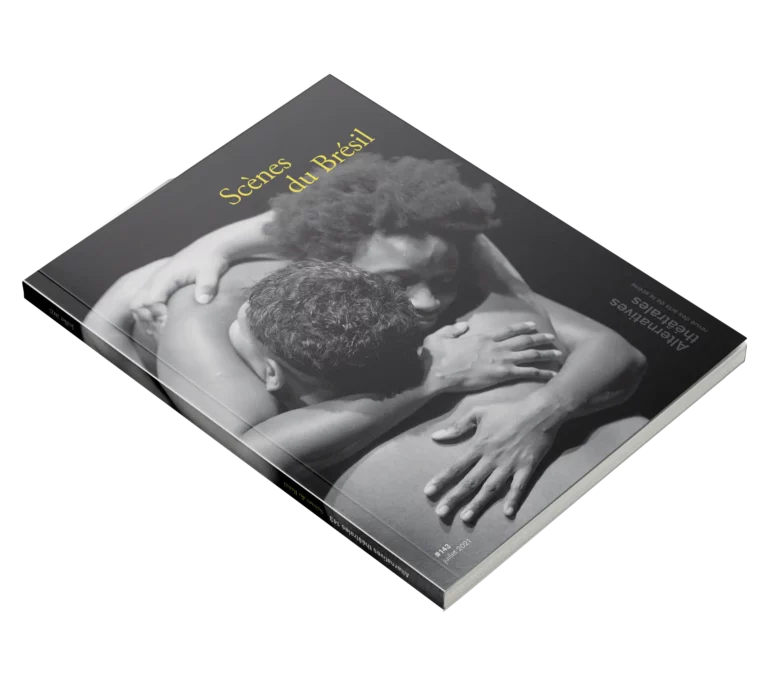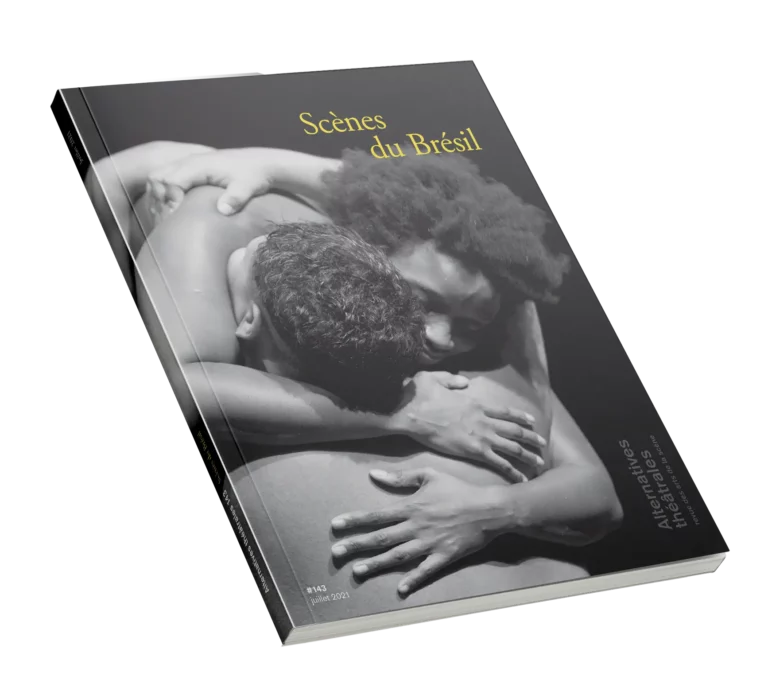Quand nous essayons de réfléchir à la socio-économie du théâtre brésilien, nous sommes confrontés à deux vérités supposément éternelles. D’un côté, nous apprenons que le théâtre et l’économie sont deux champs opposés. Selon cette perspective économique, le théâtre appartient à un secteur archaïque tandis que le secteur progressif, fondé sur les gains de productivité grâce aux technologies, représente la quintessence économique. Cette dichotomie entre un secteur économique archaïque et un autre progressif s’est cristallisée dans les études que les économistes nord-américains William Baumol et William Bowen ont menées dans les années 19601 notamment dans leur livre Performing Arts – the economic dillema. Nous comprenons le dilemme rapporté par le titre du livre comme une décision fatale : ou le théâtre disparaît, à cause de la « maladie des coûts », ou l’économie en général arrête de grandir, parce que la croissance du secteur progressif sera neutralisée par la stagnation du secteur archaïque.
La deuxième vérité à laquelle nous devons nous confronter est celle du rôle de l’État. Comme le théâtre ne survit pas tout seul dans l’économie, il a besoin de l’aide publique. L’État doit donc fonctionner comme une sorte de père du théâtre en donnant toutes les conditions et ressources nécessaires aux pratiques théâtrales. Les politiques culturelles doivent garantir les équipements, les lieux, les professionnel.le.s, les publics, etc. La maintenance et la permanence du théâtre sont, dans cette perspective, un but gouvernemental.
En juxtaposant ces deux prémisses à la réalité des pratiques théâtrales brésiliennes, nous constatons que ces vérités ne sont pas absolues. En fait, l’antagonisme entre le théâtre et l’économie, d’un côté, et la relation paternelle entre le théâtre et l’État, de l’autre, peuvent idéalement éclaircir quelques doutes. Cependant, ils peuvent aussi générer de nouvelles questions : à quelle économie nous référons nous quand nous disons que le théâtre et l’économie s’opposent ? Quel type d’État nous présupposons quand nous disons que l’État doit assurer les conditions de possibilité du théâtre ? Le théâtre et l’économie n’ont-ils vraiment rien en commun ?
Dans les prochains paragraphes, j’essaierai de donner quelques réponses à ces questions. Cet espace d’argumentation ne sera suffisant que pour esquisser seulement les chemins qui visent à échapper à la route des vérités absolues qui, fréquemment, brouillent notre vue. J’espère qu’au bout de ce texte, les stéréotypes de l’économie et de l’État seront déconstruits au profit d’une socio-économie du théâtre contemporain au Brésil.
L’économie brésilienne : styles et performances
Un fait étonnant attire le lecteur de la littérature économique brésilienne : la récurrence des catégories et des notions fondamentales propres aux discours artistiques. Selon nos spécialistes les plus reconnus, l’histoire économique sud-américaine du XXe siècle s’explique par une chaîne de styles de développement (Tavares & Serra, 1973). Pour comprendre un style, nous devons le considérer comme un système dont les variables hétérogènes interagissent les unes avec les autres : la croissance du produit intérieur ; les exportations ; les importations ; la concentration de revenus ; la formation brute de capital fixe (FBCF) ; les impôts et les dépenses gouvernementales, etc. Les relations mutuelles entre ces éléments façonnent chaque style et sa performance. Ainsi la performance économique brésilienne dépend de son style : un style moderniste démocratique pendant les années 1950 et 1960 ; un style dictatorial et miraculeux2 à marche forcée (Castro & Souza, 1985) pendant les années 1970 ; un style angoissant marqué par les drames inflationnistes (Bastos, 2001) au cours des années 1980, etc. Le rôle du PIB est crucial : les taux de croissance communiquent une performance formidable ou, au contraire, les conditions dramatiques de chaque période.