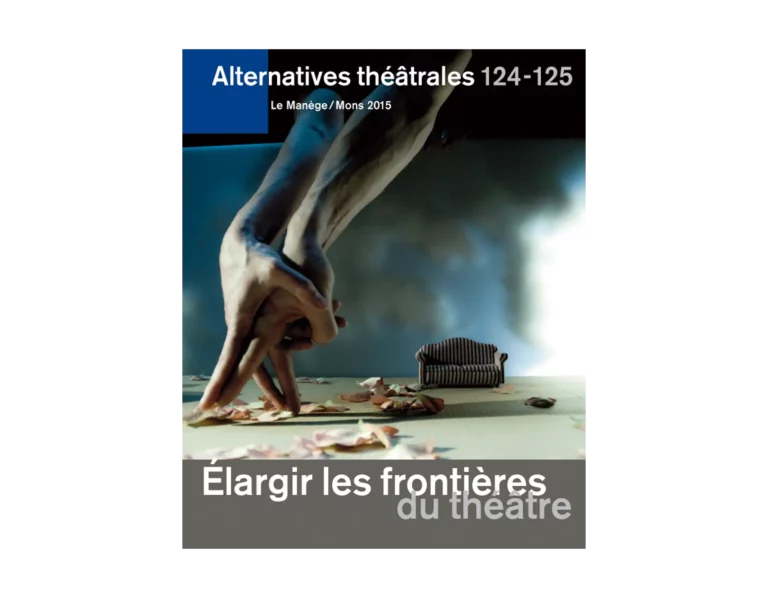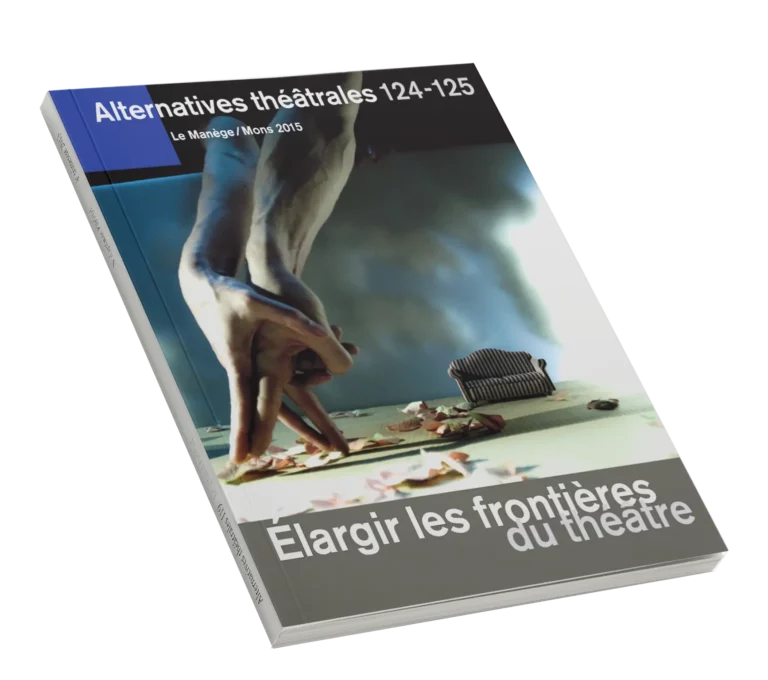C’EST AU PREMIER ÉTAGE de la galerie qui surplombait le préau de l’Athénée Royal d’Ixelles que Philippe Blasband et moi nous sommes croisés pour la première fois. Entre deux cours, accoudés à la balustrade en fer forgé, c’est probablement là que nous avons échangé nos premières paroles.
L’établissement d’inspiration néoclassique offrait un contraste étrange depuis qu’il avait été un des premiers à accueillir le système rénové. Les étudiants y circulaient en ordre dispersé, peu soucieux de son ancien prestige dont les briques ne témoignaient plus qu’un pâle écho. Le programme fait d’options, choisies par l’élève lui-même, redistribuait la composition des classes à chaque cours. Ses professeurs suivaient une pédagogie très ouverte à la pluralité de celles-ci, qui faisait qu’on passait allègrement d’un enseignement de type classique où le par cœur était de mise, à celui plus participatif — matérialisé par une disposition des bancs en forme de U — quand ce n’était pas le foutoir joyeusement post soixante-huitard qui encourageait que l’on donne son avis politique sur des films tels qu’APOCALYPSE Now tout en fumant en classe. Fin des années septante, l’Athénée Royal d’Ixelles avait acquis la réputation d’être un hôpital dans lequel était déversé tous Les malades de la scolarité. Ces maladies diverses lui conféraient un mélange culturel et social sans équivalent pour l’époque.
Je n’ai jamais été en classe avec Philippe Blasband, vu que j’étais une année au-dessus de lui, mais nous avions tous deux choisi le Français en option forte (sept heures semaines) enseigné par le même professeur ; ce qui rendait nos croisements à la balustrade du premier étage inévitable.
Ce professeur était Gaston Compère.
Gaston Compère s’était glissé sans encombre mais sans illusion non plus dans le système rénové. Il restait en marge, fidèle à son désir de transmettre à qui le voudrait son goût de la pensée construite et de la lecture. Bien au-delà des programmes, cette transmission passait par ces auteurs préférés qu’étaient Pascal et Céline et par la place essentielle qu’il accordait au style. Tous deux nous l’avons vu se présenter de manière docte et amusée sut l’estrade en bois qui servait de plateforme à son bureau. Non, ilne fallait pas rigoler:son prénom n’était pas une bizarrerie à n’accoler qu’au seul Lagaffe ; il existait d’autres Gaston, comme lui-même ou comme Gaston Bachelard…
La classe à laquelle appartenait Philippe fut assurément un des meilleurs souvenirs de sa carrière. Il y avait là une poignée d’élèves, sensible à son humour, prête à rivaliser et unie dans l’émulation. Les rédactions, à finaliser tous les quinze jours, étaient l’occasion, dans leur préparation, de commentaires, d’encouragements, dans une complicité qui les voyait parfois s’échanger leurs copies au moment de la remise — ce que Gaston Compère détricotait facilement.
Gaston Compère fut un de ces professeurs qui marque et imprime son cours de sa personnalité.
Dans le domaine qui concerne cette revue, il est à noter que Philippe Sireuil a également été son élève.
Mais c’était aussi un écrivain. Philippe m’a avoué plus d’une fois combien il avait été important, alors qu’il écrivait déjà depuis longtemps, de rencontrer quelqu’un qui exerçait le métier auquel il aspirait. Si Gaston Compère n’a pas fait œuvre chez lui de vocation, il lui a servi tout à la fois de modèle et d’objet de désacralisation. L’écrivain n’était plus un mythe ; c’était quelqu’un qu’il avait la chance de côtoyer jour après jour.
En 1981, je suis entré au Conservatoire Royal de Bruxelles en Art Dramatique pour entamer ensuite une carrière de comédien, tandis que Philippe sortait diplômé de l’Insas en section montage. Son goût du cinéma avait toujours été de pair avec celui de l’écriture et comme il n’existait alors aucun cours d’écriture proprement dit (écrire apparemment, ça ne s’apprend pas), c’est tout naturellement qu’il s’est dirigé vers la branche technique la plus langagière du cinéma. Il est très symptomatique que Philippe n’ait pas choisi la section mise en scène avec son statut d’auteur implicite, pour privilégier les aspects techniques. Peut-être était-ce en partie par prudence, la crainte de ne pas se sentir à la hauteur — ne pas aborder la prétention de manière frontale — mais sans doute aussi nourri de l’idée qu’un « artiste » est aussi un artisan manipulateur d’outils qui gagne à les connaître. C’est au cours de ces années-là que Philippe et moi nous sommes rencontrés pour de bon. Jusque-là nous n’avions été en somme que des voisins de palier. Nos activités, la reconnaissance d’un passé commun et les hasards qu’organise une même ville ont favorisé nos rencontres. Au fond, j’ignorais tout de lui. C’est par bribes que j’ai appris que son père était un informaticien (une sorte de pionnier) qui vivait en Hollande, que sa mère, elle, était une Iranienne versant d’une activité commerciale à l’autre, que tous deux s’étaient connus fort jeunes, et les avaient eus, lui et ses frères, fort jeunes, et qu’ils étaient à présent divorcés ; qu’il était laïc mais appartenait tant à la communauté culturelle juive que musulmane, que les ramifications des deux branches familiales démultipliaient encore ses origines ; qu’il était né en Iran, mais qu’il avait vécu à Boston entre ses deux et cinq ans (à ce titre, si ce n’est pas sa langue maternelle, l’anglais peut être considéré comme sa première langue), qu’il s’était retrouvé les quatre années suivantes à Waterloo avant de se rendre à Téhéran jusqu’à ses quinze ans et La chute du Shah pour débarquer enfin à Bruxelles.