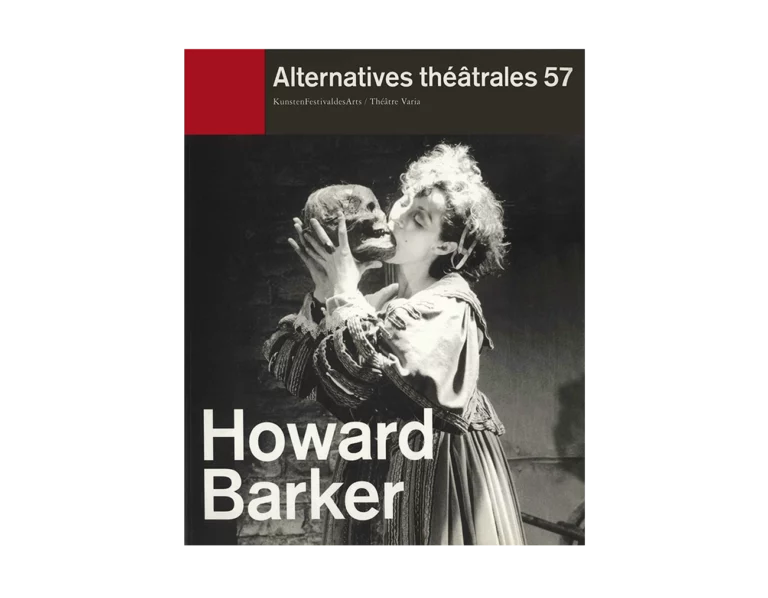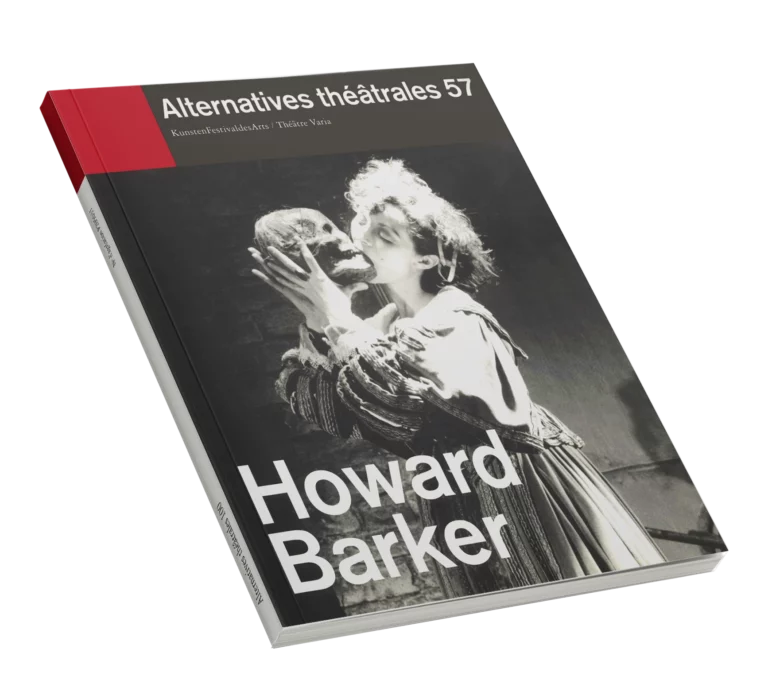« DEPUIS QUE ]‘AI RENONCÉ à l’espoir, je me sens beaucoup mieux. » La légende veut que John Osborne, créateur de la figure-modèle du « Jeune Homme en colère » dans les années 50, et mort le 24 décembre 1994, aie affiché cette phrase dans sa salle de bains pour la relire tous les matins… et garder le sourire.
Howard Barker n’est pas John Osborne, et il se défendrait certainement d’être un jeune homme en colère. Pourtant, dans la bouche d’un dramaturge qui répond laconiquement « Oui » à la question « Êtes-vous un obsédé de l’apocalypse ? », et se déclare créateur d’un « Théâtre de la Catastrophe », ou théâtre « catastrophique », amoral et irréconcilié, la phrase ne paraît pas si déplacée.
Je cite Osborne, car Barker est à sa manière, dans le paysage théâtral anglais, par ses choix et la silhouette particulière qu’il y découpe, ce que les anglais appellent un « lone wolf », un loup solitaire. A 52 ans, à mi-chemin entre Edward Bond et Gregory Morton, il se place, comme eux, en porte-à-faux et en rébellion par rapport à l’institution théâtrale de son pays, qui d’ailleurs le lui rend bien (quand sa trilogie CRIMES IN HOT COUNTRIES, DOWNCHILD, THE CASTLE fut jouée en 1985 à la Royal Shakespeare Company, dans la petite salle souterraine du Pit, Barker écrivait déjà depuis quinze ans — l’expérience n’a d’ailleurs pas été renouvelée depuis…). Même reconnu comme un écrivain de poids, il reste inclassable, un explorateur glacé et discret, toujours où on ne l’attend pas. Mais là où Edward Bond déclare arracher ses manuscrits des mains des metteurs en scène de la RSC et du National Theatre1, et préférer monter lui-même ses pièces ou les voir jouées par des amateurs et des étudiants, là où Morton parc en guerre contre l’institution le « théâtre politique » de ses aînés qui écrivent pour le National Theatre, en publiant des articles lapidaires dans The Guardian contre une dramaturgie « creuse et moralisatrice »2, articles qu’il rêve de multiplier dans une revue de théâtre « pirate » et polémique nommée Shove (signifiant en gros : « poussez vous de là », Barker, lui, a suivi un chemin plus personnel, moins médiatiquement agressif peut-être, en fondant en 1988, avec des amis comédiens et metteurs en scène, une compagnie ayant pour but de représenter exclusivement ses propres pièces, et qui (en principe) n’existera que temporairement, le temps de faire vivre les mots du poète, jusqu’à épuisement du désir. L’œuvre de Barker devient ainsi métaphoriquement une « Wrestling School », une École de Lutte, deux mots sur lesquels il faudrait revenir pour mieux comprendre l’univers de Barker (ce n’est pas un hasard si le chargé d’assassinat des Romanoff dans HATED NIGHTFALL, déchiré jusqu’au paroxysme par ses scrupules et ses doutes, est un pédagogue, un tu(t)eur, qui déclare d’emblée que tout enseignant est un assassin). Il est significatif qu’un livre publié chez Methuen en 1984 sous le titre NOUVEAUX DRAMATURGES POLITIQUES ANGLAIS3, et consacré à la nouvelle vague d’écriture et d’exploration théâtrales qui suivit la fin des années 60, se divise en quatre chapitres consacrés à Howard Brenton, David Hare, Trevor Griffiths et David Edgar… pour ne mentionner Barker qu’en passant, et avec timidité, dans une conclusion fourre-tout où ne sont cirées que deux de ses pièces. Il faut dire que les quatre dramaturges cirés sont tous plus ou moins devenus des habitués des grands plateaux des théâtres nationaux londoniens, ils ont peu à peu abandonné leurs idéaux et leurs principes d’un théâtre régional et marginal d’agit-prop pour accepter de se battre sur le territoire de l’art subventionné et correctement « de gauche ». Ils s’attaquent ainsi régulièrement à traiter de manière brillante, spirituelle, dans des pièces superbement ficelées, épiques et pointues, les grands problèmes de société : David Hare, par exemple, fut récemment, pendant un certain temps, nommé dramaturge-résident au National Theatre, pour écrire une trilogie sur l’évolution du Parti Travailliste — THE ABSENCE OF WAR -, les anomalies du système judiciaire anglais — MURMURING JUDGES — et les tensions au sein de l’Eglise Anglicane — RACING DEMON ; Brenton, au lendemain de la mise à prix de la tête de Salman Rushdie par les dirigeants religieux iraniens, composait une pièce avec Tariq Ali, intitulée LES NUITS IRANIENNES ; Griffiths écrivit une pièce sur la guerre du Golfe dans le feu même des événements ; David Edgar a triomphé en 1994 avec sa pièce Pentecost, qui, sous la forme d’une « allégorie politique », reflète la désagrégation des pays de l’Est, les événements de Sarajevo et le chaos balkanique.4
A l’écart de cette efflorescence de discours parfois propres et bien-pensants, et dans une écriture obstinée et percutante, Barker est le premier à égratigner le vernis séduisant de cette dramaturgie « engagée ». Il y a chez Hare et Edgar une intention clairement avouée d’écrire un théâtre éphémère, vinavérien au sens que, comme LES CORÉENS (dont le premier titre, significatif, est AUJOURD’HUI), IPHIGÉNIE HÔTEL ou LES HUISSIERS, il relève le défi de décrypter de si près la réalité du moment, de s’ancrer dans des dates si précises, qu’il pourrait perdre son universalité au gré des fluctuations de l’histoire.
Barker lui-même n’est pas exempt de cette tentation : sa pièce de 1983, A PASSION IN SIX DAYS, s’attachait à retracer la Conférence Nationale du Parti Travailliste de la même année. Mais déjà le titre annonçait ce qui est un des thèmes principaux de Barker : la Passion au sens religieux — démarquant ainsi d’emblée la pièce d’un rapport journalistique sur les débats de cette conférence (là où DESTINY, de David Edgar (1976), décrira minutieusement et documentairement la naissance et les réunions d’un parti anglais d’extrême droite, de la même manière qu’Alain Gautré « reproduisait » les débats d’une cellule provinciale du Front National français dans sa pièce CHEF-LIEU). l’œuvre de Barker, comme celle de Bond, comme celle de Motton, se donne pour devoir de refuser les tentations de ce que Peter Brook appelle le « Deadly Theatre », le théâtre mortel, ou mieux mortifère, le théâtre de la pièce bien ficelée, démonstratrice, intelligente. Il affirme, de manière risquée, vouloir contester le droit immémorial de l’artiste « à exhorter, à élucider, et à éduquer » : « J’ai fondé mon travail sur une résistance au naturalisme et au journalistique dans toute forme d’art. Je conçois le théâtre comme un espace privilégié, un espace non soumis aux critères répressifs de vérité et de responsabilité » affirme-t-il polémiquement dans un entretien inédit de 19935. Très significative à ce titre est cette autre déclaration, dans ses 49 APARTÉS POUR UN THÉÂTRE TRAGIQUE : « Le théâtre doit commencer à traiter son public avec sérieux. Il doit cesser de lui raconter des histoires qu’il peut comprendre. » Voilà qui suffit déjà à écarter pour toujours l’auteur des salles du West End, royaume de la comédie musicale — genre qui, pour Barker, est la manifestation même de la mort du théâtre, car il institue la bonne conscience tétralogique : « LIMPIDITÉ / SIGNIFICATION / LOGIQUE / ET COHÉRENCE », toute l’ « idéologie à bon marché » du « théâtre humaniste », qui permet au spectateur de murmurer » :
« Nous pouvons rentrer maintenant
O, siège de voiture, embrasse mon cul