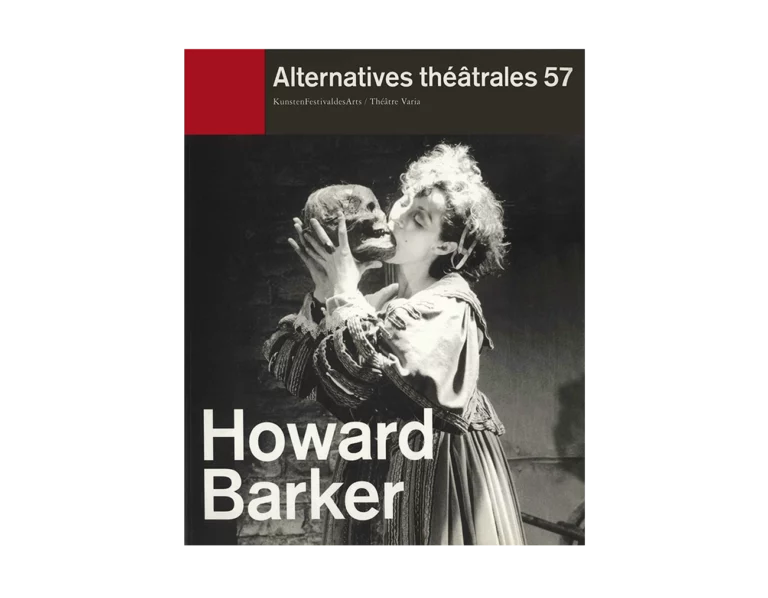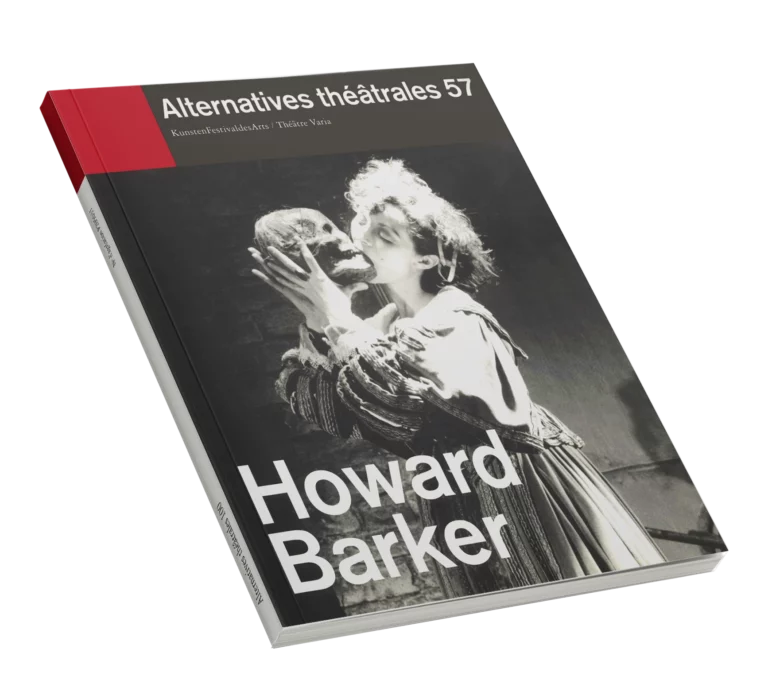Diamétralement opposés
CE N’EST PAS LA PEINE d’essayer de retracer la carrière de dramaturge d’Howard Barker en se référant aux critiques du LONDON THEATRE RECORD. Sur une période d’à peu près vingt-cinq ans, il y a eu une accumulation de malentendus qui ne permettent qu’un accès indirect aux pièces de Barker. L’histoire de Barker et de ses critiques est le récit du désenchantement de deux mondes diamétralement opposés.
Cependant, ces critiques sont révélatrices des conditions d’embauche des critiques de théâtre dans un journal londonien. Apparemment, le candidat serait convoqué à minuit dans un théâtre vide du West End, où l’attendrait le fantôme de la Tante Edna de Rattigan.
Le critique en herbe doit choisir quelques pièces de qualité qui lui tiennent à cœur. Il doit ensuite jurer de ne jamais recommander une pièce que si le scénario est clair et net, si le dénouemenc s’achève dans le dernier acte et si le message donne un sentiment d’élévation morale. Il faut également que les personnages soient bien développés, et qu’il y en ait au moins un auquel on puisse s’identifier.
Et même si la pièce doit se terminer sur une note triste, on s’attend quand même à ce qu’elle soit suffisamment divertissante pour pouvoir passer une bonne soirée. S’étant engagé à suivre ces consignes, le nouveau critique est envoyé le lendemain soir démolir une pièce de Barker.
À partir du milieu des années soixante-dix, certains critiques jugèrent pourtant Barker « prometteur ». Toute fois, la majeure partie d’entre eux l’accusèrent de ne pas prêter assez d’attention à « l’intrigue », de « s’intéresser peu à la construction théâtrale ou au développement des personnages », ou le traitèrent de « dramaturge frustrant ». Parmi les théâtres subventionnés, le Royal Court fut le premier à prendre le risque de le mettre à nouveau en scène depuis ses débuts contestés. Dans les années soixante-dix, Barker a été monté à Sloane Square, et l’English Stage Company le programma également. Quelques années plus tard, la Royal Shakespeare Company a joué trois de ses productions au Warehouse et, en 1985, celle-ci a produit CRIMES IN HOT COUNTRIES, THE CASTLE ET DOWNCHILD pendant une saison au Pit. Si la saison de l985 a prouvé l’importance du dramaturge dans le paysage théâtral, les productions de la RSC ont eu peu d’impact sur les réactions souvent hostiles des critiques. On y parle de sa « pseudo-profondeur » et de son « charabia verbal ». Le SUNDAY TELEGRAPH dit que « Monsieur Barker s’efforce d’affirmer un certain nombre de choses à la fois, mais sans en mettre aucune en lumière avec cohérence. » Et cous s’accordent à dire que Barker est un auteur « difficile », ce qui n’est pas une recomman dation pour les habitués du théâtre britannique.
Les théâtres nationaux sont hostiles à Barker. Mais celui-ci attire public et acreurs comme le prouve la création en 1988 de la Wrestling School. Cette “compagnie ne produit que les pièces de Barker ; en la personne d’Ian McDiarmid, le dramaturge a trouvé un acteur prêt à relever le défi des rôles complexes et contradictoires. La Wrestling School a monté les œuvres de Barker les plus mûres et les plus exigeantes et fut souvent accueillie à l’Almeida Theatre à Islington. La réputation élitiste de l’Almeida s’en est trouvée rehaussée mais, compte tenu de sa situation géographique excentrée, Barker est demeuré dans la marge, et les critiques réputés n’ont pas changé d’attitude à son égard. Ce qui a changé, pourtant, sans doute à cause de l’intérêt grandissant que portent le public, les acteurs et les érudits aux pièces de Barker, est une tendance de la part des critiques à le traiter avec condescendance. Ce grand excentrique de l’art dramatique anglais est-il un prophète, un poseur, un homme d’esprit ou un fou ? Ni le public ni les critiques ne sauraient s’accorder sur ce point.
Du point de vue des érudits et des historiens de théâtre, les relations forcées entre Barker et ses critiques prêtent à confusion. Elles donnent surtout une impression irréelle. Les arguments mis en avant dans les critiques ne semblent pas faire partie du discours théâtral des années quatre-vingt ou quarre-vingt-dix. Ces critiques sont l’écho des arguments moralisateurs et restreints des années cinquante. La fréquence avec laquelle Barker a été accusé d’être « obscur » et « déprimant » nous rappelle la réfutation en bloc de l’œuvre de Beckett. Mais si ce dernier ignorait les critiques, Barker les défie et proclame sa révolte contre les conventions théâtrales établies.
Son premier recueil de discours, de notes, d’essais ec de poèmes ARGUMENTS FOR A THEATRE parait en 1989.
Il est complété dans sa seconde édition de 1993 et expose la théorie théâtrale de Barker qu’il appelle « Le Théâtre de la Catastrophe ».
Un malentendu de plus
Les critiques ont supposé que Howard Barker n’était qu’un auteur politique de plus. C’est pourquoi ils persistèrent à essayer de déceler des messages dans ses pièces. Dans les années soixante-dix, en se basane sur une poignée de pièces, il paraissait adéquat de faire le rapprochement entre l’œuvre de Barker et celle de ses contemporains Howard Brenton, David Edgar ou David Hare. Ses premières pièces telles que STRIPWELL et CLAW furent perçues comme une attaque convaincue des institutions de la société qu’apparemment tous les jeunes auteurs considéraient comme pourries à la base. Ils supposèrent donc que Barker essayait d’égaler les provocations visuelles et verbales que Brenton, Hare, Griffiths, Wilson et d’autres avaient mises en scène au Portable Theatre dans la production très controversée de Lay By en 1971. De plus, le style de présentation satirique que Barker partageait au début avec ses contemporains fut considéré comme preuve de son appartenance à un groupe.
Rétrospectivement, il est pourtant plus facile de reconnaître que ces premières pièces n’expriment pas du tout la croyance absolue qu’un socialisme rénové est la réponse ulcime à toutes les doléances de la Grande Bretagne et du monde entier. Même à ses débuts, Barker n’a jamais feint d’espérer une Nouvelle Jérusalem qui influençait alors WEAPONS OF HAPPINESS de Brenton ou bien encore la FANSHEN de David Hare. Des protagonistes tels que Noe ! Biledew dans CLAW, dont les revendications pour des valeurs humanitaires n’empêchent pas son exécution brutale, avaient tendance à anticiper la perspicacité désillusionnée du discours de Hare à Cambridge en 1978. Dans son discours, David Hare a fini par avouer que « quelques déclarations de pacotille de la Gauche », prononcées au théâtre devant un public de sympathisants marginaux ne suffisaient pas à « régler le malaise profond de réaction de l’Angleterre moderne ».
Barker n’a pas non plus accepté l’hypothèse de
« messages d’abord » soutenue dans les années soixante dix par Brenton et d’autres dramaturges tels que David Edgar. Ses plus récentes pièces se sont plutôt distancées de ce qui est purement politique. La ténacité avec laquelle Barker refuse d’utiliser la scène pour faire passer des messages et des sermons est peut-être mise en lumière de la meilleure façon par la comparaison de son adaptation du mythe troyen avec celle d’Edward Bond.
La version de Bond, THE WOMAN, fut produite par le National Theatre en 1978. Même si certaines images visuelles ou verbales, telles que le meurtre brutal d’Ascyanax ou la description glaciale de la mort d’Hécube, se retrouvent dans la version de Barker, l’argumentation politique évidente de THE WOMAN souligne bien la différence entre les deux pièces. Bond se sert du mythe troyen pour illustrer un concept progressiste qu’il comprend comme étant le chemin inévitable vers un socialisme rationnel. Dans THE WOMAN, la société féodale de Troie doit succomber aux pouvoirs du capitalisme tel qu’il est représenté par Achènes. Mais, pour Bond, il ne faut pas permecrre à la nouvelle Athènes, qui se nourrit de l’esclavage et du colonialisme, d’incarner le bue ultime de l’histoire. Donc, sur une île utopique, le capitalisme de la Nouvelle Achènes finie par se faire renverser par les efforts du peuple et les portes s’ouvrent vers un meilleur avenir. Le langage populaire univoque de Bond élimine toute possibilité d’interprétation des images quelquefois complexes et ambiguës de THE WOMAN. Face au dévoilement de l’Histoire, le public est supposé être d’accord. Une dizaine d’années après THE WOMAN, la RSC a présenté la pièce troyenne de Barker, THE BITE OF THE NIGHT, avec comme sous-titre « An Education ». Dès le prologue, l’auteur réfute toute prétention à la « Clarté, la Signification, la Logique et la Consistance ». Ce qui suivit dans le Pit fut une découverte des différentes couches de Troie dans lesquelles se confondaient passé et “présent. Les Troie de Barker ne proviennent pas de fouilles mais de son imaginaire : les personnages historiques et mythiques rencontrés en chemin se mêlent sans cohérence. Hélène non plus n’est pas un personnage cohérent : elle est littéralement démembrée, cout comme Je mythe qu’elle incarne tel qu’il fut énoncé par Homère ou Schliemann. Ainsi, même les concepts de croissance et de continuité dans l’Histoire se trouvent brisés. Toutefois, il ne faut pas automatiquement considérer le démembrement comme LB principe dominant de la structure de THE BITE OF THE NIGHT. Ruby Cohen trouve la pièce « trop dense pour être comprise à la première représentation ou lecture ». Selon elle, les questions soulevées par Barker sont : (…) l’impossibilité de réconciliation d’une passion individuelle ( … )et d’une responsabilité publique (…), l’inaptitude de l’amour de mener vers une harmonie publique (…), la séduction de la passion, la trivialité de la comédie et du rire, le témoignage impuissant de poètes qui fuient l’action.
Tandis que la réitération assurée des pouvoirs réparateurs de la rationalité et du socialisme dans THE WOMAN ne permet qu’une seule lecture, l’évidence multiplicité de thèmes et de questions de THE BITE OF THE NIGHT en permet plusieurs. Tant que la compréhension de l’arc est liée à des concepts de forme, l’aboutissement de la déconstruction ou absence de formes établies est censé être plus qu’un manque de bue ou de forme. Il faut quand même se rappeler que lorsque Beckett a démantelé la structure d’une pièce bien faite avec WAITING FOR GODOT, ENDGAME et HAPPY DAYS, les critiques, lents à s’adapter à sa poétique réductive, l’ont accusé lui-aussi d’un manque de forme et de but. Dans le cas de Barker, ARGUMENTS FOR A THEATRE prouve que son défi à l’encontre de la tradition dramatique est plus qu’une attaque lancée au hasard.
Le « Théâtre de la Catastrophe »
ARGUMENTS FOR A THEATRE définit les rapports qu’entretient Barker avec les notions de destruction, de catharsis et de renouveau. Son « Théâtre de la Catastrophe » s’adresse à ceux qui souffrent d’une « imagination handicapée », qui ressentent « un désir inarticulé de spéculation morale ». Un désir que ne saurait assouvir ni la « télévision kitsch », ni les comédies musicales, ni Je « théâtre humaniste » qui traite son public comme un chien en laisse : « Il me semble qu’il y a une tristesse profonde dans les relations entre le Réconciliateur — le dramaturge — et ceux qui recherchent l’harmonie — le public — dans le théâtre humaniste( …).»
La réponse de Barker à ce qu’il croit être le véritable « devoir du théâtre » est à la fois exigeante et élitiste. Déjà dans les années soixante-dix, il disait que le théâtre devai être : « le carter qui permet de vidanger cous nos poisons et malices, notre désespoir et notre terreur. Ce n’est pas un lieu de réconciliation ou de soulagement. Ce n’est ni un lieu sombre, qui vibre au son des rires ni un endroit privé cossu où les mains se touchent. C’est un creuset en granite dans lequel le conflit et la collision provoquent des étincelles dangereuses et déconcertantes. »
Néanmoins, il n’est pas assez naïf pour nourrir l’espoir d’autrefois d’Arnold Wesker qu’un jour les ouvriers emmèneraient des pièces de théâtre dans leurs paniers repas. Mais, il insiste sur le fait qu’il est possible d’éduquer le public, qui a besoin d’une spéculation morale pour que ses attentes soient plus que le réconfort d’une soirée au théâtre. Il croit que le public est prêt à considérer le théâtre comme un défi, comparable aux exigences du travail et qu’il veut bien souffrir des douleurs plus sévères encore que celles normalement infligées aux spectateurs par la tragédie. En d’autres termes, Barker ne tient pas seulement à « émouvoir » son public : « Le théâtre vous sépare. Il sépare le public de ses croyances. Il sépare le social de l’individu. Il sépare l’individu de lui-même. À la sortie, le public a du mal à recoudre les morceaux de la vie. » Ce défi adressé au public se réalise à travers la tragédie, dont Barker retient une expérience destructrice et déracinante. Néanmoins, il prive son public de la certitude d’un renouveau obtenu par la catharsis. Le théâtre de Barker, et là ses critiques seraient cous d’accord avec lui, « ne résout rien — au contraire ».
La tragédie vise un public qui se sert de son imagination pour la spéculation morale. L’essentiel de la production doit devenir un poème et, comme un poème, elle ne peut se réduire à une série d’exposés sous d’autres formes. La prétention de Barker à une complexité poétique s’explique dans une richesse de métaphores, d’allégories, de paraboles et de fables. Même ses critiques les plus sévères ont reconnu sa maîtrise de la poésie. Mais peu importe la forme de l’expérience poétique rendue par Barker, elle n’est jamais dissociée de la douleur. L’exercice de l’imagination pour cause de spéculation morale est supposé être douloureux et tout acte de reconnaissance gravé de douleur. De ce point de vue-là le « Théâtre de la Catastrophe » de Barker est vraiment unique, bien qu’il ne peut guère prétendre être la seule manière d’éveiller l’imagination du public.
Une Bouffée d’Air Frais pour le Public
Néanmoins, la rigueur avec laquelle Barker sépare l’expérience théâtrale de l’expérience banale différencie ses pièces des œuvres de ses contemporains. Les exigences de son « Théâtre de la Catastrophe » vis-à-vis du public expliquent son penchant pour des expressions de change ment et de bouleversement violences. Le contexte de VICTORY est le changement historique et la Restauration de Charles II. Dans THE POWER OF THE DOG, vers la fin de la guerre, Churchill et Staline redessinent la carte d’Europe, tandis que THE CASTIE et THE EUROPEANS évoquent les perturbations culturelles engendrées par les croisades et le siège de Vienne par les Turcs.
Dans les pièces de Barker, l’Histoire est libre de toute prétention à l’authenticité. Toutefois, il renonce explicitement à route « responsabilité pour les convenances historiques ou politiques ». L’historicité spécifique de ses contextes de guerre et de révolution n’est étudiée que pour rehausser la crise des valeurs, des idées et des idéologies, ainsi que l’effondrement et le déracinement de l’individu qui s’en suit. Dans les pièces de Barker, l’Hisroire ne vainc jamais le chaos ni les contradictions qui lui sont propres et, de ce fait, l’Histoire est toujours le contemporain. Il est difficile de dire avec certitude si le public « a du mal à recoudre les morceaux de sa vie » après une représentation d’une pièce de Barker, mais, il aura au moins fait face à des protagonistes aussi déchirés et contradicroires que le monde où ils habitent. Tout comme Bradshaw dans VICTORY, qui dans la quête des restes du corps de son mari est exposée à la souffrance et l’humiliation, aucun de ces protagonistes ne doit éveiller de la compassion. Et leurs rires amers résonnent dans un vide moral.
Le fait de refuser la compassion et d’imposer la contradiction psychologique et idéologique à travers de continuelles confusions de caractère permet au spectateur de s’interroger, il découvre que « le nouveau théâtre est une nécessité pour sa survie morale et émotionnelle ».
Dans WOMEN BEWARE WOMEN que Barker réécrit d’après Middleton, les personnages, au lieu de subir le sort auquel ils se prédestinaient, font un appremissage douloureux donc la récompense est la survie. Sordide est le seul qui meurt et Barker le justifie dans un dialogue imaginaire avec Middleton, en déclarant : « J’insiste toujours pour que les personnages puissent être sauvés. » Barker réécrit ÜNCLE VANJA contre Tchékhov qui se livre à une « célébration mélancolique de la paralysie et de la vacuité spirituelle » qui fait du théâtre « un art de consolation, une oraison funèbre pour une vie non vécue ». Selon Barker, ONCLE VANJA n’est pas seulement l’apothéose d’une société statique donc condamnée, mais aussi l’incarnation de la paralysie actuelle du théâtre. Sa version (UNCLE) VANYA, transfert la paralysie des protagonistes de Tchekhov à leur créateur Lorsque le Tchekhov résigné de Barker se meurt sur scène, un Vanya de plus en plus fort le reconforte. Dans un acte de reconnaissance, le Vanya de Barker déclare, « Je connais la peur de Tchekhov ! Je connais sa peur épouvantable ! ». Pour lui, reconnaître que la peur et la douleur ne sont pas des expériences solitaires mais partagées, a un effet libératoire. Autrement dit, dans le nouveau théâtre de Barker, le protagoniste tragi-comique de Tchekhov ! connaît une libération douloureuse et salvatrice. Il n’est plus entravé par un plaisir de sybarite.
Traduction : Mike Sens.