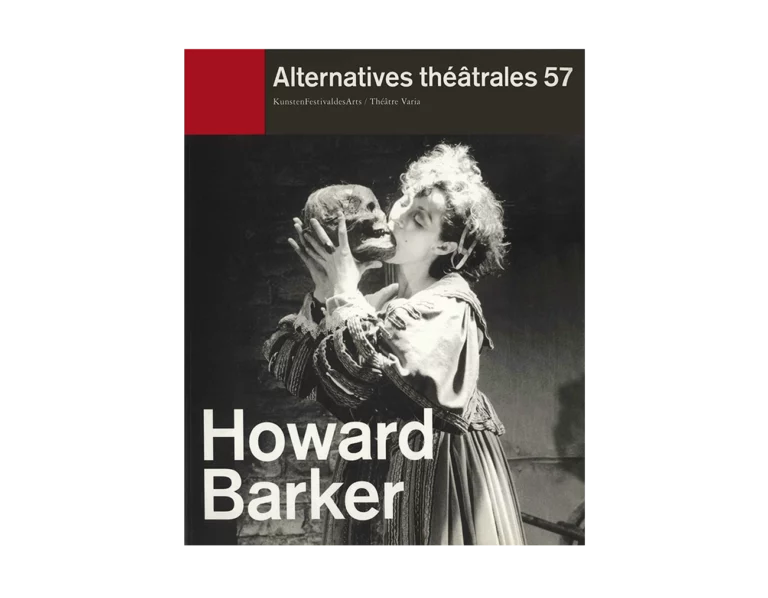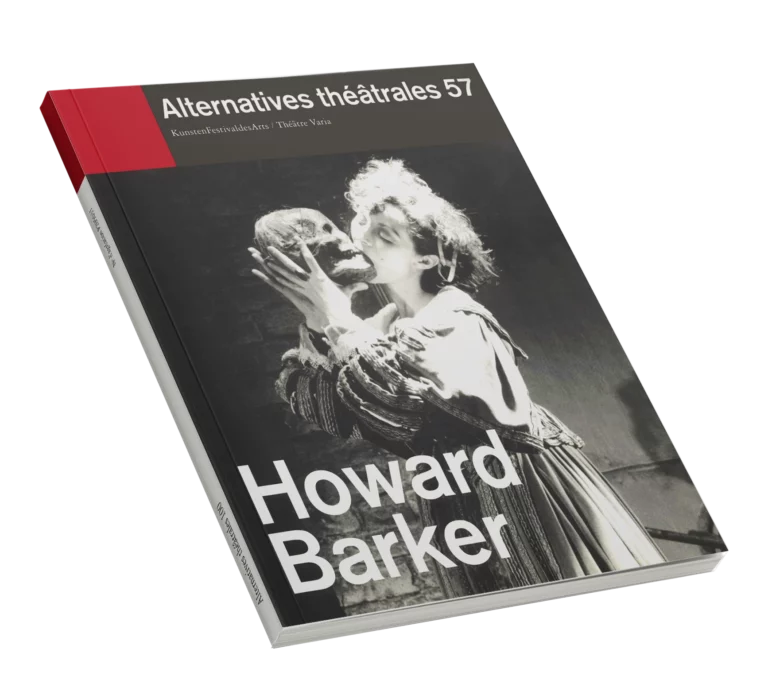Los muertos abren los ojos a los que viven.
(Hugh MacDiarmid, PERFECT)
HÉÂTRE DE LA CATASTROPHE, tragédie, ou encore Trauerspiel ( théâtre de la tristesse)? Le théâtre de Baker défie en quelque sorte les définitions.
La couleur théorique de son texte présenté ici « La tragédie — une forme d’art pour ceux qui aiment la vie » est fortement nietzschéenne. Dans son théâtre, cette couleur nous saute aux yeux. Et des yeux, justement, il en sera beaucoup question. L’extase dionysiaque, le principe d’individuation à l’origine de tout mal, le je, l’un originaire, la nécessité esthétique apollinienne, le choeur satyrique, cause originelle de la tragédie, la connaissance tragique, le triomphe de la beauté à travers la souffrance, la blessure de l’existence, la volonté comme extase suprême et douleur suprême, la terreur de l’existence transfigurée dans la souveraineté magique et enfin la volupté d’anéantir. Nous retrouverons ces traits dans un état d’instabilité créatrice chez Barker.
Mais ici, je me contenterai de parler du Choeur auquel il donne une dimension nouvelle, plastique et spatiale, du silence, du crime, de l’obscurité qui voile sa scène tragique.
Des formes émergent lentement de cette obscurité, des ténèbres de l’inconscient, lorsque nous fermons les yeux pour dormir, ou lorsque nous nous bandons les yeux pour jouer, c’est-à-dire lorsque nous prenons congé de la lumière de surveillance dictée par la conscience.
Ainsi, l’espace noir se charge de sa propre signification, s’étend et se rétrécit, prenant l’allure d’une découverte époustouflante. Ces formes nous parlent une langue nouvelle, faite de notre propre silence.
Dans un tableau récent de Howard Barker, l’espace noir se forme en dimensions infinies, verticales et horizontales, comme le noir d’une nuit tragique où les spectres, les non-morts, apparaissent. À l’arrière plan, une femme est debout, dans une proximité étrange avec des chiens qui l’assaillent. Au premier plan, un homme immobile tend la main vers la gueule dévoreuse (à l’allure de tombeau ouvert) d’un molosse, comme pour le consoler. Un abîme sépare les deux personnages.
Dans cette hiérarchie spatiale, c’est l’homme qui ordonne la scène, puisque les chiens sont à son service, des chiens qui sont l’extension de son propre fantasme et dont la sale besogne est d’arracher l’utérus de la femme, inlassablement, éternellement. Un crime rituel, dans un espace nocturne de sommeil, parlant la langue silencieuse d’un choeur satyrique. Une scène ordonnée symboliquement (en dépit de sa bestialité phallique) selon un principe féminin : « Pour l’État la femme est la nuit : et plus exactement le sommeil : l’homme est la veille. »1
Cette renaissance de la chair inlassablement profanée, l’odeur de l’extase d’une vengeance symétrique à la plénitude de désir, sont autant d’éclairs obscurs qui m’illuminent lorsque j’aborde, les yeux ouverts cette fois-ci, quelques pièces d’Howard Barker.
JUDITH. A PARTING FROM THE BODY, se déroule dans le temps d’une seule nuit, à la veille de l’assaut définitif contre le peuple d’Israël. La « scène parlante » est dedans, dans une tente (dans l’obscurité d’une lampe, j’imagine).
La « scène silencieuse » est en dehors, dans le noir, à la belle étoile, et c’est ce dehors qui encadre le dedans, le contient, le fait progresser, l’ordonne. Et pousse la tragédie à s’accomplir. Dehors, c’est un massacre qui sommeille encore en attendant la levée du jour. Cet espace nocturne avec ses personnages anonymes, muets, est choréique. Ce choeur se fait entendre par une seule voix ponctuelle et rythmique, celle de THE CRY OF THE SENTRY (L’appel de la sentinelle). Le terrain vague où campent les soldats fait pression contre les parois de la tente. L’appel au meurtre de ce dehors s’incarne dans le personnage de la servante, et lorsque la pression atteint son apogée (pour ne pas dire orgasme, puisque ce terme ferait outrage à l’agonie de désir chère à Barker), le crime s’accomplit.
Dans HATED NIGHT FALL, le choeur des pénombres, des ténèbres se présente comme une armée commandée par Dancer. Elle se situe dans l’espace du dedans, elle hante les murs et le sol (selon la mise en scène de cette même pièce par Barker). Cette armée en choeur est, comme toute armée, le foyer même du parjure et de la trahison. Elle-même confectionne, dans l’absence, le tragique. Dans LES EUROPÉENS, cette armée n’est pas située dans la simultanéité temporelle du déroulement des scènes, elle a déjà fait son devoir. Le choeur absent (et combien présent) de cet élément structurel est l’armée turque, représentée à l’état de ruine au début de la pièce par des prisonniers de guerre. La même armée revient à la fin, et là encore pour une seule fois « The cry of the Sentries is heard ». (L’appel des sentinelles résonne).
Ce Choeur d’hommes armés qui rode en dehors revient combler sa propre absence pour récupérer son dû : l’enfant du viol, du crime. Dans JUDITH et LES EUROPÉENS, nous ne voyons donc jamais cette armée, elle est dans l’espace du noir, dans cet abîme étendu qui sépare les personnages comme dans le tableau. Pourtant c’est elle qui force et rythme et le déploiement des scènes, c’est le cadre où s’accomplit encore le tragique.
Le choeur satyrique qui peuple le vide du dehors non seulement hante la scène, mais surtout presse le pas du tragique. Une originalité inouïe de ce théâtre catastrophique. Puisque nous sommes dans le couple absence-présence voyons ce qui est à l’oeuvre devant nos yeux. Barker, en effet, se sert dans les trois pièces d’une grammaire inédite du verbe « voir ». Qui dit voir dit aussi ne pas voir, qui dit présence à l’ oeil, dit absence à l’ oeil, qui dit lumière dit obscurité, qui dit jour dit aussi nuit, et ainsi de suite.
Dans HATED NIGHT FALL, le choeur apparaît comme interlocuteur servile, alors qu’il est comme un souverain déterminant dans la chute de Dancer. Et quelle serait sa chute, dans cette tombée de la nuit ? La cécité … Et le crime, dans une pièce parsemée de meurtres (mais qui n’atteignent jamais le statut de crime), c’est le crime perpétué contre les yeux de Dancer par l’envoyé spécial des ténèbres, c’est-à-dire le choeur. Dans JUDITH, le crime (la volupté d’anéantir) est également ordonné par le dehors, un crime effectué dans l’extase du désir, dans l’instant furtif d’une abdication du corps offerte comme une prière à l’autre. Holopherne offre sa chair, sa tête.
Les yeux seront bientôt grands ouverts et écarquillés dans une tête coupée, alors qu’il prétendait dormir.
Dans la bible l’ultime crime d’une femme contre un homme, c’est de lui arracher la tête, fixer son regard à jamais sur l’espace du monde en plein jour, sur la scène où le choeur est dehors. C’est de l’arracher à son sommeil.