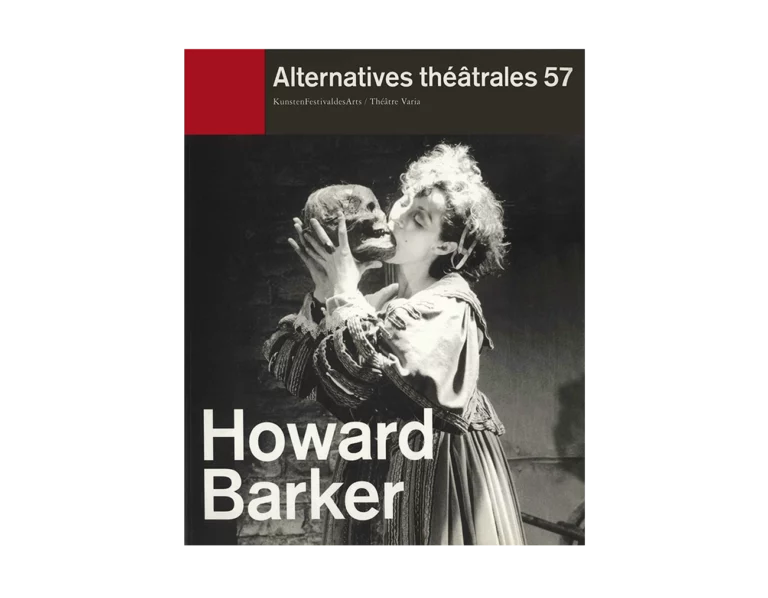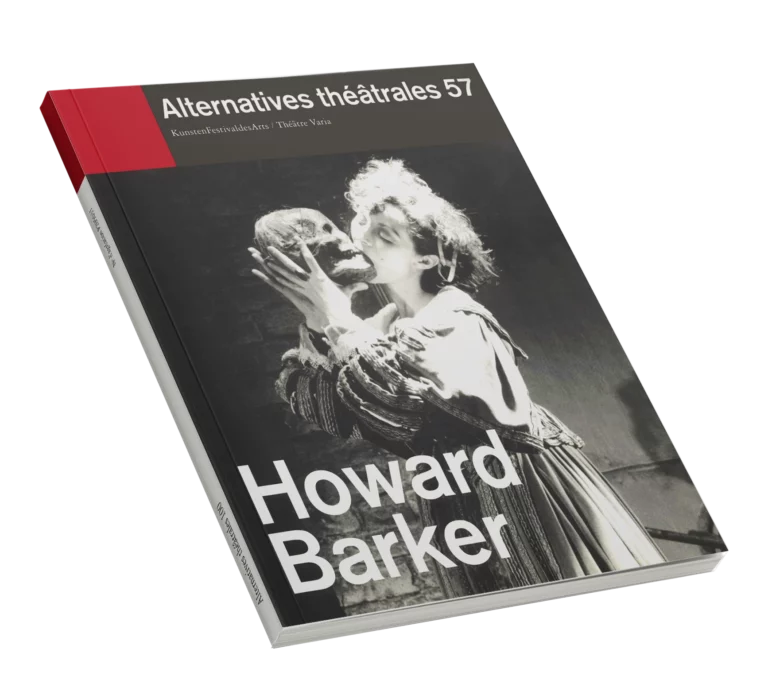SARAH HIRSCHMULLER : Comment avez-vous rencontré le théâtre de Howard Barker ?
Jerzy Klesyk : Une de mes amies, après avoir vu un de mes spectacles, m’a vivement conseillé de m’intéresser à Barker. J’ai commencé à le lire, en anglais d’abord, puis j’ai recherché les traductions existantes. LES SEPT LEAR fut une rencontre extraordinaire.J’ai aussitôt organisé une lecture de la pièce avec des amis : j’étais profondément séduit par la magie du texte, par la puissance du langage surcout. J’ai senti dès la première approche que j’avais affaire à un véritable écrivain dramatique. Trop souvent le théâtre esc considéré comme le porte parole d’autre chose que lui-même : des discours s’y tiennent qui pourraient tout aussi bien être ceous ailleurs, au mépris de coute théâtralité. C’est ce caractère extrêmement direct de la parole qui m’a séduit, celui-là même qui existe chez Shakespeare. Ce n’est pas un théâtre qui vise à exposer quoique ce soie, une philosophie, une esthétique…
S. H.: Est-ce un reproche que vous feriez à un certain théâtre contemporain ?
J. K.: Oui. Pour le dire très simplement, la plupart des textes que je lis me tombent des mains au bout de deux pages : l’auteur y exprime ceci ou cela ; mais je n’y trouve pas ce que je cherche : non pas des mots, mais des événements réels qui appellent les mots. Avec LES SEPT LEAR, je me suis trouvé devant un matériau extrêmement théâtral, une grande qualité d’écriture et un sens de l’humour inouï : un matériau immédiatement porteur pour un meneu en scène comme pour des comédiens, et qui surcout interdit toute simplification, toute réduction, en fait coute démarche illustrative. Je vais peut être trop loin : aucun texte ne peut véritablement interdire que l’on fasse usage de lui, ou qu’on le réduise à une série de signes ; mais le texte de Barker a une celle puissance, une telle autonomie théâtrale, qu’il invite son metteur en scène à suivre un chemin qu’il n’a encore jamais emprunté, à évoluer dans un paysage qui n’est pour lui ni connu ni reconnaissable.
S. H.: Comment l’acteur encre-t-il dans ce texte ? Comment assumer ces variations de tonalité, de positions émotives, de rôles, au sein de chaque personnage ? Comment accéder à ces personnages qui sont à la fois fortement individués et divisés par la contradiction ?
J. K.: C’est un texte qui exige des qualités très diverses, er ce, à cous les niveaux. C’est pourquoi j’ai d’abord proposé à mes comédiens des exercices à partir de ce que je croyais percevoir du texte, mais sans expliquer quoi que ce soit au comédien, sans caractériser le personnage, en évitant notamment d’utiliser des qualificatifs. Je pars en général, autant que je le peux, de la situation. Si la situation est très ambiguë, j’essaie de la cerner, de la décrire sous différents angles, en laissant au comédien le soin de répondre à mes propositions. Or aucune situation n’est réductible à un schéma simple chez Barker. Mais petit à petit, par un travail d’approche analogique, rythmique, on parvient à saisir les ressorts de sa complexité, er c’est cette complexité-là qu’il faut restituer, qu’il faut jouer. Bien sûr, à terme, il faut choisir. Il faut bien que le personnage entre par ici ou par là, s’agenouille ici ou là … Mais c’esr le résultat d’un travail très artisanal et très inruitif. Outre les exercices, il y a bien sûr la lecture de la pièce, la façon que nous avons de nous en raconter l’histoire, de bien la raconter, en préservant sa complexité, son incohérence peut-être …
S. H.: N’est-ce pas, plutôt que son incohérence, son absence de « solution » sur le plan de la signification qui laisse perplexe.
J. K.: C’est cela. Une absence de solution qui gagne jusqu’aux détails du texte, relies certaines phrases qui aujourd’hui encore me parlent sans que je sois parvenu à les épuiser.
S. H.: Par exemple ces phrases interrompues que prononce Holopherne juste avant de mourir :
« Tu as menti, bien sûr, et moi aussi j’ai menti ( … )
Mais dans le mensonge nous. À travers le mensonge nous.
J. K.: … Sous le mensonge nous. »
Dans ce type de phrases, par exemple, il nous a fallu faire le choix d’assumer le texte tel qu’il était, c’est-à-dire de rendre concrètement cette interruption brutale, ce point. Nous aurions très bien pu choisir de dire cela dans une suspension qui aurait laissé supposer un sens caché mais facilement décelable. Mais non, l’interruption et le point portent un sens. La phrase telle quelle est le sens. C’est une chose qui est acquise dans le roman depuis longtemps, avec le monologue intérieur, par exemple. On n’assume pas encore parfaitement cette mise en défaut de la cohérence du discours, ou du moins de sa complétude, au théâtre. Mais en même temps, tout ce que je viens de dire n’est en rien une apologie du désordre, du chaos, de quoique ce soit de tel. Il faut une grande rigueur, un minutieux travail de précision, pour présenter de l’incomplétude sur une scène. Rien de tout cela n’est laissé au hasard, même si l’interprétation reste ambiguë.
S. H.: Sur cette question de l’ambiguïté, que pensez-vous de l’obstination avec laquelle Barker défend son droit à ne pas produire de sens achevé ? Ce n’est pas un théâtre de l’Absurde, ce n’est pas non plus un théâtre à la Beckett. Ainsi, dans JUDITH, la possibilité du sens, la piste du sens est fortement soulignée, mais chaque fois déçue. Un réseau de sens se dessine qui nous fait croire que l’on va dans telle direction, mais l’on ira dans une autre.