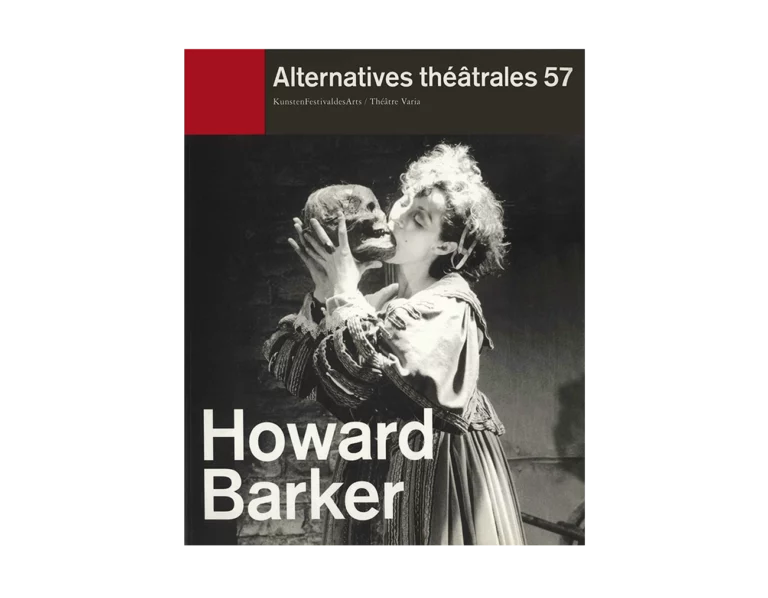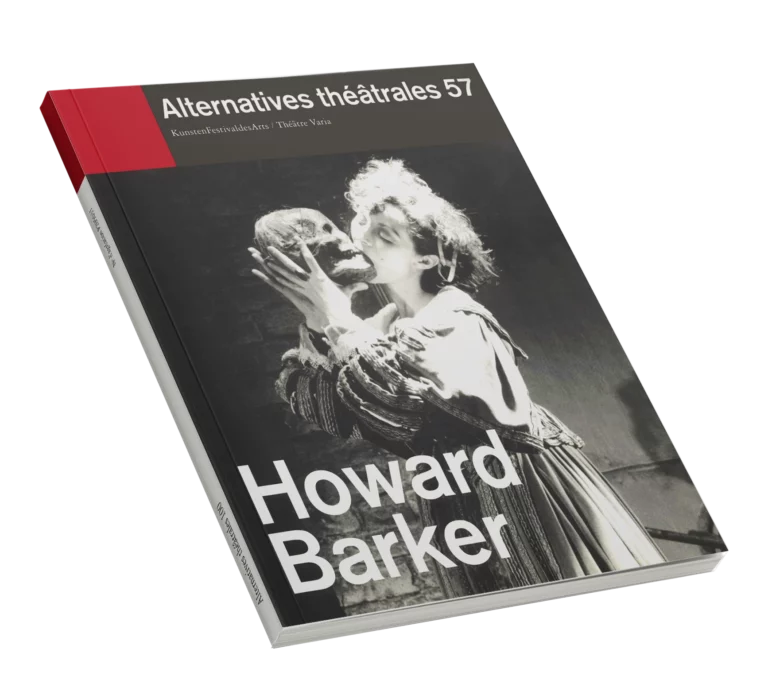DANS CE GRAND AMPHITHÉÂTRE de la Sorbonne où nous ne sommes loin ni du Pont Neuf où se dressaient les tréteaux des théâtres de foire, ni de l’Opéra Comique où les Italiens, comme on les appelait alors, attiraient le tout Paris, aucun de ces acteurs n’aurait pu penser avoir accès. Aujourd’hui, bien tristement, grâce à Giorgio Strehler, cet interdir est levé. Car que fut-il sinon « un italien à Paris » ? Son théâtre dans cet entre-deux s’est accompli, va-et-vient qui l’a conduit de Jouvet au Piccolo et de Goldoni à l’Odéon. Il avait fini par constituer une « italianité française » comme disait Bernard Dore, son ami, dont les premiers textes parus dans la célèbre revue Théâtre populaire ont largement ceuvré à la réputation du Piccolo. Aujourd’hui nous devons aussi lui rendre hommage ! Mais cous deux sont absents. Et seul survit le souvenir de leur passion pour le théâtre comme « générateur de socialité », leur combat pour un théâtre solidaire, et jamais solitaire. Le credo strehlerien voulait que « le théâtre soit une manière de l’homme d’être avec l’homme ».
« Seuls les poètes one une vocation » disait-il. Il a fondé son ceuvre sur cette conviction, malgré le regret de ne pas avoir trouvé son poète à lui. Strehler qui affirmait son impuissance à se livrer à la première personne a fait du texte l’occasion d’une lecture critique et d’un aveu dissimulé. Il défendait la « compréhension sensible » de l’essai qui renvoie à la France de Montaigne et érige l’œuvre montée en filtre de la subjectivité. Mais sa voie se précisa aussi grâce à l’Allemagne d’où venait Brecht dont la rencontre le transforma et lui permit de proposer des chefs-d’œuvres scéniques où s’est accomplie la synthèse exemplaire encre le projet brechtien et l’énergie strehlérienne. Il se place au cœur de ce triangle de la mise en scène gui se dessina dans les années 50 encre Paris, Berlin et Milan.
Strehler a trouvé dans le monde du XVIIIe son territoire électif où distance et proximité se réconcilient. Les personnages de Goldoni, qu’il suc exalter plus que nul autre, émergent dans l’interstice entre hier et aujourd’hui, interstice habité par la conscience du temps. Le maître des éclairages qu’il était, fut le premier à introduire l’expérience des saisons qui se succèdent et du jour qui décline jusqu’à l’obscurité donc souvent la rampe est entourée. Elle aspire constamment des personnages épanouis d’abord dans les lumières chaudes du plateau, foyer d’une existence agitée et d’un plaisir de jeu extrême. Au public d’aujourd’hui ces personnages permettent la reconnaissance, mais colorée par la mélancolie d’une éloignement léger… l’écart temporel ne rend pas étrangers les hommes et les femmes qui s’agitent à Chioggia ou sur un campiello vénitien. Ils sont nos proches. Strehler nous a appris à les aimer, malgré leurs égarements passagers. La scène strehlérienne, en effet, n’a jamais fait de nous des juges, mais toujours des témoins. Témoins séduits par l’humanité que le metteur en scène de génie parvient à engendrer. « Je fais du théâtre parce que l’on y fait de l’humain chaque soir » aimait-il répéter.
Strehler n’a jamais douté de la scène qu’il a su ériger mieux que quiconque en carrefour de la culrnre et du quotidien. Ici seulement les comédiens parvenus au sommer de leur dévotion au spectacle passent avec fougue de la gestuelle des pêcheurs aux citations de Chardin, et de l’acharnement des disputes au raffinement de Guardi. Il fut le valet du monde et du théâtre, ses deux maîtres.
Avec Tchekov et Shakespeare, Strehler commença le grand cycle des adieux. Adieu à l’enfance embaumée dans la chambre remplie de jouets que Lioubov et Gaev quittent à jamais, adieu au pouvoir donc Lear se défait pour se retrouver pur devant la mort, enfin adieu à l’illusion que Prospéro abandonne en libérant Ariel et en brisant à jamais sa baguette magique. Le metteur en scène, devenait son alter ego, prêt à quitter lui aussi son art dont il avait épuisé les secrets. Strehler mettait en scène la fin, fin somptueuse des maîtres et des artistes. Son théâtre devenait testamentaire.
Exaspéré par les attaques des politiques, Strehler envisageait, en début d’année, d’ouvrir le nouveau Piccolo avec Mozart, le seul à même, m’a-t-il dit, de le blanchir des caches gui l’avaient tant sali. « Mozart, au secours ! » cria presque le maître dont l’appel ne fur qu’à moitié entendu … il ne parvînt pas à achever COSI FAN TUTTE.
« Mozart, de quoi mourut-il ? se demandait Strehler. « De musique ?» Et lui, de quoi mourut-il ? « De théâtre ».
Strehler a voulu faire de Mozart l’occasion d’une renaissance, mais lorsqu’il s’est agi de célébrer la mémoire du Piccolo qu’il fonda, avec Paolo Grassi, voici cinquante ans, il se fia à son ancien amour pour Arlequin. Il le ressuscita, de nouveau, pour faire l’éloge du théâtre et de ses exploits, mais cette fois-ci par une sorte d’étrange pressentiment, Arlequin évanoui ne réapparaît pas comme jadis en deus ex machina et ne se profile pas non plus en ombre chinoise … cette fois-ci la nuit, précédée d’un orage, tombe sur lui. Elle l’engloutit et lui interdit le retour. Comme si Strehler savait déjà que c’était son dernier ARLEQUIN. l’œuvre ultime rejoint l’œuvre du début et le cercle se ferme sur un demi-siècle de théâtre.
Aujourd’hui Strehler disparu, c’est Ferrucio Soleri, interprète historique d’Arlequin gui vient recevoir les insignes du prestigieux titre. Le metteur en scène et son double. Ainsi, la mort du maître rend encore plus surprenante une cérémonie impensable deux siècles auparavant : Arlequin à la Sorbonne. Et ceci grâce à Strehler qui aujourd’hui s’est retiré en nous léguant cet Arlequin qui, pour quelques temps encore, garde vivant le bonheur de son théâtre.
Discours prononcé pour la remise du titre de docteur honoris causa à Giorgio Strehler par l’Université de la Sorbonne nouvelle, Paris II.