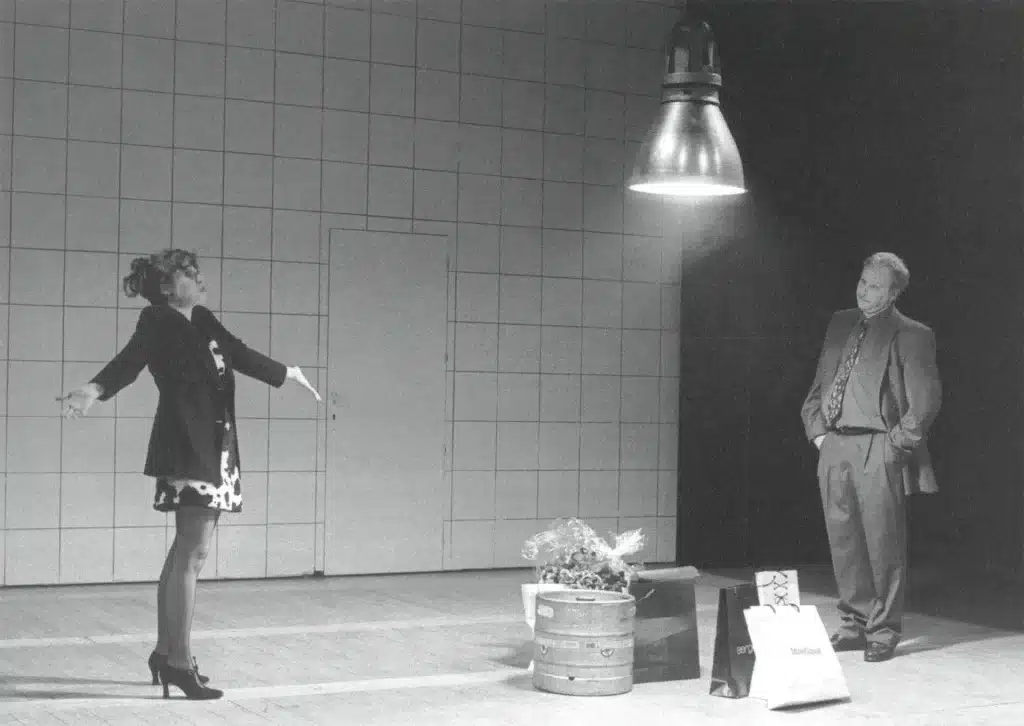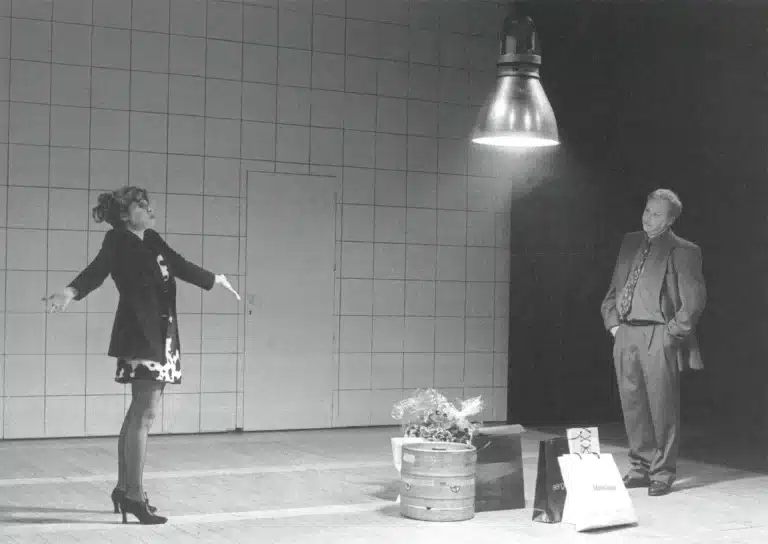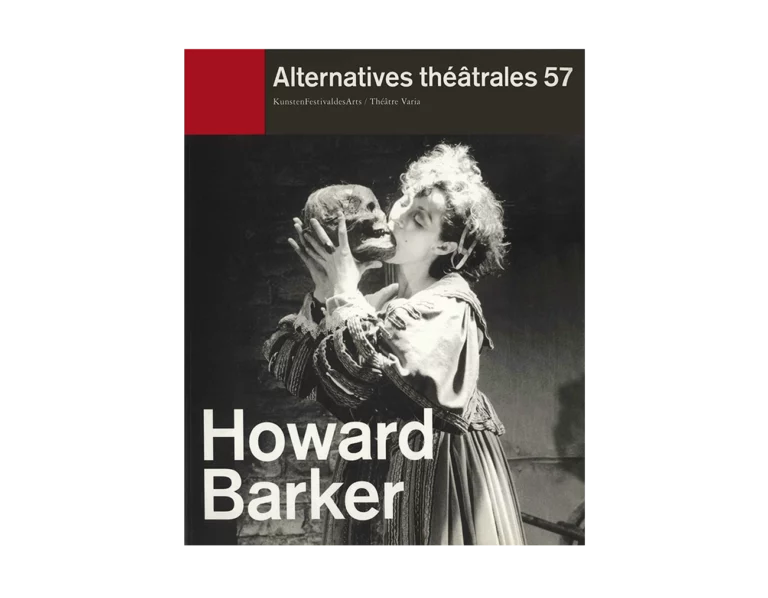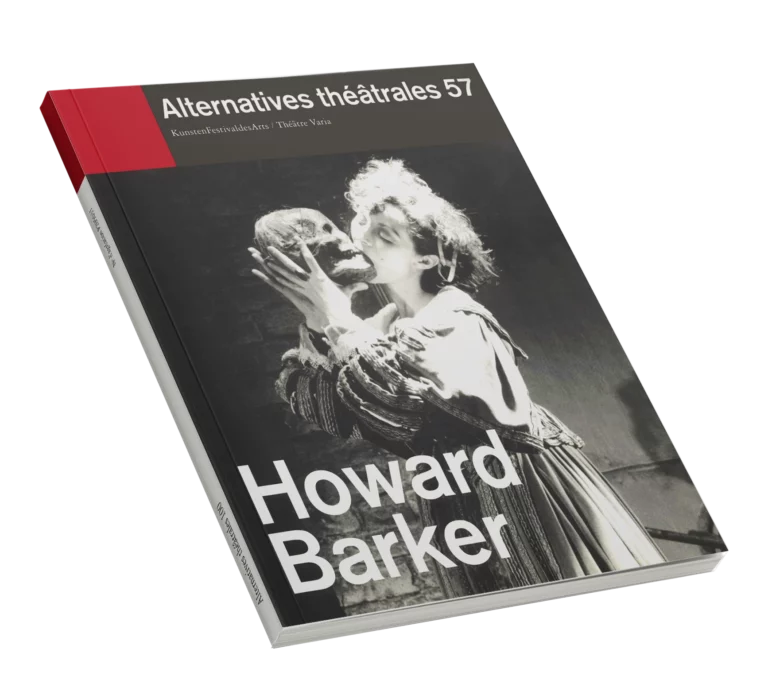HOMME :… et tour de suite j’ai remarqué le badge que vous portez.
Jeune femme : On ne dit plus badge. On dit pin’s !
Homme : C’est quand même la tête de Lénine !
Jeune femme : Un cadeau de ma petite sœur. Pas mal, non ?
Homme : Franchement, ça m’écœure un peu.
Jeune femme : Pourquoi ? C’est juste une belle bobine de barbichu ! Rien d’autre ! Beaucoup plus original qu’un bijou. D’ailleurs, j’aurais pu choisir Napoléon ou Jules César, cela n’a pas plus de sens que cela.1
Freddy : Il faut cesser d’interpréter le monde, il faut le tranformer.
Pierre : On dirait un perroquet !2
Histoires particulières, ambiguës et paradoxales tombées aujourd’hui comme des morceaux brisés d’une Histoire désormais encombrante, Lénine, Staline ou De Man ont-ils encore un sens) Peur-être, comme d’autres, font-ils signe de loin, affiches ou souvenirs à vendre tandis que les haut-parlems des grands magasins diffusent en sourdine des chancs autrefois révolutionnaires.
Jean-Marie Piemme écrie contre les moules qui reproduisent, l’amalgame qui réduit, contre l’oubli de l’Histoire. Il écrit comme on bouscule, comme on secoue, avec l’idée qu’on n’est jamais condamné à rien3. Écriture traversée par l’Histoire ou écriture de l’Histoire, qui témoigne de son temps, le donne à lire dans ses errances et surtout dans ses contradictions.
J’ai des racines …
L’auteur habite un pays, la Belgique. Aujourd’hui, plus qu’hier, il parle de son pays. Il écrit que ses racines lui permettent de mieux être cosmopolite. Alors, Seraing Jemeppe, la Wallonie et les usines pour horizon ne sont plus à cacher. Mais Jean-Marie Piemme ne les revendique pas avec fierté. Il prend d’autres chemins, plus complexes : 11 n’y a d’identité constructive que mouvante, offerte, partagée, métissée4. Dans ce théâtre-là, hier se décrit et s’écrit pour aujourd’hui. Car il faut assumer la filiation.
1953 : La mémoire d’un peuple n’est-elle pas toujours l’objet d’un combat ?5
Moi, le père, je ne suis moi-même rien de plus qu’un souvenir qu’on fait parler…6
Les mots, déjà, débordent de théâtralité. Le person nage, seul en scène, joue le père. Il a l’assurance de ces quelques pantins du théâtre de Jean-Marie Piemme, nobles fantoches revenant interroger sans fin le « je » cette identité qui s’estompe, qui se perd ou qu’on oublie.
Pierre, le père, se raconte et raconte : la mort du père, l’usine, la violence de l’usine… Il change de discours, son « je » fluctue sans cesse, sa parole esc interchangeable. Pierre est traversé par son histoire, il n’en est pas la somme figée. Personnage-narrateur, il est un chaînon de la filiation. Il a la consistance floue du souvenir, se dédouble, se démultiplie dans les voix qui l’habitent : Pierre-l’enfant, Pierre-le père, le père de Pierre…
La mémoire n’est pas univoque.
Le texte égare : quel lien de Pierre à De Man, de Freddy à Staline ? Mais la conscience se consticue-c-elle sur d’autres bases que ces bribes d’informations, ces images happées, ces titres de journaux, ces questions qu’un jour, on a posées ? Les mots remontent le fil, la filiation : du père de Pierre à Pierre puis à Rodolphe, son fils. Passage de témoin jusqu’à aujourd’hui où la conscience a perdu ses repères. Les structures mentales et sociales héritées du XIXe siècle ont peu à peu cessé d’être repérables, identifiables. Les mécanismes se sont opacifiés. Le manichéisme se révèle désormais illusoire et la certitude de la coexistence d’un bien et d’un mal a fait long feu. En cette fin de XXe siècle où nous sommes contraints d’entreprendre une mutation de pensée, Jean-Marie Piemme revient au moment du basculement, de dissolution de toute une logique. Pièce fragmentée, 1953 affronte donc le passé en s’adressant aux hommes d’aujourd’hui. Loin du théâtre historique pourtant, la théâtralisarion de l’Histoire devient ici une des lectures possibles d’un moment-prétexte : la mort d’Henri De Man et celle de Joseph Staline. Car, tandis que le point de vue circule entre les différents membres d’une famille d’ouvriers wallons, le texte livre sa dimension autobiographique. Il convoque le souvenir pour retisser l’éveil d’une conscience politique du monde : celle de l’auteur lui-même.
Que De Man se soit trompé, on le sait, écrie Jean Marie Piemme et que Staline ne soit pas vraiment le sauveur du peuple, on le sait aussi. Par un jeu de contrepoints, Piemme montre, en parallèle, l’ascension sociale de Pierre, ouvrier devenu cadre. Et qui, bien sûr, renonce au syndicat. De quel poids pèsent ces petites trahisons ? La trahison, est-ce la somme des contradictions qui nous traversent, qui nous construisent ?
Pierre :
Liste de ce que je ne veux plus :
- les pommes de terre comme des rochers dans la rivière de sauce
- les restes des restes des restes
- le trou recousu si habilement recousu qu’on ne voir rien, non ! (… )
8. Et je ne veux plus des rêves minuscules On ne recherche pas seulement l’argent, on cherche aussi l’ampleur des choses… 7
Pierre incarne un idéal de construction et de progrès rêve largement matérialiste de « colonisation » de la terre, de conquête de pouvoirs et d’avoirs… Une revanche sur les humiliations d’hier. Un chemin dans lequel s’est engouffrée toute une mouvance socialiste. Cela, Freddy, le beau-frère de Pierre, ne le comprendra pas, ne l’acceptera pas. Tout compromis avec le système relève pour lui de la trahison : La dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du monde des choses8, répond-il à Pierre. Rivé à l’universalité du communisme, il restera l’homme d’une seule vérité, l’homme aussi d’un monde dépassé. Freddy ne pourra s’adapter. D’autres figures de l’absolu, de résistance plus radicale, plus intransigeante viennent hanter ce théâtre. Ainsi, le Capitaine reste désespérément accroché à un rêve de gloire et de grandeur humaines dont le présent ne porte pas les signes. Son refus de l’insignifiance ne trouve de réponse que dans l’alcool ou dans la fuite vers l’Afrique, symbole fantasque d’une humanité préservée. Chacun à leur façon, Freddy et le Capitaine incarnent l’idéal d’un refus collectif, révolutionnaire, d’une résistance et d’une lutte massives qui allaient lentement décroître dans nos pays à la fin du XXᵉ siècle. Momentanément, peut-être, leurs aspirations semblent dépassées, l’homme « qui monte », c’est Pierre. En tant que personnes, Freddy et le Capitaine se sont inscrits corps et âme dans une dimension politique du monde ; ils finiront par s’y dissoudre, n’ayant pas conservé d’autre identité.