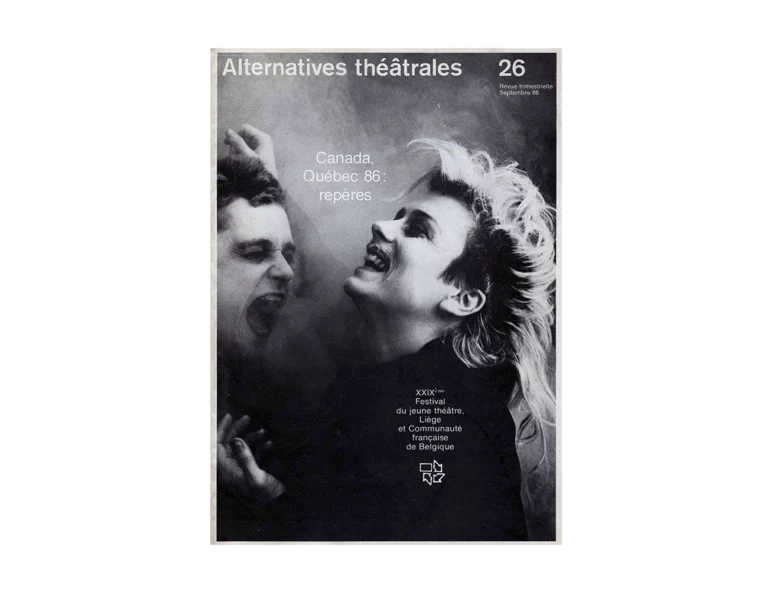*Ce texte a été originellement conçu pour le Monde selon Graff, une publication de Graff, Centre de conception graphique inc., à paraître à Montréal à l’automne 1986, pour souligner le vingtième anniversaire de cette galerie-atelier d’artistes.
Un nouveau pays théâtral
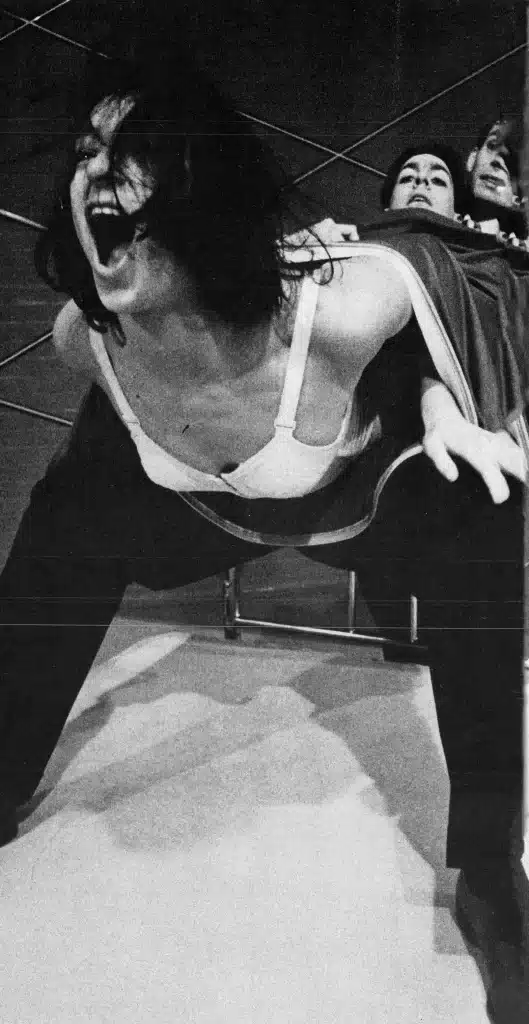
Dans le Renouveau du théâtre au Canada français (Editions du Jour, 1961), Jean Hamelin comptait, en ce début de « Révolution tranquille », quelque trente spectacles professionnels à avoir pris l’affiche à Montréal en une saison : vingt ans plus tard, ce nombre aura au moins quintuplé et, à la grandeur du Québec, on a pu, ces dernières années, estimer à plus de 300 les spectacles théâtraux offerts annuellement, durant la saison régulière — de septembre à mai — et en été.
De la même façon, les compagnies théâtrales se sont multipliées — on en dénombrait, en 1984, autour de 200, en comprenant les théâtres estivaux1 — alors que les démarches artistiques se sont diversifiées et que les publics2 notamment au cours de la dernière décennie, ont connu un taux de croissance très significatif. Le baby boom d’après-guerre, la scolarisation de larges couches de la population, l’augmentation du niveau de vie — et, en conséquence, la diversification des sources de loisir —, conjugués à une vague néo-nationaliste sans précédent, ont été des facteurs d’ouverture culturelle et expliquent, en partie du moins, que la pratique théâtrale ait connu un développement sauvage qui l’a remodelée en profondeur. À partir, notamment, de la fondation du Centre d’essai des auteurs dramatiques3 (C.E.A.D.) en 1965, le théâtre au Québec deviendra un vaste laboratoire où se côtoieront le meilleur et le pire, les approximations généreuses comme les recherches les plus intenses et les plus pertinentes. Dans les notes qui suivent, je me propose de dresser un panorama de l’activité théâtrale des vingt dernières années au Québec, dans une perspective à la fois socio-historique et critique. D’abord, j’examinerai le champ des pratiques dramaturgiques ; dans un deuxième temps, je me pencherai sur les pratiques scéniques, en me contentant d’identifier les compagnies marquantes et les courants majeurs. C’est là, on s’en doute, un partage commode qui vise à rendre compte des deux composantes majeures de toute activité théâtrale, et qui ne pourra pas faire directement saisir les multiples rapports texte/représentation inhérents au champ théâtral.
L’explosion dramaturgique
Au milieu des annés soixante, le théâtre, à l’image de beaucoup d’autres pratiques artistiques au Québec, s’apprête à dénoncer son statut « canadien-français » pour s’affirmer comme « québécois ». Des pionniers d’après-guerre, comme Gratien Gélinas (1909), Jacques Ferron (1921 – 1986), Marcel Dubé (1930), Anne Hébert (1916), Jacques Languirand (1930) et Françoise Loranger (1913), n’écriront plus pour la scène d’œuvres significatives après 1970… Un nouveau chapitre de notre histoire théâtrale va toutefois s’ouvrir avec la création des Belles-sœurs (1968)4 de Michel Tremblay ; en réunissant quinze personnages féminins de condition modeste, s’exprimant dans un idiome populaire, le joual, qui déchaîne aussitôt la controverse, Tremblay va en effet faire éclater le scandale de leur condition aliénante et, à travers ces colleuses de timbres-primes, celle du Québec tout entier. Or, le coup de maître de Tremblay fonctionne aussi à la manière d’une force libérante, car l’activité dramaturgique commence alors à s’intensifier, ce dont le tableau suivant donnera une idée :
Nombre de créations à la scène de 1965 à 19815
| 1965 | 23 |
| 1966 | 20 |
| 1967 | 48 |
| 1968 | 42 |
| 1969 | 61 |
| 1970 | 77 |
| 1971 | 80 |
| 1972 | 90 |
| 1973 | 83 |
| 1974 | non disponible |
| 1975 | 34 |
| 1976 | 35 |
| 1977 | 53 |
| 1978 | 65 |
| 1979 | 72 |
| 1980 | 62 |
| 1981 | 50 |
| TOTAL : 895 |
Un théâtre de l’identité : paroles de désaliénation
Avant toute chose, la période qu’inaugurait Les belles-sœurs, en fut une de décolonisation culturelle et d’émancipation collective. Le théâtre, dans un contexte de bouleversements socio-politiques, a pu contribuer à révéler la collectivité québécoise à elle-même, en dénonçant ses réflexes de minorité et son passé, marqué par le dépendance aux valeurs religieuses, rurales et familiales traditionnelles. De la fin des années soixante au Référendum de 19806, un homme de théâtre, Jean-Claude Germain, a incarné, plus que tout autre, la volonté d’une « québécisation » de notre culture, à l’encontre de tous les modèles étrangers que d’aucuns prétendaient plus universels — ce qu’il a volontiers taxé d’«ailleurisme » —. D’abord critique théâtral, puis dramaturge, metteur en scène et directeur de compagnie — le Théâtre d’aujourd’hui —, Germain a écrit en une douzaine d’années vingt-cinq pièces dont les plus marquantes, à des titres divers, sont : Diguidi, diguidi, ha ! ha ! ha ! (1969), Dédé Mesure (1972), Les hauts et les bas d’la vie d’une diva : Sarah Ménard par eux-mêmes (1974), Un pays dont la devise est je m’oublie (1976), Les faux brillants de Félix-Gabriel Marchand (1977) et A Canadian Play/Une plaie canadienne (1979). Dans une écriture volontiers hyperbolique, criblée de références et d’allusions à l’histoire québécoise, Germain a souvent adopté un ton pamphlétaire, coloré par le recours à la parodie, voire à la fatrasie. Sensible à la dimension théâtrale de la vie sociale ou politique, cet auteur dramatique se montre habile à exploiter les jeux de rôles qui pèsent sur ses personnages ; ceux-ci nous sont, du reste, présentés comme des créatures spéculatives, quand ils ne sont pas carrément des comédiens pris dans le tourbillon de leurs simulacres, ce qui accentue la dimension caricaturale et satiriste de cette dramaturgie qui s’est voulue urbaine, actuelle et engagée, mais qui paraît aujourd’hui embarrassée par sa trop grande transitivité ou, si l’on veut, par l’univocité de ses messages… — ce qui explique peut-être l’espèce de purgatoire que connaissent cette œuvre et son auteur depuis quelques années.
L’importance de Germain n’en est pas moins indéniable, il a formé ou soutenu nombre de créateurs (auteurs et artistes de la scène), tant au Centre d’essai des auteurs dramatiques et au Théâtre d’aujourd’hui qu’à l’Ecole nationale de théâtre du Canada — où il dirige une section d’écriture dramatique depuis 1975 — en leur insufflant un esprit critique et en élaborant un discours programmatique qui visait à l’établissement durable d’une dramaturgie nationale. Depuis son célèbre « C’est pas Mozart, c’est le Shakespeare québécois qu’on assassine »(1970)7, Germain a défendu à toutes les tribunes la nécessité d’une autonomie culturelle et politique pour le Québec et il a cherché à inscrire notre théâtre dans son histoire propre et l’Histoire (du Québec) dans notre théâtre. Tout aussi prolifique — avec près de trente pièces, parmi lesquelles on peut signaler Ben-Ur (1971), Goglu (1971), Une brosse (1975) et, plus récemment, Le grand poucet (1979) et Les gars (1983) —, Jean Barbeau a brossé, sur le mode comico-dramatique, les portraits de velléitaires ou d’individus floués — surtout des hommes —, aux prises avec leurs illusions et les limites de leur existence à courte vue. Mais cet auteur à succès, de tempérament américain, paraît s’être arrêté à la seule description de comportements plus ou moins aberrants, dans des dialogues qui sont à peine décantés de la réalité ; son œuvre, liée plus souvent qu’autrement à l’air du temps, semble vouée, à quelques pièces près, au même destin que le journal de la veille…
Barbeau est ainsi le représentant typique d’une dramaturgie populiste, légère ou quasi mélodramatique, qui fait l’ordinaire des théâtres commerciaux ou de ceux, comme la Compagnie Jean Duceppe, qui misent sur l’émotion et le rire pour distraire à partir de sujets à la mode, avec la bonne conscience d’être soi-disant d’actualité. Tout cela pour dire que la dramaturgie québécoise, en se popularisant, s’est aussi américanisée dans ses formulations dramaturgiques et que beaucoup de textes qui.se créent depuis une bonne dizaine d’années reconduisent, délibérément ou non, les recettes éprouvées du show-business (off-)broadwayen — comédies musicales comprises — et de ses avatars télévisuels, le soap opera et la sit-com. En ce sens, les pièces, toutes écrites en collaboration, de Louis Saia — Une amie d’enfance (1977), Broue (1979), Bachelor (1979), Appelez-moi Stéphane et Les voisins (1980); Monogamy (1982)8 — accumulent à profusion les idiosyncrasies des banlieusards et autres petits-bourgeois actuels, en se refusant à tout approfondissement critique et en laissant aux spectateurs (qui en redemandent) la complaisante satisfaction de juger l’Autre en toute quiétude d’esprit. Théâtre en surface qui mise sur des effets de reconnaissance, ce type de comédies est très prisé par un public qui « jouit de ce que la représentation découpe et fige un fragment de réel »9.
Cependant, d’autres dramaturges, durant ce qu’on pourrait appeler la période de remise en question de notre société à l’égard des normes et habitus hérités du monolithisme théocratique, ont contribué à nommer — et à nouer — l’identité québécoise naissante, souvent marquée au coin de la dérision et de l’absurde, ou présentée sous l’angle d’un réalisme satirique ; c’est le cas, par exemple, de La guerre, yes sir ! (1970) de Roch Carrier, Aujourd’hui, peut-être (1972) de Serge Sirois, On n’est pas sorti du bois (1972) de Dominique de Pasquale, Wouf Wouf (1974) d’Yves Sauvageau, La famille Toucourt en solo ce soir (1979) d’Eric Anderson, À qui l’petit cœur après neuf heures et demie ?(1980) de Maryse Pelletier et Bienvenue aux dames, Ladies Welcome ! (1983) de Jean-Raymond Marcoux.
D’autres auteurs, plus gravement sans doute, ont fouillé l’âme collective, du passé le plus lointain au présent le plus brûlant, pour en extirper des signes d’aliénation, accumulés par l’expérience collective depuis la Conquête britannique. Des pièces comme Le procès de Jean-Baptiste M. (1972) de Robert Gurik, La sagouine (1972) d’Antonine Maillet — d’origine acadienne, mais dont la carrière théâtrale fut essentiellement québécoise —, La gloire des filles à Magloire (1975) d’André Ricard, Le temps d’une vie (1975) de Roland Lepage, Dernier recours de Baptiste à Catherine (1977) de Michèle Lalonde, Songe pour un soir de printemps (1981) d’Élizabeth Bourget et C’était avant la guerre à l’Anse à Gilles (1981) de Marie Laberge ont ainsi reconstitué différents épisodes de notre (petite) histoire pour en tirer le constat tragique de la « québécitude ».
Toutefois, l’auteur majeur de toute la période couverte ici demeure sans contredit Michel Tremblay. Quand Les belles-sœurs sont apparues, ironie du sort, sur la scène qui représentait en 1968 le parisianisme théâtral dans toute sa splendeur — le Théâtre du Rideau Vert —, toute l’histoire du théâtre canadien-français n’a fait qu’un tour : tante Clara10 et Antigone, Dubé et lonesco, subitement, n’étaient plus joués sur des scènes séparées. Un « monstre » nous était donné. D’autres ont suivi… Car Tremblay a su pointer avec acuité le cul-de-sac que constituaient, pour la collectivité québécoise, l’ignorance, l’hypocrisie sociale ou religieuse et l’incommunicabilité, dans des pièces dont le réalisme déconstruit ne se départit jamais de sa charge critique. Et puis, des Belles-sœurs au chef-d’œuvre qu’est Albertine, en cinq temps (1984), en passant par À toi, pour toujours, ta Marie-Lou (1971), Hosanna (1973), Bonjour, là, bonjour (1974), Damnée Manon, sacrée Sandra (1977), son œuvre dramatique s’est imposée avec force, au Québec comme à l’étranger. Germaine, Marie-Lou, Léopold, Manon, Albertine, Sandra, Claude, Gabriel ou Carmen sont devenus de véritables mythèmes de notre théâtre et de notre culture ; ces personnages ont une rare densité et une portée universelle ; avec eux, Tremblay a enclenché un important processus de saisie tragi-comique des valeurs dominantes, tout en provoquant une prise de conscience sans concession à l’égard des petitesses et du masochisme atavique du peuple québécois.
Moins populaires que Tremblay, des auteurs dramatiques comme Claude Gauvreau (1925 – 1971), Michel Garneau et Réjean Ducharme ont contribué à fonder une dramaturgie du verbe. Poète, essayiste et dramaturge, Gauvreau a connu la fin tragique que toute son œuvre annonçait ; esprit libertaire et passionné, il a dénoncé, fidèle en cela à l’esprit de Refus global, le célèbre manifeste automatiste de 1948, une société qu’il sentait cruellement asphyxiante, dans des pièces féroces et un peu grandiloquentes — La charge de l’original épormyable (1970), Les oranges sont vertes (1972), entre autres —. De son côté, le poète Michel Garneau a plongé, pour ses pièces majeures, dans tous les matériaux langagiers disséminés dans la mémoire collective, avec ivresse et sensibilité aux nuances du cœur et de l’âme : Quatre à quatre (1973), Gilgamesh (publiée en 1976), Emilie ne sera jamais plus cueillie par l’anémone (1981) et sa « tradaptation » de Macbeth (1978) se détachent nettement d’une œuvre abondante et diversifiée, par leur thématique introspective, leur puissance d’envoûtement et leur sensualité prosodique. Réjean Ducharme, enfin, a pratiqué la parodie grotesque — Le Cid maghané (1968) et Le Marquis qui perdit (1970) — et, avec plus de bonheur, l’anti-épopée, burlesque ou dérisoire — Ines Pérée et Inat Tendu (1968) et HA ha!… (1978) —: ce théâtre de la cruauté qui dissèque les actes de langage et met à nu le vide des consciences, culmine dans le dévoilement de la veulerie, assimilée radicalement chez Ducharme à la condition adulte.
Le théâtre engagé, dans un contexte d’effervescence politique et sociale, a attiré quelques auteurs — mais surtout des collectifs, dont il sera question en deuxième partie —; mentionnons ici les noms de Robert Gurik — Hamlet, prince du Québec (1968), Le tabernacle à trois étages (publiée en 1972), La baie des Jacques (publiée en 1978) —, d’André Simard — Le temps d’une pêche (publiée en 1974), En attendant Gaudreault (publiée en 1976) —, de Gilbert Dupuis — Les transporteurs de monde (publiée en 1984) — et, concernant le jeune public, de Louis-Dominique Lavigne — Un jeu d’enfants11 (1979), Un vrai conte de fées (1982) — .
L’affranchissement féministe ou quand le « e » n’est plus muet
Une autre facette de notre dramaturgie exige certainement quelques commentaires : l’émergence de femmes-auteures. Bousculée par un intense questionnement féministe, l’écriture dramatique s’est non seulement trouvée à être investie par un fort contingent de nouvelles auteures, mais elle a aussi connu une mutation idéologique considérable sur le plan des « rôles » féminins, autant dans la distribution de leurs traits caractériels et de leurs attitudes qu’à l’endroit de leur poids spécifique dans la structure des œuvres.
À vrai dire, la dramaturgie des femmes des années soixante-dix en a d’abord été une de combat12 : des auteures dramatiques ont dénoncé le pouvoir patriarcal et l’esclavage domestique des femmes, marqué une volonté de réappropriation de leur corps et réévalué leur identité sexuelle, remis en cause la dépendance économique des femmes et leur assujettissement aux représentations érotiques des hommes, etc.; tout cela a trouvé un écho dans de nombreuses pièces et continue d’être la substance du discours dramatique de plusieurs dramaturges actuels, hommes ou femmes au demeurant, car l’impact du féminisme s’est depuis fait sentir sur l’ensemble du milieu théâtral. Ainsi, dans la recherche d’une légitimité dramaturgique et théâtrale, les femmes-auteures se sont manifestées à même une thématique fortement engagée et par le recours à une formalisation, polarisée, d’une part, par un didactisme plus ou moins démonstratif et, d’autre part, par une approche symboliste, souvent lyrique. Prises de paroles dans l’urgence du moment, mises en relief humoristiques du quotidien le plus anecdotique — mais débusquant par là-même les symptômes les plus intimes du malaise féminin — et explorations d’archétypes jusque dans leur ancrage mythique ont été les fondements d’un regard incisif qui a embrassé tous les aspects problématiques de la vie des femmes-en-société.
Mais ce qui a eu toutes les apparences d’un courant identifiable, ne fut certes pas unifié sur le plan dramaturgique. Après les œuvres qui ont pris valeur de manifeste et donné le ton, comme La nef des sorcières (collectif, 1976) et Les fées ont soif (1978) de Denise Boucher, sont apparues des pièces moins déclaratives et plus dramatiquement articulées, par exemple cette Moman (1979) de Louisette Dussault, une comédienne-auteure dont le témoignage, haut en couleur et distancié, a synthétisé avec éclat le questionnement socio-culturel de toute une génération de Québécoises à l’égard de la maternité. De leur côté, des auteures comme Elizabeth Bourget — Bernadette et Juliette ou La vie, c’est comme la vaisselle, c’est toujours à recommencer (1978); Bonne fête maman (1980) —, Jeanne-Mance Delisie — Un réel ben beau, ben triste (1979) —, Marie Laberge — Profession : je l’aime (1979); Jocelyne Trudelle, trouvée morte dans ses larmes (1980); Deux tangos pour toute une vie et L’homme gris (1984) — et Maryse Pelletier — Du poil aux pattes comme les CWAC’s (1982), Duo pour voix obstinées (1985) — ont écrit des comédies de situation et/ou des drames psychologiques pour lesquels elles ont priviligié le mode réaliste en recourant à des procédés d’identification et, parfois, de distanciation.
D’autres auteures ont fait éclater le drame conventionnel et ont injecté dans leurs pièces des images et des partis pris scripturaux, inégalement convaincants, mais qui laissent percevoir une insatisfaction à l’égard des solutions dramaturgiques habituelles : France Vézina — L’androgyne et L’hippocanthrope (1979) — et Jovette Marchessault — La saga des poules mouillées et La terre est trop courte, Violette Leduc (1981); Alice & Gertrude, Natalie & Renée et ce cher Ernest (1984); Anaïs, dans la queue de la comète (1985) — se rattachent, sans être elles-mêmes des praticiennes de théâtre, à un ensemble d’auteures, telles Pol Pelletier, Louise Laprade, Marthe Mercure, Michelle Allen, Alice Ronfard, Ginette Noiseux et Lise Vaillancourt, qui ont touché, seules ou en collectif, à l’écriture expérimentale, à la faveur de leur pratique de comédienne, de scénographe ou de metteure en scène ; ensemble, elles partagent un même topos imaginaire : la mémoire des femmes, à la fois objet d’historicisation, inscription anthropologique et ouverture sur l’«autre scène ».
Une certaine génération montante et les vertiges de la déviance

Ce qui frappe d’emblée dans la production dramaturgique, disons sérieuse, de ces dernières années, c’est le caractère foncièrement autoreprésentatif de plusieurs pièces : des auteurs comme Jean-Marie Lelièvre avec Meurtre pour la joie (1981), Claude Poissant dans Passer le nuit (1983) et René Gingras avec Le facteur réalité (1985), laissent clairement entendre que la représentation ne va plus de soi et font de ce doute, ou du vertige qui l’accompagne, l’axe structurant de leurs œuvres. Plus largement, les textes, ou plutôt les « objets dramatiques », pour reprendre ici une expression de Gauvreau, ont tendance à se faire aléatoires, incertains, ambigus. Les personnages muitipiient les béances de leurs discours ou, encore, se gonflent de paroles désordonnées et sont pris dans une spirale d’événements mi-réels, mi-fantasmés qui les étourdissent (et nous avec eux). Le terrain de l’affirmation textuelle est comme miné, mais, en même temps, les références culturelles y sont cultivées généreusement ; une intertextualité affichée, avec ses jeux d’allusion, de connexion et de condensation, reprend du service et crée des effets spéculaires inusités et des métissages insolites. Jean-Pierre Ronfard — Les Mille et Une Nuits et Don Quichotte (1984) — et René-Daniel Dubois — Panique à Longueuil (1980), William (Bill) Brighton (1984), 26bis, impasse du Colonel Foisy (1986) — excellent dans ce genre néo-baroque, non sans parfois sacrifier l’émotion sur l’autel de leurs constructions quelque peu cérébrales.

Par ailleurs, on ne compte plus les œuvres qui mettent en scène l’une ou l’autre figure du déviant, qu’il soit artiste (peintre, musicien, écrivain, acteur…), criminel ou homosexuel ; je pense à ce troublant John Benett, le meurtier psychopathe des Pommiers en fleurs (1981) de Serge Sirois, au jeune prostitué assassin de Being At Home With Claude (1985) de René-Daniel Dubois, à l’auteur dramatique pris au piège de sa folie amoureuse dans Provincetown Playhouse, juillet 1919, j’avais 19 ans (1982) de Normand Chaurette, à l’adolescent épileptique et vitriolique de Syncope (1983) de René Gingras ou au couple d’homosexuels mâles, plongés en plein psychodrame, de La Contre-nature de Chrysippe Tanguay, écologiste (1983) de Michel-Marc Bouchard. La nouvelle dramaturgie des années quatre-vingt paraît ainsi hantée par des créatures infernales ou sulfureuses ; les pulsions de mort omniprésentes qui s’y logent, sont alors secouées par des exorcismes savants, des délires sardoniques ou des implosions dévastatrices, et les quêtes d’identité qui la traversent, sont frappées brutalement d’une chute dans la folie ou d’un réflexe d’abandon, souvent suicidaire. L’Histoire universelle, comme dans Vie et mort du Roi Boiteux (1981 – 1982), l’impressionnante série de six pièces de Jean-Pierre Ronfard, se disloque en personnages fantoches, irrécupérables, ou se raidit en un affrontement funeste des super-puissances comme dans Ne blâmez jamais les Bédouins (1984) de René-Daniel Dubois. Ce « catastrophisme » fonctionne comme un avertissement et il renvoie sans doute au sentiment d’impuissance des créateurs qui n’ont plus guère que la raillerie ou le grotesque pour dire le monde tel qu’il va.
À côté de tels textes, extravagants et composites, les pièces de Marco Micone — Gens du silence et Addolorata (1983) — peuvent sembler d’une facture toute classique, quoiqu’’elles témoignent d’une actualisation singulière des principes épiques, en décortiquant avec intelligence et sensibilité, par petites touches de sens, les mécanismes d’oppression subis par des Néo-Québécois d’origine italienne. Pour leur part, les œuvres de Suzanne Aubry — La Nuit des p’tits couteaux (1983) — et de Jocelyne Beaulieu — J’ai beaucoup changé depuis (1980), Camille C. (en collaboration avec René Richard Cyr, 1984) —, et d’Anne Legault — Les ailes ou la maison cassée (1985), La visite des sauvages (1986) — confirment, plus qu’elles ne renouvellent, les choix dramaturgiques de leurs prédécesseurs.
On peut donc affirmer, au terme de ce survol de la dramaturgie québécoise, que nos auteurs dramatiques sont loin d’être une espèce en voie de disparition. La création d’une pièce originale qui faisait, il y a vingt ans à peine, figure d’exception, est maintenant un phénomène du passé. Il y a indéniablement, à ce qu’il semble, un dynamisme de la création dramatique lié au nombre. Cela ne signifie pas pour autant que notre dramaturgie est aussi vivante qu’on pourrait le souhaiter. Trop souvent, des textes sont mis à l’affiche prématurément, ce qui laisse penser que nos directions de théâtre connaissent peut-être la même précipitation brouillonne que certains éditeurs de romans. En revanche, notre société prend du temps à reconnaître ses nouveaux dramaturges de talent, lesquels restent confinés aux petites salles et au public averti. Aussi, rien n’est aussi simple qu’avant : dans un presque-pays en train de redevenir « la Belle Province », dans un monde en passe de se pétrifier, le Québec n’aura-t-il pas, plus que jamais, besoin de ses écritures dissidentes ?

2. Pratiques scéniques : les tardifs apprentissages de la modernité x
L’activité théâtrale d’après-guerre au Québec a d’abord consisté à être le reflet — fidèle ou flou, du reste — de ce qui se réalisait à Paris, à Londres et à New York, dans les théâtres conventionnels s’entend, ou, au mieux, dans le sillage des idées réformatrices du Cartel français de l’entre-deux-guerres (Jouvet, Dullin, Pitoëff, Baty). En conséquence, de l’après-guerre à 1970 environ, la mise en scène, par exemple, est restée une pratique secondaire, soucieuse avant tout de « servir » l’auteur et de « respecter » le Texte, au point de lui réserver la quasi-totalité du sens de la représentation13.
Tout cela commence à bouger et à se fissurer au tournant des années soixante-dix, aussi bien sous la pression interne d’une plus grande liberté expressive que sous les chocs externes des expériences du nouveau théâtre américain, en particulier dans sa composante anarchiste du type Living theatre14 des réflexions théoriques d’Artaud et de Brecht qui commencent à être mieux connus ou, encore, de l’enseignement, direct ou réverbéré, de praticiens européens, tels J. Lecoq, J. Grotowski, E. Decroux et E. Barba.
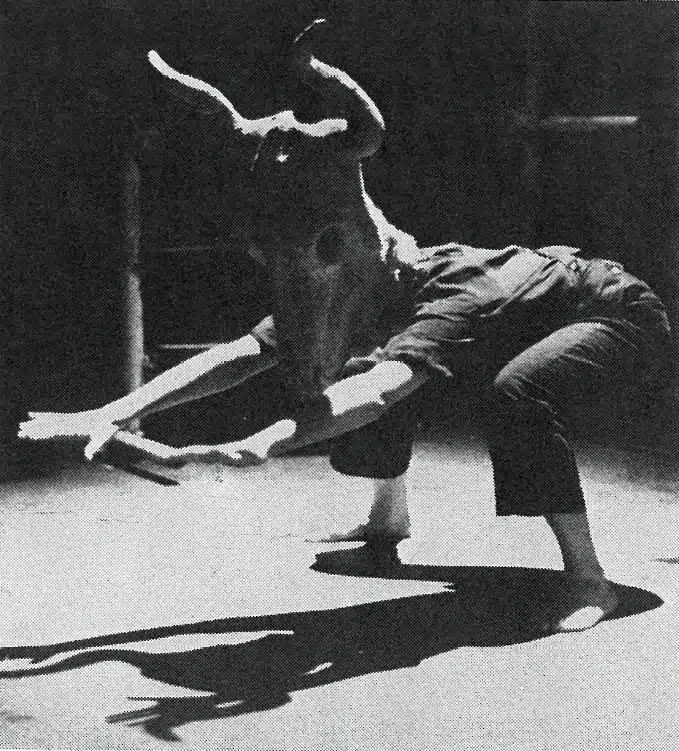
La scène québécoise est alors le lieu de multiples expérimentations qui permettent aux gens de théâtre avertis de renouer avec des courants de recherche, occultés par le théâtre officiel, et qui avaient pourtant marqué l’évolution du théâtre occidental au 20° siècle. Certes, ce « ratrappage » de la modernité théâtrale ne s’est pas fait sans confusion, ni sans tâtonnement, mais un net mouvement exploratoire a ainsi été lancé et, en durant, il s’est approfondi et a pris de l’épaisseur. Parallèlement à ce grand appétit moderniste, s’est aussi manifestée une forte tendance à l’autarcie théâtrale, farouchement anti-internationaliste ; cette approche visait à constituer une théâtralité ostensiblement québécoise et entendait puiser ses signes dans une stylisation de notre patrimoine spectaculaire (et, plus largement, culturel) pour les fondre ensuite à une symbolique tirée de l’observation directe de comportements socio-culturels immédiats. Mais une telle volonté de québécisation à tout crin a fait long feu — sauf en ce qui concerne la langue parlée par les personnages — et on a plutôt assisté à la fusion de langages et de processus créateurs exogènes à des traditions culturelles et artistiques particulières au Québec. Cette fusion a comporté des mouvements d’intégration, d’assimilation et de confrontation — et non pas, comme on aurait pu le craindre, de servile imitation — et elle ne fut pas parfaite, sans pli ; mais peu importe, puisque l’impureté est devenue aujourd’hui la condition ordinaire de toute pratique théâtrale inventive, du moins en Occident.
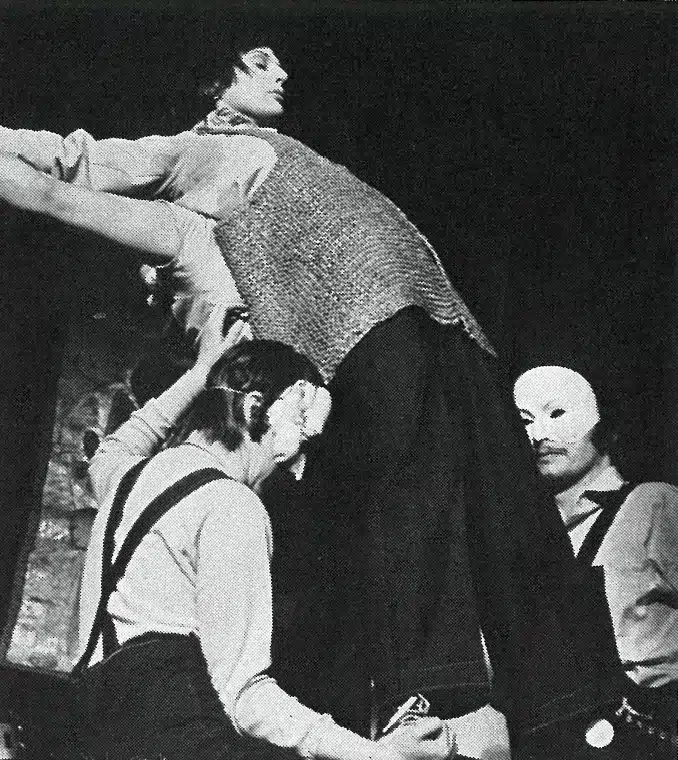
Un théâtre d’acteurs-conteurs : monologues, créations collectives et jeux d’improvisation
La première rupture à s’être produite dans notre pratique théâtrale fut obtenue par l’introduction massive de la langue vernaculaire par des acteurs-conteurs, lesquels se sont placés à mille lieux du langage châtié et de la diction déclamatoire qui régnaient en maîtres sur les scènes traditionnelles. Or, le français québécois populaire, une fois en représentation, a joué à fond sa fonction d’exutoire de toutes les paroles jugées jusqu’alors indignes du Théâtre. Un immense besoin de s’exprimer publiquement s’est donc répandu comme une traînée de poudre, sans apprêt ou, comme on dit, « à la bonne franquette ». Après s’être rêvé humaniste et plus ou moins élitiste, le théâtre est ainsi devenu public.

Ce sont les acteurs de la génération d’après-guerre, précédés en cela par les chansonniers, qui ont bientôt voulu prendre directement la parole. Et, à défaut de toujours trouver des textes dramatiques qui auraient convenu aux nécessités du moment, ils les inventaient, les monologuaient, les improvisaient et les montaient. S’il n’a pas été question plus haut, dans la partie consacrée à la dramaturgie, des monologuistes — de Clémence Desrochers à Sol, sans oublier Yvon Deschamp —, c’est que ces comédiens — les Américains appellent comedians leurs monologuistes — tiennent plus de la bête de scène que de l’écrivain dramatique, procèdent plus des variétés que du théâtre. Pourtant, leur existence ne fut pas étrangère à la constitution d’un bloc compact de paroles scéniques qui, une fois mises bout à bout, pourraient bien être la version toute québécoise d’une geste, la manifestation foncièrement orale d’«une quête d’identité et d’unité »15.

Théâtre du constat et du contact, la création collective ne fut-elle pas aussi une tentative pour harmoniser des monologues d’acteurs ? Dans les voix dissonnantes d’une collectivité qui se redonnait la parole, a en effet circulé comme un désir convivial dont l’acteur fut à la fois le médium et le message. Théâtre d’acteurs, donc. Théâtre instantané, ici et maintenant. Théâtre cru, voué à la récupération lettrée par les pillards que sont toujours les dramaturges, comme naguère Gozzi s’’emparant de la Commedia dell’Arte ? Peut-être bien que Ronfard et Dubois nous jouent, en ce moment, ce tour de balancier historique…
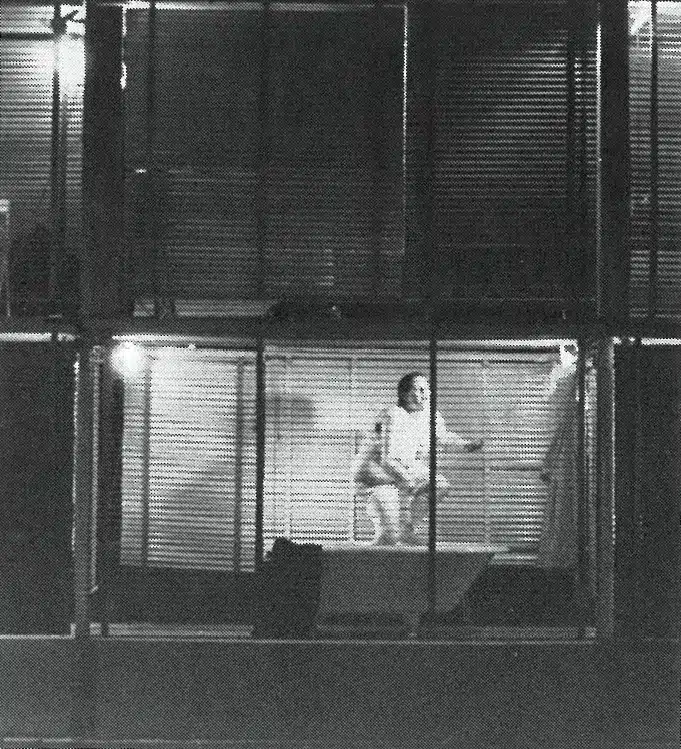
Quoi qu’il en soit, parallèlement à l’écriture dramatique d’auteur, un phénomène à la fois dramaturgique et scénique a marqué, durant toutes les années soixante-dix, la pratique théâtrale ; sous la poussée de groupes comme le Grand Cirque ordinaire (1969 – 1977), le Théâtre Euh ! (1970 – 1978), le Théâtre de carton (1972), les Gens d’en bas (1973), le Théâtre Parminou (1973), le Théâtre des cuisines (1973 – 1981), le Théâtre de quartier (1975) et le Théâtre à l’ouvrage (1978 – 1983), la création collective est rapidement devenue une forme populaire, en ce qu’elle permettait l’expression d’une multitude de gens — pas toujours de théâtre, d’ailleurs — qui se trouvaient ainsi à participer au brassage socio-culturel et politique d’alors.
Sous l’onde de choc de la contre-culture américaine, la création collective s’est trouvée d’abord à porter les espoirs et les utopies d’une jeunesse manifestement en rupture de ban ; elle a, en outre, livré passage à des valeurs émancipatoires et nationalistes, mais elle a surtout incarné une volonté de changement social, parfois même radicale quand ses participants passaient par une analyse plus explicitement politique, d’inspiration marxiste.

L’«âge d’or » de la création collective peut se situer en gros de 1968 à 1978 ; au cours de cette décennie, plusieurs spectacles créés en collectif ont en effet eu un impact considérable et ont permis, en même temps, de remettre en cause les orientations esthétiques et civiques du théâtre « institutionnel »16. Mentionnons, parmi les quelques centaines de créations coiiectives à avoir été présentées, quelques-unes des plus significatives : T’es pas tannée, Jeanne d’Arc ? (1969), T’en rappelles-tu Pibrac ? (1971) et Un prince, mon jour viendra (1974) du Grand cirque ordinaire ; L’histoire du Québec (1971), et Un, deux, trois. vendu ! (1974) du Théâtre Euh!; la Complainte de Fleudelysée Fortin (1973) et Un M.S.A. pareil comme tout le monde (1976) du Théâtre de l’organisation Ô, L’argent, ça fait‑y vot’bonheur ? (1975), Partez pas en peur ! (1977) et Ô travail (1978) du (toujours prolifique) Théâtre Parminou ; Moman a travaille pas, a trop d’ouvrage (1975) et As-tu vu ? les maisons s’emportent ! (1980) du Théâtre des cuisines ; Les marchands de ballounes (1975) et On est partis pour rester (1978) des Gens d’en bas ; La vie à trois étages (1977) du Théâtre de la Marmaille ; À ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine (1978) du Théâtre expérimental de Montréal ; Si les ils avaient des elles. (1978) du Théâtre de Carton ; et, plus tardivement, Enfin, duchesses ! (1982) des Folles alliées (1980).
Réunis majoritairement sous la bannière de l’Association québécoise du jeune théâtre — fondée en 1958 sous le nom d’Association canadienne du théâtre amateur et qui vient de se dissoudre en avril 1986 —, les tenants de ce théâtre activiste aux visées populaires, modifiées dans une deuxième phase en objectifs davantage communautaires ou éducationnels, ont été les artisans d’une conscientisation agressive du public ; ils ont ainsi pris le relais des revendications collectives les plus diverses, liées par exemple à la condition opprimée des femmes, aux besoins des personnes âgées ou aux classiques rapports de force entre patrons et salariés, propriétaires et locataires, décideurs et simples citoyens.
Certains des groupes nommés plus haut, notamment le Théâtre Parminou, se sont prêtés à l’exécution de commandes (par des syndicats, des associations et des regroupements divers) dans une perspective d’intervention auprès de destinataires spécifiques. L’objectif de rendre le théâtre utilitaire, instrument de réflexion et véhicule de solidarité, ne fut pas toujours, en ce sens, exempt d’ambiguîïté, car, dès lors que le théâtre se lie étroitement à un commanditaire idéologiquement intéressé, n’est-il pas menacé dans son invention même ? Où alors se termine l’engagement ? — et où commence la compromission ?17.
Une autre voie, empruntée au Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal, s’est manifestée ces dernières années : le théâtre-forum. Un groupe — le Théâtre sans détour (1977) — et un auteur engagé — Louis-Dominique Lavigne, notamment avec Les purs (1985) — pratiquent cette forme de socio-drame qui n’a guère franchi à ce jour que le stade des premiers essais.
Mais, pour en revenir à la création collective, c’est, à la longue, la réception attiédie du public (veillissant ?)et de la critique (devenue plus exigeante ?), qui a eu raison de la plupart des collectifs de création — ce n’était pas la première fois, non plus, qu’un courant était victime en quelque sorte de ses propres succès ! —; il semble bien aussi que la création collective n’ait pas été accueillie avec le même enthousiasme par la plus récente génération de Québécois que l’on dit plus individualistes.. Sans doute, la création collective n’a‑t-elle pas su réévaluer ses propres modes de création et on a pu, à bon droit, constater ici et là un essoufflement — ou un vieillissement précoce — des thèmes et des procédés scéniques originels ; mais le théâtre est aussi un art très sensible à la température sociale du moment et il ne fait nul doute que l’espoir, entretenu puis déçu, en l’imminence de l’indépendance du Québec ou en celle de l’atteinte d’une plus grande justice sociale, n’a pas franchi sans mal la période post-référendaire, frappée au surplus d’une récession économique qui a ravagé les convictions utopistes et collectivistes les mieux assurées.
« Davantage de bon sport », avait un jour réclamé Brecht pour le théâtre ; le Québec lui en renvoie l’écho sous la forme d’une entreprise théâtrale qui parodie le hockey en faisant jouter deux équipes de comédiens à partir de commandes d’improvisations pigées au hasard. À sa manière, plus réglementée il est vrai, l’improvisation à la Ligue nationale d’improvisation (créée par le Théâtre expérimental de Montréal en 1977) met à nu l’envers — ludique certes, mais laborieux aussi — de la création collective. Aussi, l’impact considérable sur la population du Québec de ce sport théâtral et son expansion dans la francophonie européenne, avec la Coupe mondiale d’improvisation, laissent songeur ; phénomène d’époque, le jeu d’improvisation cherche-t-il ainsi à rivaliser avec le vidéo-clip, en misant sur des situations à l’emporte-pièce et sur des effets (parfois) éblouissants et voulus obsolètes ? Au-delà de la quête à la fois sérieuse et parodique de la spontanéité scénique, l’improvisation ainsi dérivée de notre sport national n’est-elle pas qu’un ersatz et du hockey et du théâtre ? On peut le croire… tout en saluant cette brillante tentative pour sortir le théâtre de ses | rites habituels.
Ouverture d’un nouveau front théâtral : les jeunes publics
Un des aspects les plus réjouissants du théâtre québécois des vingt dernières années, c’est sans contredit la consolidation d’une pratique théâtrale tournée vers les jeunes spectateurs, enfants et adolescents18. Timidement initiée, au sortir de la dernière guerre, par des compagnies qui consacraient, non sans nécessité, l’essentiel de leurs énergies au développement d’un public d’adultes, la volonté de produire des spectacles destinés essentiellement aux enfants s’est peu à peu affermie dans les années cinquante et soixante. Mais c’est durant les années soixante-dix et au-delà que ce secteur d’activités théâtrales a connu un essor remarquable et une mutation idélogique qui ne fut pas étrangère au climat culturel ambiant.
Si le Théâtre pour enfants de Québec (1967 – 1970), le Théâtre de l’arabesque (1968 – 1973), le Théâtre des Pissenlits (1968 – 1984) et la section jeunesse du Théâtre du rideau vert (1967 – 1979) ont pu donner une certaine consistance à ce qui n’avait été auparavant qu’une pratique sporadique, le jeune public est resté pour eux un destinataire qu’il fallait avant tout émerveiller et amuser : aventures, récits fantastiques et personnages clownesques composaient là un imaginaire assez homogène… et plutôt superficiel.
En 1973, à partir d’une expérience en atelier d’écriture, parrainée par le Centre d’essai des auteurs dramatiques, des enfants, des comédiens et des auteurs, animés par Monique Rioux, brisent ensemble le miroir aux alouettes et jettent les bases d’une nouvelle conscience théâtrale : celle-ci sera faite d’un esprit de collaboration avec les enfants eux-mêmes qui seront associés au processus de création théâtrale, selon des formules qui iront du partenariat structuré, avec enquête ad hoc, à la simple écoute complice.
Favorisés par des programmes gouvernementaux de création d’emplois, de jeunes praticiens fondent bientôt des compagnies, puis ne tardent pas à se regrouper pour faire front commun face aux subventionneurs et obtenir d’eux qu’ils reconnaissent ce segment culturel et son importance pour la pérennité de la vie théâtrale au pays. Un festival de théâtre pour enfants apparaît dès 1973 et s’est tenu annuellement, sous la responsabilité de l’Association québécoise du jeune théâtre, depuis 1974 jusqu’en 1985.
Le Théâtre de la marmaille, le Théâtre de l’Oeil (19), le Théâtre de carton, tous fondés en 1973, le Théâtre du Carrousel à partir de 1975, puis les Productions pour enfants de Québec (le Théâtre du gros Mécano), le Théâtre de l’avant-pays19, le Théâtre l’arrière-scène, fondés en 1976, vont contribuer à la régénération du théâtre pour enfants, aussi bien dans ses contenus que dans sa théâtralité. Ces compagnies seront aussi accompagnées dans cette démarche par des théâtres qui partageront leur programmation entre le public jeune et adulte, comme le Théâtre du sang neuf (1973), le Théâtre de quartier (1975) ou le Théâtre petit à petit (1978).
Des prescriptions et des tabous jusque-là bien ancrés dans les mentalités — ce qu’il faut dire et ne pas dire aux enfants — vont, à partir de ce moment, être renversés par des productions audacieuses : Cé tellement « cute » des enfants (Théâtre de la marmaille, 1975) de Marie-Francine Hébert, On n’est pas des enfants d’école (Théâtre de la Marmaille, 1979) de Gilles Gauthier, Les enfants n’ont pas de sexe ? du Théâtre de Carton (1979)20 , Pleurer pour rire (Théâtre de la marmaille, 1980), de Marcel Sabourin, Les petits pouvoirs (Théâtre le carrousel, 1982) de Suzanne Lebeau et Dis-moi doux (Les Bêtes-à-Coeur, 1984) de Louise Bombardier. Avec des pièces comme Une lune entre deux maisons (1979) et La marelle (1984) de Suzanne Lebeau, Le cas rare de Carat (1979) de Louise Bombardier, Peur bleue (1981) et le Cocodrille (1985) de Louise LaHaye, l’Umiak (1983) du Théâtre de la Marmaille, le théâtre pour enfants s’est enrichi de dimensions poétiques et a exploré sur le mode intimiste, des expériences enfantines liées à l’amitié, la peur, la soif de connaître, le besoin de tendresse, la nécessité du jeu et de l’imagination ou la chaleur de la solidarité.
Le théâtre pour adolescents n’est pas non plus en reste, quoiqu’il n’ait pas pris l’ampleur de celui qui s’adresse aux plus jeunes, et, surtout depuis cinq ans, on a vu apparaître, après les tentatives inégales du Théâtre de l’atrium (1974), des spectacles signifiants qui sont arrivés à toucher un public plutôt enclin, d’habitude, à préférer le cinéma et le rock au théâtre. Signalons dans cette nouvelle veine deux productions intéressantes du Théâtre Petit à Petit : Où est-ce qu’elle est ma gang ? (1983) de Louis-Dominique Lavigne et Sortie de secours (collectif, 1984).
Un autre théâtre se consacre depuis 1964 à un public d’adolescents, sans pour autant leur être exclusif : la Nouvelle compagnie théâtrale ; avec ses trois grandes productions saisonnières et ses opérations-théâtre, cette compagnie vise à initier les étudiants à la connaissance du grand répertoire comme du répertoire québécois en voie de constitution. Chaque spectacle est accompagné d’un cahier, En scène21, qui situe l’œuvre représentée et qui devient ainsi un élément-clé du savoir théâtral que l’on entend inculquer aux nouvelles générations de spectateurs. Mais l’obstacle majeur qui attend ici la N.C.T. dans sa communication avec les jeunes étudiants, c’est justement le lien qu’elle a dû contracter avec l’appareil scolaire, souvent conservateur, et qui interpose ses propres valeurs dans le choix des œuvres et leur production scénique.
Comme la N.C.T.. mais voués eux à l’itinérance, les théâtres pour la jeunesse ont également dû, pour survivre, trouver à l’école leurs interlocuteurs : les enfants ou les adolescents. bien sûr, mais aussi des professeurs et des directeurs, des parents et des commissaires, inégalement ouverts et sensibles à la qualité théâtrale. les pressions pédagogiques et le contrôle didactique risquent, dans ce contexte, d’étouffer la liberté créatrice ou de la dénaturer… L’ouverture à Montréal, en 1984, de la Maison-Théâtre, un lieu de diffusion autonome. administré par des représentants de compagnies pour la jeunesse. est une initiative qui, si elle ne contre pas toutes les menaces d’une assimilation du théâtre pour enfants par l’univers scolaire, confirme la volonté des praticiens concernés de rester résolument sur le terrain de l’art.