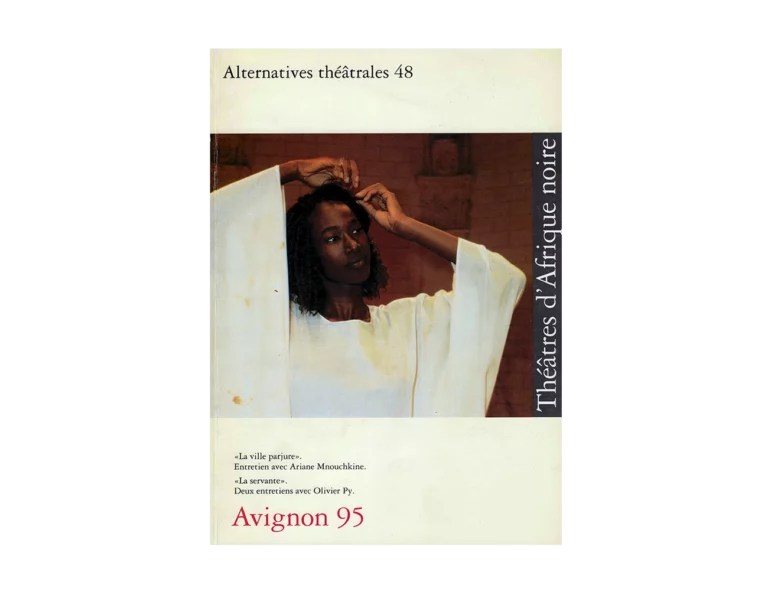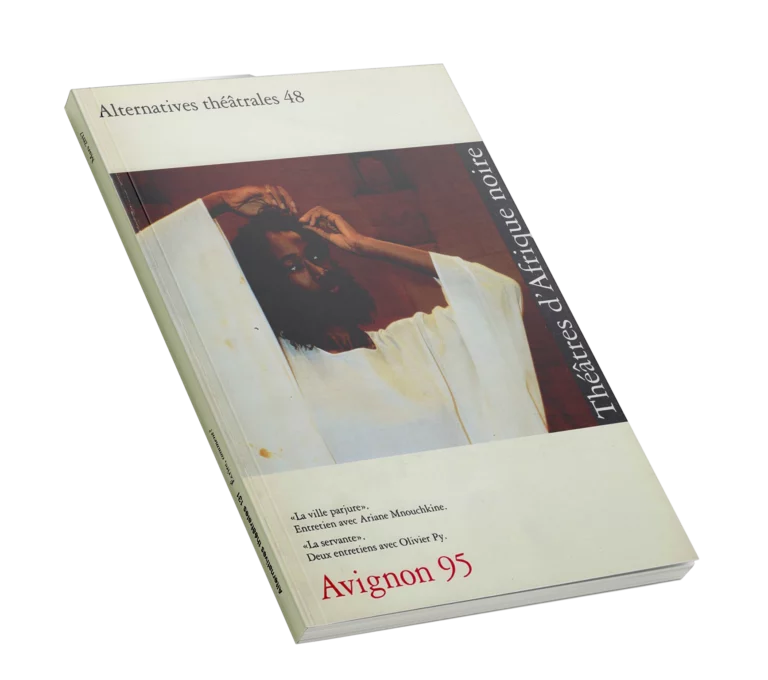-I-
Du théâtre qui ne finira
jamais (juillet 1994)*
* Cet entretien a paru initialement dans le Journal du Théâtre du Maillon (septembre — décembre 1994).
ANNE-FRANÇOISE BENHAMOU : LA SERVANTE se compose de cinq pièces qui sont comme les chapitres d’une même histoire. Trois de ces pièces seront créées séparément au cours de cette saison dans différents théâtres1. Elles seront ensuite reprises à Avignon bout à bout avec les deux dernières, ce qui donnera un spectacle d’une durée de vingt-quatre heures que vous allez jouer en boucle pendant sept jours…

Olivier Py : C’est l’origine même de mon projet. Mon idée, en écrivant ce cycle de pièces, était de produire au bout du compte quelque chose qui se jouerait non-stop : que le théâtre puisse ainsi avoir lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la boucle étant reprise indéfiniment. Que ça ne s’arrête pas ! Est-ce simplement par jouissance narcissique ? Pour que moi, le metteur en scène, je puisse aller me coucher quand je suis fatigué, en sachant que le spectacle se poursuit ? (rires) Au fond, c’est peut-être uniquement pour vivre Ça. Et pour que les spectateurs le vivent aussi : on s’en va, on quitte le théâtre et ça continue. Et personne, jamais, ne voit le spectacle dans son entier.
A.-F. B.: Qu’est-ce qui lie ces cinq pièces ?
O. P.: LA SERVANTE raconte l’histoire d’une jeune fille qui signe une sorte de contrat avec quatre garçons : elle leur demande d’aller voir le monde, tandis qu’elle les attend. Et au bout de quatre pièces — chacun la leur — ils reviennent et lui racontent ce qu’ils ont découvert. Pour cela, ils dressent un petit tréteau dans le jardin où elle a eu cette espèce d’inspiration, et c’est sur ce tréteau que va se jouer le récit de ce qu’ils ont vécu. À la toute fin de La SERVANTE, un petit théâtre est donc érigé dans le jardin et quand le rideau de ce petit théâtre s’ouvre, on recommence l’histoire à zéro, c’est-à-dire au moment où la jeune fille leur dit de partir…
Exactement comme à la fin d’À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU On découvre au dernier moment que le roman qu’on est en train de lire depuis 7000 pages est en fait celui que le narrateur commence à écrire dans LE TEMPS RETROUVÉ, et qu’on peut donc maintenant lire l’histoire une seconde fois avec un point de vue totalement différent. La dernière pièce du cycle, qui porte le même nom que l’ensemble, LA SERVANTE, se trouve ainsi en être également la première.
A.-F. B.: La « servante », c’est le nom qu’on donne, au théâtre, à la lampe qui reste allumée quand la salle et la scène sont éteintes, entre les représentations …
0. P.: Pour ce projet que nous avons d’abord appelé « Les vingt-quatre heures », l’emblème de la servante de théâtre s’est imposé à moi. Au début parce que l’objet lui-même m’a fasciné, cette lampe seule au milieu du noir, posée sur un pied, devant le décor. La jeune fille qui attend dans son jardin que les autres viennent lui dire ce qui s’est passé ressemble à cette lampe-là.
Et bien sûr l’ampoule sur son pied — à l’inverse de la représentation théâtrale puisqu’elle est toujours là quand la représentation n’a pas lieu — est l’emblème même des vingt-quatre heures : à sa manière elle dit que ça ne s’arrête jamais — à cette différence près avec notre projet qu’en général il s’agit de 22 heures 30 de veille pour 1 heure 30 de spectacle. Notre panachage sera presque inverse ! Et puis, il y a aussi l’idée du deuil et du rôle de la lampe dans une trinité qui est revenue dans tous mes dessins pendant deux ou trois ans : le lit, la chaise et la lampe — la trinité du mourant, de celui qui le veille et de la lampe entre les deux, comme une forme d’espoir, de continuité, de persistance dans le deuil même. Ce qui fait que maintenant, pour moi, la servante des théâtres qui attend dans l’obscurité ressemble aussi à la petite lampe dans la chambre où on veille le mort.
C’est un emblème que je n’en finis pas d’interroger. Plus récemment est venu s’y greffer un texte pour moi très important, la parabole de Marthe et Marie (c’est dans Luc, X, 12), les deux servantes du Christ dont on se demande laquelle est la bonne : Marie, qui ne fait qu’attendre, ou Marthe, qui est dans une espèce de course à la productivité ? Le Christ dit à Marie — ça dépend des traductions — quelque chose comme : tu as pris la bonne part, ou : ce qui est nécessaire est unique. Quelle est cette chose unique et qui est la chose nécessaire ? Cette chose que possède (à moins qu’elle n’en soit, plutôt, possédée) celle qui ne fait rien, celle qui écoute le Christ tandis que l’autre travaille ? Le frère de Lacan — qui est bénédictin — fait une très jolie lecture de cette parabole, une lecture absolument lacanienne, sur ce que c’est que jouir dans le sens d’entendre : j’ouïs. Cette bonne servante qui est Marie (mais évidemment Marthe et Marie sont aussi la même personne) dit : j’ouïs, elle est cette incitation.
A.-F. B.: Le théâtre dans le théâtre est au cœur de LA SERVANTE : d’une part parce que vous avez repris des personnages très connus, mythiques presque — Oreste et Pylade dans LE JEU DU VEUF, Roméo et Juliette dans LE PAIN DE ROMÉO, Agnès et Arnolphe dans L’ARCHITECTE ET LA FORÊT ; d’autre part parce que chacune des pièces est traversée par la petite troupe ambulante de Matamore.
O. P.: L’effet de réécriture n’est pas essentiel : je n’ai pas retravaillé mon Shakespeare ou mon Molière pour écrire ! J’ai pris les personnages tels qu’ils existent dans la culture collective. En revanche, le petit théâtre est très important. Matamore est le personnage le plus récurrent ;ses acolytes changent parfois, mais lui est présent dans toutes les pièces, ainsi que le Fou. Il sert de média, de joker, c’est lui qui transporte le héros au lieu où l’action doit se passer. Les garçons qui ont été envoyés dans le monde par la Servante voyagent toujours avec Matamore, font toujours partie de sa troupe. À la fin du JEU DU VEUF, Oreste, celui qui est le plus lié au théâtre, le metteur en scène de la bande, devient lui-même le Matamore.
Mon but était que ces quatre histoires se ressemblent le plus possible. De créer un effet d’« à chaque fois ». À chaque fois Matamore fait son entrée, à chaque fois il décrit ses acolytes, à chaque fois il meurt à la fin de la pièce puis ressuscite grâce aux applaudissements. À chaque fois le Fou se déguise en animal et à chaque fois la troupe de Matamore donne une représentation. Si ce n’est qu’à chaque fois Matamore décide de changer quelque chose à son spectacle, changement qu’on verra réalisé dans la pièce suivante : à La fin de L’ARCHITECTE ET LA FORÊT, il déclare qu’il ne jouera plus que sa mort. Donc, dans LE PAIN DE ROMÉO, il joue sa mort. Mais à la fin du PAIN DE ROMÉO il a vu tant d’horreurs et de violences qu’il dit : nous ne jouerons plus que des histoires sanglantes ; et dans la pièce suivante, LA PANOPLIE DU SQUELETTE, son spectacle est devenu une sorte de grand-guignol.
A.-F. B.: Chacun des quatre personnages partis dans le monde fait une découverte. Ce qui échoit à Uzza, dans L’ARCHITECTE ET LA FORÊT, c’est une histoire d’amour.
O. P.: (Dubitatif) Oui… Je trouve que c’est plutôt Agnès qui la vit, cette histoire. Uzza ne fait jamais que l’expérience de sa propre beauté, qui lui offre toutes les clés de la fête. S’il connaît l’amour, c’est plutôt par personne interposée : il voit l’amour qu’Agnès a pour lui. Et tout à coup ce très beau garçon, qui pourrait prétendre à bien mieux qu’une espèce de petite mocheté provinciale, découvre qu’il y a là quelquechose. Il a flairé… un mariage.
A.-F. B.: Un mariage ?
O. P.: Un mystère. Qu’ils étaient vraiment l’un pour l’autre. Qu’ils faisaient couple. Il l’a bien senti, et ça paraît aberrant au début puisqu’elle est moche et stupide. Vous comprenez ? En plus, lui, il en a quinze autres derrière … Pourquoi ça vous fait rire ? C’est plutôt bien, je trouve, qu’il tombe amoureux de quelqu’un qui n’a pas la fiche signalétique de sa « parfaite ». Ça le rend un peu moins nigaud ! Mais leur destin reste assez indécis. Comme dans la pièce de Molière, d’ailleurs.
A.-F. B.: François Périer raconte que Jouvet, à la fin de L’ÉCOLE DES FEMMES, au moment où se conclut le mariage d’‘Agnès et d’Horace, marmonnait pour lui-même en coulisse : « Je ne donne pas cher de ce petit couple ! »
O. P.: C’est ça, c’est absolument ça. D’ailleurs, dans ma pièce, cette scène est presque là. Le vrai couple, comme le dit très bien Agnès, est celui qu’elle forme avec Arnolphe. C’est ce qui me déplaît dans les mises en scène de L’ÉCOLE DES FEMMES (pas toutes.…): on a un grabataire et une ravissante jeune fille ! Alors que ça doit marcher, que ça doit être possible ! On devrait pouvoir se dire : pourquoi est-ce qu’elle ne préfère pas Arnolphe ? Mon Arnolphe, l’architecte, a tout pour lui plaire…
A.-F. B.: Si l’expérience d’Uzza n’est pas l’amour, quelle est-elle ?
O. P.: Uzza, lui, aura goûté à la rédemption. Par Agnès. Par le fait d’accepter d’être aimé. Mais je ne donne pas bien cher de ce petit couple moi non plus. Ce qui n’est pas très grave. Après tout, le but n ‘est pas qu’ils se marient et qu’ils fassent des enfants, c’est qu’ils découvrent quelque chose : ils auront leur lot, mais ça leur coûtera cher à eux aussi.
A.-F. B.: Et les trois autres garçons ? Que découvrent-ils ?
0. P. : Pour Pierre, dans LE PAIN DE ROMÉO, c’est différent ;il est témoin de l’amour de Roméo et Juliette. C’est une sorte d’éternel puceau, qui est plutôt du côté de l’écoute ;c’est le compagnon de Roméo, qu’il tente en vain de réconcilier avec son frère Mercutio, en trouvant un accommodement entre leurs deux discours. Il veut sauver Roméo de la mort et Mercutio de la culpabilité du fratricide qu’il s’apprête à perpétrer. Car dans ma pièce Mercutio tue Roméo par personne interposée. L’action a lieu dans une ville en pleine guerre civile ; Mercutio ne cesse d’exiger de son frère qu’il s’engage, qu’il prenne le parti de sa famille. Comme Roméo refuse de se reconnaître dans autre chose que la neutralité et l’amour de Juliette (qui appartient bien sûr à l’autre camp), Mercutio finit par l’assassiner.
Oreste, lui, est marqué par son amour pour Pylade et par la perte de celui qu’il aime : il a reçu le deuil en partage.C’est sans doute dans cette chambre où il veille Pylade qu’il vivra cette expérience que la Servante lui a promise. LE JEU DU VEUF, c’est d’abord cette veillée funèbre, puis la tentative d’Oreste de monter une pièce sur cette nuit où il a veillé Pylade.
Le dernier, c’est Nour, un petit jeunet qui a envie d’être un bandit. Il deviendra donc un bandit de théâtre dans la troupe de Matamore, mais dans la vie aussi il endossera le rôle du criminel. LA PANOPLIE DU SQUELETTE est l’histoire d’un homme qui assassine des gens dans un village et qui, sur la place de ce village, joue un personnage de meurtrier. Ce qui lui fournit un alibi imparable puisque les victimes sont toujours exécutées à l’heure où il est sur scène en train de jouer les assassins !
A.-F. B.: Et quel est le mot de l’énigme ?
O. P.: Aaaah ! (rires) Ça, on le comprendra dans la pièce : comme dans LAPIN-CHASSEUR de Jérôme Deschamps, on assistera deux fois au spectacle, côté face puis côté pile. On verra d’abord la représentation donnée par la troupe de Matamore comme la voient les spectateurs du village. Ensuite, en la découvrant de la coulisse, on comprendra comment Nour peut à la fois être sur le plateau et devenir réellement le criminel-justicier dont il joue le rôle.
A.-F. B.: C’est la seule des quatre pièces qui ne fasse pas référence à un grand dramaturge : dans L’ARCHITECTE il y a Molière, dans LE JEU DU VEUF les tragiques grecs, dans LE PAIN DE ROMÉO Shakespeare … Là, il n’y a pas de palimpseste, pas d’auteur en arrière-fond.
O. P.: Ah si ! Il y a tout le théâtre de Genet ! C’est quand même beaucoup. Je voudrais que ce soit une sorte de grand-guignol ; et que ce soit en même temps la belle histoire d’un homme fasciné par le mal : une fable politically incorrect. Je me rappelle toujours ce qu’a écrit Genet dans L’ENFANT CRIMINEL : « Ah, les mots incroyablement érotiques de Buchenwald, Auschwitz, etc. » Là, il a forcé le trait, il dérape. La première fois que j’ai lu ce livre, je l’ai jeté très loin. N’empêche qu’il y a quelque chose que Genet est à mon avis un des seuls à avoir pointé — de façon extrêmement provocatrice : notre fascination érotique pour le mal. Si on ne l’admet pas, on reste toujours soumis au mal, on ne peut pas en démonter Le système. Cette conscience-là est en train de se retirer de la société, et c’est grave. C’est grave de nous faire croire à tous que nous avons un bon rejet, bien propre, politiquement clair, de certaines choses. Mais l’inverse reste difficile à dire, quand même.
A.-F. B.: Est-ce que LA PANOPLIE DU SQUELETTE sera une pièce dure ?
O. P.: LE PAIN DE ROMÉO est une pièce plus dure. Parce que le sujet de La fraternité est pour moi un thème très violent. Je le relie extrêmement mal à mon histoire : je n’ai pas de frère. Peut-être en ai-je eu un qui est mort, que je me suis accusé d’avoir tué ? Peut-être est-ce ce que vivent tous ceux qui Sont fils uniques, tous ceux qui sont dans la tragédie de l’unicat ? Peut-être ai-je eu des gens suffisamment proches de moi pour que je les considère comme des frères ? Peut-être l’homosexualité ne fait-elle que poser la question du frère ? Peut-être que le manque du frère est encore plus fort et douloureux que le fameux manque du père ? En tous cas, c’est une pièce très violente, tandis que la pièce sur Nour est plus parodique. Plus exactement, il y aura (comme dans toutes ces pièces) la chose et, à côté, la parodie de la chose : Matamore jouant une histoire de criminel, de bras coupés, de grand-guignol.

A.-F. B.: Même si la présence du petit théâtre réintroduit toujours cet élément de parodie, les sujets abordés sont beaucoup plus graves que dans vos précédentes pièces : la guerre, le crime, le deuil…
O. P.: Oui. Quelque chose s’est passé. Avant, dans mon théâtre, il n’y avait pas de sexe, il n’y avait pas de sang, pas de violence. C’était vraiment du spectacle pour les amies de maman ! (rires)
A.-F. B.: La présence du Fou — qui apporte la dérision, qui fait obstacle au tragique, qui court-circuite toute tentative de pathos de la part des autres — est elle aussi assez violente à sa manière. Violente par cynisme, par obscénité, par nihilisme.
O. P.: C’est vrai. Il se fout de la gueule de tout le monde. Ce qu’il dit, c’est toujours, au fond : tout est vanité. Il doit faire un peu peur : c’est un clown, mais il est vraiment fou. Il est très proche du Polichinelle de Bernanos dans L’IMPOSTURE : dans une des dernières scènes du roman, l’abbé essaie de faire dire à ce malheureux quelque chose qui ne soit pas n’importe quoi, et au moment où il est sur le point de révéler son identité parce que l’abbé l’a cuisiné sans pitié, il fait une crise d’épilepsie. C’est à peu près ce qui se passe entre Reine et le Fou Tiroir dans L’ARCHITECTE ET LA FORÊT. Évidemment dans une version assez parodique …
A.-F. B.: La mort est très présente dans l’ensemble du cycle…